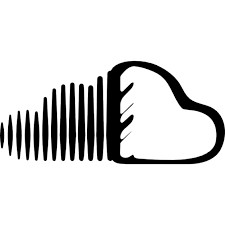JUSTICE ET POLITIQUE
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
La condamnation de Marine Le Pen, le 31 mars dernier, à cinq ans d’inéligibilité immédiate et à quatre ans de prison, dont deux fermes, a marqué l’actualité des derniers mois et a suscité de nombreux débats sur la judiciarisation de la vie politique. L’ancienne candidate aux élections présidentielles avait en effet recueilli 41% des suffrages au second tour de 2022, preuve de son poids politique et de sa capacité à être élue en 2027. Cette éventualité achoppe désormais sur la décision des juges. De « certains juges » aiment à souligner ceux qui évoque un « gouvernement des juges » pour qualifier l’emprise des magistrats sur la vie politique du pays et donc une dégradation de la démocratie.
Notons que l’on rappelle rarement que l’évolution du rôle des tribunaux a son origine dans une volonté de moralisation de la vie politique liée à de nombreuses affaires de corruption. Le mouvement actuel de remise en cause des décisions judiciaires est mondial, il est aussi divers, puisque ce « gouvernement des juges » est également dénoncé en Israël ou aux États-Unis, qu’il est fréquent dans les régimes illibéraux comme la Hongrie ou l’Argentine, mais il dépasse les frontières de ces États pour devenir un enjeu important dans toutes les démocraties et susciter d’importants débats dans les médias, mais aussi dans le monde universitaire ou chez les magistrats eux-mêmes.
En France, le rapport du Sénat du 29 mars 2022 soulignait à la fois le renforcement de l’État de droit et un certain affaiblissement du système démocratique, en rappelant notamment qu’une majorité des Français estime que les juges sont « plutôt politisés et laxistes ». Cette majorité était de 70% en novembre 2023. Pour ouvrir cette conversation, je propose de nous arrêter sur un sujet de société plutôt que sur un sujet politique. C’est-à-dire sur la récente censure par le Conseil constitutionnel de cinq articles d’une loi (dite loi Attal) qui entendait durcir la justice des mineurs. Ces cinq articles censurés portaient sur l’instauration d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans et plus déjà connus de la justice ayant commis une infraction punie de plus de trois ans de prison, sur l’extension des possibilités de recours à une audience unique. Sur l’inversion, pour les mineurs de 16 ans et plus récidivistes, du régime en matière d’atténuation des peines, c’est-à-dire l’excuse de minorité, en faisant de l’atténuation des peines l’exception et non plus le principe. Sur l’allongement de la durée de la détention provisoire à un an pour les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour certains délits et crimes terroristes ou commis en bande organisée. Et enfin, sur la possibilité de placer en rétention un mineur n’ayant pas respecté une mesure éducative judiciaire provisoire. Éric Dupond-Moretti, comment analysez-vous cette censure au regard de la question de la judiciarisation de la vie politique ?
Kontildondit ?
Éric Dupond-Moretti :
Est-ce que certains politiques n’ont pas envie d’instrumentaliser le Conseil constitutionnel pour dire : « Vous voyez ce que nous voulons faire et nous sommes entravés par le Conseil constitutionnel » ? Je pense que c’est ça la réalité. Gabriel Attal sait forcément que certaines de ces mesures vont poser problème. D’abord parce que je lui ai dit. Ensuite, parce que les affaires criminelles et les grâces (une direction du ministère de la justice) ont dit que ça posait un certain nombre de difficultés. Alors, à partir du moment où on soumet un texte au Conseil constitutionnel en sachant qu’il est inconstitutionnel, on ne peut que s’attendre à une censure du Conseil constitutionnel, qui a été fait pour cela.
Mais c’est gagnant-gagnant pour le politique qui a cette audace, parce qu’il dit : « vous voyez, je vais dans le sens de l’opinion publique » qui comme chacun le sait, est toujours plus répressive et sévère par les temps qui courent. Et donc faire porter le chapeau au Conseil constitutionnel permet à des gens comme Wauquiez de souhaiter qu’une loi inconstitutionnelle puisse retourner devant le Parlement, au mépris de la décision du Conseil constitutionnel. Mais tant qu’à faire, qu’on gagne une étape, qu’on supprime tout de suite le Conseil constitutionnel, ce sera beaucoup plus simple … Le Conseil constitutionnel se fonde sur le texte suprême qu’est la Constitution, mais aussi sa jurisprudence. Or il y a déjà pléthore de jurisprudences en matière de justice des mineurs qui soulignent la spécificité de cette justice.
Philippe Meyer :
L’un des arguments utilisés par les gens qui veulent davantage de sévérité, c’est que la minorité a évolué, physiquement, socialement, et que par conséquent, la justice et le pays devraient adapter leurs lois à cette évolution.
Éric Dupond-Moretti :
Oui, j’entends régulièrement cet argument, repris de façon récurrente par ceux qui pensent que l’on peut régler les problèmes de délinquance en tapant plus fort. D’abord, si c’était vrai, ça se saurait depuis des siècles. Et deuxièmement, oui, les choses ont changé, mais a-t-on pris la peine de se demander pourquoi ?
Les jeunes ont accès à la pornographie via les réseaux sociaux dès l’âge de 11 ans. Et les adolescents ne font plus l’amour. Ça interroge quand même. Le taux de THC, dans la résine de cannabis actuelle est 10 fois supérieur au taux de THC des joints festifs des années 68. Dans les milieux favorisés, les adolescents disposent de 3000 mots, dans les milieux défavorisés, de 300. On pourrait aussi parler du confinement, qui a laissé un certain nombre de traces. Il y a par ailleurs un mal-être psychologique et psychiatrique qui est une évidence. Il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident. Pourtant aujourd’hui, certains appellent ça la « culture de l’excuse » ... Alors que tout cela mériterait une vraie réflexion, et a minima un état des lieux. Avant d’envisager des mesures qui sont toutes prises à l’aune de la répression et de la sévérité.
Jean-Louis Bourlanges :
Je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit. Mais on a quand même le sentiment que cette classe d’âge, qui diffère profondément des précédentes, devient adulte à la fois beaucoup plus lentement et beaucoup plus difficilement. À 22 ans, on a souvent affaire à des adolescents prolongés, alors que dans ma génération, à cet âge-là, on se mariait, on travaillait, on était déjà pleinement dans la vie — avec tout ce que cela pouvait avoir d’absurde. En même temps, ils sont très mûrs, très actifs. Ils font moins l’amour qu’avant, mais ils commencent beaucoup plus tôt. Ils sont dans une situation de quasi-responsabilité, affranchis de toute tutelle. Autrefois, les parents étaient responsables ; aujourd’hui, ils sont dépassés. Il y a donc une inadéquation du traitement actuel de l’adolescence à la réalité de cette génération.C’est cela qui est apparu, de manière tragique, le jour même où le Conseil constitutionnel a rendu sa décision : une femme a été assassinée dans des conditions abominables par un adolescent incapable d’exprimer le moindre sentiment de culpabilité.
Ce contraste a été saisissant, et les responsables politiques ne peuvent y rester insensibles. Il faut traiter ce problème globalement, en profondeur, mais les conditions politiques ne sont pas réunies pour le faire. En attendant, le décalage est fortement ressenti, et il est extrêmement douloureux.
Éric Dupond-Moretti :
Je suis d’accord. Mais les solutions proposées vont toutes dans le même sens. Gabriel Attal avance des mesures que le Rassemblement national pourrait tout à fait reprendre à son compte. Je voudrais ajouter deux éléments au constat sur la jeunesse.
D’abord, sur le plan neurologique, un adolescent de 15 ans n’a pas un cerveau pleinement développé. Il faut en tenir compte. Et quand le ministre de l’Intérieur propose d’abaisser l’âge de la majorité pénale, cela me pose problème. Ensuite, on voit une augmentation des familles monoparentales. Après les émeutes de l’été 2023, on a constaté que 40 % des jeunes concernés vivaient seuls avec leur mère. D’où le cri de Bruno Retailleau : « Mais où sont les pères ? » Les pères sont partis. C’est une réalité nouvelle. La famille que nous avons connue était rarement monoparentale. Cela relance le débat sur la responsabilité parentale. Pour ma part, je suis d’accord pour responsabiliser les parents défaillants, mais pas pour accabler ceux qui sont simplement dépassés.
Il faut commencer par poser les problèmes. Or, comme toujours, on est dans l’urgence, après une série de crimes. Et quand on regarde l’Angleterre, l’Autriche ou les États-Unis, on voit des législations très différentes, des philosophies très diverses — et les mêmes difficultés face à la délinquance des mineurs. J’ai vu un reportage sur le traitement des mineurs aux États-Unis : c’est d’une dureté extrême, et pourtant, ça ne règle rien. Il faut bien sûr de la fermeté, mais sans renoncer au projet éducatif. C’est ce que rappelle le Conseil constitutionnel, et il a raison.
Jean-Louis Bourlanges :
Pour revenir à la question initiale, je me souviens avoir discuté longuement avec Jean-Louis Debré, alors président du Conseil constitutionnel. Il était scandalisé par l’attitude de la majorité socialiste sous François Hollande, qui adoptait des lois radicales en sachant qu’elles étaient inconstitutionnelles, pour que le Conseil les censure. Il avait le sentiment d’une double instrumentalisation : d’un côté par une frange radicale de l’Assemblée, de l’autre par un gouvernement qui acceptait tous les amendements, sachant qu’ils seraient retoqués.
Je m’étais abstenu sur la loi immigration, il y a deux ans, car une trentaine de dispositions étaient manifestement contraires à la Constitution. En tant que parlementaire, je ne suis pas là pour voter des textes inconstitutionnels. Le fond de la loi était discutable, on y projetait trop d’attentes, mais le problème principal était procédural. On ne peut pas fonctionner ainsi.
La hiérarchie des normes reste profondément étrangère à la culture politique française, imprégnée de jacobinisme. L’idée dominante, c’est qu’il n’y a qu’un seul pouvoir. Qu’il s’agisse du Comité de salut public, de l’Assemblée nationale ou de l’union de la gauche, le pouvoir est perçu comme indivisible. On ne distingue pas entre lois ordinaires et lois constitutionnelles — ce qui a permis à Pétain de mettre fin à la République sans violer la lettre de la loi, puisque les textes fondateurs de la Troisième République étaient de simples lois ordinaires. Pendant longtemps, on a refusé la distinction entre loi et règlement, entre loi constitutionnelle et loi ordinaire, et même le Conseil constitutionnel a été contesté. Aujourd’hui encore, des figures comme Éric Zemmour rejettent toute hiérarchie des normes. Or cette hiérarchie est indispensable à la protection des libertés et au bon fonctionnement d’une démocratie libérale. Cela dit, si l’on veut une justice pleinement indépendante — et j’y suis favorable — il faut reconnaître qu’elle est aussi très divisée, donc politisée. Elle reflète la fragmentation de la société, ce qui pose un réel problème. François Mitterrand, qui était en réalité un homme de droite à la tête de la gauche, avait cette formule : « Les juges ont liquidé l’Ancien Régime, méfiez-vous, ils liquideront la République. » Il y a là une vérité. Sous l’Ancien Régime, les cours souveraines constituaient une puissance réelle. Leur résistance aux réformes de Maupeou a marqué le début de la fin de la monarchie absolue. La République, elle, a longtemps maintenu un système hypocrite : une indépendance judiciaire de principe, mais un contrôle étroit de l’avancement des juges par l’exécutif. Cela produisait un équilibre précaire.
Aujourd’hui, la vraie question est celle du droit romain : quis custodiet ipsos custodes ? Qui gardera les gardiens ? Une justice indépendante est indispensable, mais il faut aussi une régulation adaptée pour éviter qu’elle ne dérive en contre-pouvoir absolu, intervenant abusivement dans l’action publique ou législative.
Éric Dupond-Moretti :
Il faut poser les problèmes clairement. Peut-on interdire à un magistrat d’avoir des opinions politiques ? Non. Ce n’est pas un sous-citoyen. Peut-on lui interdire de se syndiquer ? Non plus. On doit donc compter sur l’impartialité du magistrat, qui sait mettre de côté ses convictions pour juger le plus équitablement possible. Ce qui m’a réellement dérangé, en tant que Garde des Sceaux et en tant que citoyen, c’est l’expression totalement débridée de certains syndicats, qui donnent à penser qu’ils sont entièrement politisés. Quand le Syndicat de la magistrature déclare : « Macron-Le Pen, deuxième tour de cauchemar », il sort clairement de son rôle. Et cela accrédite l’idée, fausse, que tous les magistrats seraient politisés.
Il y a une minorité — j’ai parlé de « clique », le mot n’est pas idéal — qui s’autoproclame gardienne de la morale publique. Il s’agit en réalité d’une lutte pour le pouvoir. L’autorité judiciaire, en droit constitutionnel français, n’est pas un pouvoir, c’est une autorité. Or certains veulent qu’elle devienne un pouvoir. Le simple fait que la revue trimestrielle de l’Union syndicale des magistrats s’intitule « Pouvoir judiciaire » est déjà en soi problématique. Quelques magistrats ne cherchent pas à « se faire » des responsables politiques, mais à s’en prendre à ce qu’ils représentent : l’exercice du pouvoir. C’est très différent du discours globalisant de Mme Le Pen, qui met tous les magistrats dans le même sac, les accuse de laxisme et réclame des sanctions irrévocables. Ce n’est pas la réalité. J’ai beaucoup voyagé et rencontré de nombreux magistrats, notamment en province. Leur préoccupation première n’est pas la politisation de la justice. Mais il reste cette minorité active, animée par une volonté d’imposer une forme d’autorité qui tend à devenir un pouvoir. C’est là qu’apparaît la judiciarisation de la vie politique. Il faut rappeler deux choses : d’abord, constitutionnellement, l’autorité judiciaire n’est pas un pouvoir ; ensuite, les juges n’ont aucune légitimité démocratique. Et quand ils s’en prennent à la gestion de la crise Covid, on est clairement dans le champ politique. Le procès intenté à Édouard Philippe, Agnès Buzyn ou Olivier Véran, accompagné d’humiliations, est un dérapage manifeste.
Quand on m’attaque moi-même pour avoir donné suite à une procédure administrative lancée par ma prédécesseure, c’est un procès en illégitimité. Un syndicat, le plus important, avait déclaré que ma nomination était « une déclaration de guerre ». Trois ans plus tard, on continue à me poursuivre. Et derrière tout cela, il y a François Molins, qui aspire à devenir Garde des Sceaux. Il le nie, mais je sais que c’est vrai. Il y a donc des dérives. Mais il faut être clair : l’immense majorité des magistrats savent rester à leur place. Je refuse l’idée que toute la justice serait politisée. Dans ma carrière d’avocat — 36 ans de barreau — j’ai vu de grands magistrats appartenant au Syndicat de la magistrature. Et l’inverse est vrai aussi.
Jean-Louis Bourlanges :
Je suis tout à fait d’accord avec vous. J’ai été magistrat à la Cour des comptes, et je n’ai jamais compris qu’on puisse avoir une autre priorité, dans cette fonction, que de chercher la vérité, en s’abstrayant des partis pris. C’est là toute la grandeur et l’intérêt de ce métier : se retirer des intérêts partisans pour examiner les faits avec rigueur. J’ai, de mon côté, pris fait et cause pour Agnès Buzyn. Dans son cas, on est clairement dans une dérive.
Concernant le Syndicat de la magistrature, je considère comme vous que les juges ont parfaitement le droit d’avoir des opinions politiques. Ils doivent respecter la loi, mais ils peuvent interpréter la jurisprudence, dans un système où les voies de recours existent et assurent une forme de régulation. Mais il y a des cas inadmissibles. L’affaire du « mur des cons », par exemple. Je me souviens d’une députée LR, avec qui je n’étais pas d’accord sur grand-chose, mais qui figurait sur ce mur. Elle m’a dit : « si je me retrouve un jour face à un juge du Syndicat de la magistrature, j’ai peur. » Et ce qui m’a frappé, c’est qu’il n’y a eu aucune réaction — ni de la garde des Sceaux de l’époque, ni du syndicat lui-même. Si j’avais été secrétaire général de ce syndicat, j’aurais démissionné. J’aurais reconnu la faute, admis qu’on s’était laissé emporter, et présenté des excuses. Ce mur était une injure, notamment à l’égard du général Schmitt ou d’autres, comme cet homme dont la fille avait été assassinée.
Éric Dupond-Moretti :
M. Escarfaille, dont le seul tort était de réclamer justice après l’assassinat de sa fille. Lui aussi figurait sur le mur des cons …
Jean-Louis Bourlanges :
Prenons maintenant le cas d’Agnès Buzyn : on a tenté de lui faire porter la responsabilité d’un manquement à la loi, comme si elle avait délibérément refusé de l’appliquer, alors qu’elle a agi dans un climat d’incertitude, avec beaucoup de prudence et de difficultés. D’ailleurs, les positions de l’OMS pendant les premières semaines de la pandémie étaient tout sauf limpides. Quand on regarde cela, on se demande comment on peut sérieusement l’accuser d’avoir failli à un devoir législatif. Le cas d’Édouard Philippe est du même ordre. J’avais d’ailleurs fait une remarque à un collègue qui proposait de considérer que tout manquement dans l’application d’une loi environnementale constituerait une illégalité pouvant être sanctionnée. Je lui ai dit : « mais comment peux-tu défendre une telle idée ? » Le domaine environnemental est l’un des plus complexes qui soient : il faut à la fois préserver les paysages, contribuer à la décarbonation, limiter les inégalités sociales … C’est un système multicritère extrêmement dense. Comment un juge pourrait-il remplacer l’appréciation politique dans la gestion de ces arbitrages ? Le seul juge légitime, dans ce type de décisions, c’est le suffrage universel.
Éric Dupond-Moretti :
Concernant l’affaire Philippe, Buzyn et Véran, il faut rappeler que l’intégralité de leur dossier a été transmise à certains journalistes proches, comme Davet et Lhomme, ou à Mediapart. C’est une violation manifeste du secret de l’instruction. Évidemment, personne n’est jamais reconnu coupable. Mais il y a là quelque chose de singulier dans cette clique de magistrats que je dénonce depuis longtemps : le secret de l’instruction est violé sans scrupule, en échange de papiers favorables aux thèses de tel ou tel juge. Agnès Buzyn s’est même vu saisir son journal intime. Chez Olivier Véran et sa compagne, on est allé jusqu’à fouiller dans le linge de corps. Édouard Philippe a été perquisitionné à six heures du matin, comme s’il s’agissait d’un voyou. Et tout cela a été immédiatement transmis aux journalistes. C’est insupportable.
Mais il faut le redire clairement : cela ne reflète pas le travail de l’ensemble de la magistrature. C’est une minorité qui agit ainsi, mais elle donne le ton d’une justice perçue comme politisée. Entre le mur des cons du Syndicat de la magistrature et certains tracts, comme ceux qui soutenaient les émeutiers de Sainte-Soline plutôt que nos forces de l’ordre, il y a un vrai problème. J’ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour leur demander s’il était normal que des magistrats puissent s’exprimer ainsi. Qu’ils défendent leurs conditions de travail, c’est une chose. Mais qu’ils prennent publiquement position sur des sujets politiques, ce n’est plus leur rôle. Le Conseil a répondu que leur liberté d’expression était totale. Mais quand les Français lisent ce genre de déclarations, quand ils découvrent le mur des cons, cela abîme profondément l’image de la justice. Elle est déjà perçue comme lente, parfois injuste, et près de 80% des Français n’ont pas confiance en elle. Ce n’est pas la peine d’aggraver les choses. L’expression syndicale des magistrats devrait, à mon sens, être encadrée. Le Conseil supérieur aurait dû le dire. Il ne l’a pas fait.
Philippe Meyer :
Vous venez de prononcer l’expression « secret de l’instruction ». Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la possibilité de faire en sorte que ce secret soit respecté, ou alors qu’on le supprime une bonne fois pour toutes ? Parce que cela fait au moins depuis le Premier Empire qu’on déplore son non-respect, et pourtant il ne l’est jamais.
Éric Dupond-Moretti :
Si, il l’est parfois. Mais si vous dites qu’on doit supprimer le secret de l’instruction, vous risquez de donner de mauvaises idées à ceux qui, justement, continuent à le respecter. Je ne dis pas que ce soit la majorité, mais certains s’y tiennent.
Philippe Meyer :
Si on ne peut pas le faire respecter, il faut le retirer. Mais si on peut, il faut expliquer pourquoi. Qui a déjà été sanctionné pour avoir transgressé ce secret ?
Éric Dupond-Moretti :
Mon prédécesseur Jean-Jacques Urvoas a été condamné. Quelques avocats aussi, quelques policiers, et même des magistrats. Mais cela reste très rare. Pourtant, on sait qu’il existe des cercles : des journalistes « amis » à qui l’on fait passer certains procès-verbaux, en échange d’une couverture favorable. Je vais prendre mon propre cas. L’intégralité de mon dossier a été donnée à Davet et Lhomme, les journalistes du Monde, qui ont écrit un tas de choses diffamatoires. Et comme ces papiers allaient dans le sens de l’instruction, les juges les ont lus, puis les ont convoqués pour témoigner. On boucle la boucle : ils ne sont témoins de rien d’autre que de leurs propres articles, mais ce sont des témoins à charge. Voilà comment ça fonctionne.
Encore une fois, ce n’est pas le cas partout. Il existe des magistrats qui respectent ce secret. Et c’est une règle utile. Mais il faut reconnaître que la presse française, en général, a beaucoup de mal avec le secret de l’instruction. Prenez l’exemple de l’affaire Mbappé en Suède. Il y a très peu d’éléments qui ont fuité. Si ça s’était passé à Paris, dans un hôtel, tous les journalistes auraient été informés dans l’heure, avec les procès-verbaux à l’appui. Chez nous, on a un vrai problème avec ça.
Jean-Louis Bourlanges :
Et on ne peut pas corriger ça ? Parce que c’est quand même une anomalie. Il devrait être possible de faire respecter la loi aux magistrats …
Éric Dupond-Moretti :
Jean-Louis, vous êtes comme moi un geek averti, à la pointe de la haute technologie. J’avais demandé, quand j’étais garde des Sceaux, s’il n’était pas possible, avec les moyens modernes, de tracer les documents. Eh bien, ça semble extrêmement complexe. Un juge, par exemple, peut faire une photocopie d’un dossier et en faire un document de travail. Ensuite, qui sait ce qu’il devient ? C’est pareil pour un avocat. C’est très difficile à contrôler. Mais je crois qu’il faut continuer à marteler à quel point le secret de l’instruction — comme la présomption d’innocence d’ailleurs — sont des piliers essentiels.
Jean-Louis Bourlanges :
Il y a quand même deux réalités assez marquantes. D’abord, une réalité institutionnelle, directement liée au droit et aux décisions de justice européennes, qu’il s’agisse de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de justice de l’Union. Ce qui me frappe, c’est l’éloignement, ou la faiblesse, de l’autorité politique qui édicte la norme, par rapport à la puissance de la jurisprudence. Ce n’est pas la faute des juges. C’est que le système européen est extraordinairement entravé dans sa capacité à produire de la loi. Résultat, les prétoires prennent le relais.
Et on a souvent — même si c’est parfois exagéré — le sentiment d’un pouvoir normatif très autonome, qui échappe aux décisions politiques censées le fonder. Comment résoudre cela ? Plus on s’éloigne du cadre national, plus le fossé se creuse entre les décisions de justice et une norme véritablement acceptée, intériorisée par chacun.
Éric Dupond-Moretti :
La Cour de justice a suscité de vraies polémiques, notamment sur la conservation des données, qu’on craignait de voir entraver les enquêtes. Finalement, les choses se sont apaisées. À ma connaissance, aucune enquête n’a été annulée à cause de cette jurisprudence. Il faut dire aussi que la jurisprudence européenne est marquée par la diversité des traditions juridiques des pays qui composent l’Union.
Mais ce qui me frappe, c’est qu’on parle sans cesse de l’état de droit sans jamais vraiment le définir. Qu’est-ce que c’est, l’état de droit ? Si on veut être simple : c’est ce moment où la justice intervient pour trancher un litige. En matière civile, deux voisins se disputent pendant des années, la justice tranche. En matière pénale, une plainte est déposée, l’accusé nie, la justice statue. Ce n’est pas toujours juste, j’en conviens, mais la fonction première de l’état de droit, c’est de pacifier, de cicatriser.
C’est pareil avec le Conseil d’État. J’entends M. Wauquiez, qui en est issu, le critiquer violemment. C’est insupportable. Que veut-on ? Que les litiges ne soient jamais tranchés ? Pour certains, une bonne jurisprudence, c’est uniquement celle qui leur donne raison. Le Conseil constitutionnel ? Même logique. Et l’Europe. J’ai vu des gens qui dénigraient la Cour européenne des droits de l’homme, et qui s’y précipitent aujourd’hui en espérant une condamnation de la France. C’est contradictoire. L’état de droit est fondamental parce qu’il permet de clore un conflit. J’ai reçu des magistrats hongrois qui m’ont raconté comment l’exécutif avait confisqué leur liberté juridictionnelle. C’est révoltant.
On peut critiquer une décision de justice. Certaines sont déroutantes, parfois choquantes. Mais quand le pouvoir politique se met à les remettre en cause systématiquement, c’est une faute. L’indépendance suppose des décisions imparfaites. Mais je ne veux pas d’un modèle comme la Hongrie, qu’admire toute l’extrême droite, y compris française. C’est glaçant.
On sait ce qu’on quitte, on ne sait jamais ce qu’on adopte à la place. Tout est devenu objet de soupçon. Marine Le Pen n’est pas satisfaite ? « Alors la justice ne vaut rien … » C’est une attaque directe contre la démocratie. Et je le remarque : beaucoup de ceux qui se disent innocents ne font même pas appel. Cela vaut aveu. Même chose pour la justice administrative. Quand elle vous donne tort, on la délégitime. Idem pour le Conseil constitutionnel. Mais alors, on s’arrête où ? Que veut-on mettre à la place ? C’est ça, la vraie question. Si l’on continue comme ça, on glisse doucement, mais sûrement, vers un régime illibéral. Et c’est une pente extrêmement dangereuse.
Jean-Louis Bourlanges :
Je suis entièrement d’accord avec vous. Je suis convaincu que la notion de démocratie illibérale est une imposture totale. La dérive du régime orbanien est limpide, et elle est d’ailleurs de plus en plus contestée, y compris par les Hongrois eux-mêmes. Mais ce phénomène s’étend : on le voit en Slovaquie, et je suis très préoccupé par l’évolution de la Pologne après la dernière présidentielle. Il y a là des risques de durcissement très inquiétants.
Cela dit, on ne doit pas se résigner. Il est possible d’améliorer le système. Il existe un vrai décalage entre une classe judiciaire issue de l’élite, bien formée, porteuse de valeurs, et une opinion publique de plus en plus gagnée par le populisme. Ce fossé, il faut s’efforcer de le combler. Peut-être par une meilleure formation, une instruction civique renforcée, un travail de pédagogie. Mais tout cela reste très théorique. En revanche, le sentiment profond que la justice échappe aux citoyens, qu’elle ne leur appartient plus, ce sentiment est réel. Et c’est lui qui nourrit les ressentiments, les réflexes populistes, dont nous dénonçons tous deux les effets délétères.
Éric Dupond-Moretti :
Il faut dire que sur les plateaux des chaînes d’info en continu, la justice est présentée à travers une vision exclusivement fondée sur les faits divers. On dénombre environ 1000 meurtres par an en France, pour 66 millions d’habitants — on est donc loin d’être le pays le plus criminogène. Mais cela suffit à alimenter en permanence les chaînes d’info, qui peuvent exploiter deux meurtres par jour en posant toujours la même question : « que fait la justice ? »
Parallèlement, on diffuse l’idée, chère à l’extrême droite, d’une justice laxiste. C’est faux : il y a aujourd’hui 83.000 détenus, chiffre récemment publié, et les peines prononcées n’ont jamais été aussi lourdes. Pourtant, on associe cette prétendue indulgence à une hausse de la délinquance, et on conclut que la justice est responsable de tout. Voilà ce qu’on martèle quotidiennement à des millions de téléspectateurs. Comment, dans ces conditions, voulez-vous que les Français aient confiance dans leur justice ? Tout autre discours est inaudible. Quinze jours après ma nomination, j’ai déclaré sur Europe 1 qu’il y avait à la fois de l’insécurité et un sentiment d’insécurité, en précisant que ce sentiment était aussi alimenté par les chaînes d’info continue. J’ai été avocat pendant 36 ans, je sais de quoi je parle. Cette phrase a été tronquée. CNews s’est moqué de moi pendant quatre ans, répétant : « pour Dupond-Moretti, il n’y a qu’un sentiment d’insécurité. » Et tout le monde a repris : Praud, Fenech, Onfray — le philosophe de Bolloré — tous. Aucun n’a eu l’honnêteté intellectuelle de rétablir mes propos. Voilà l’ambiance.
Jean-Louis Bourlanges :
C’est Jospin qui avait utilisé pour la première fois cette expression, quand il était Premier ministre : « c’est plus un problème de sentiment d’insécurité que d’insécurité ». C’est devenu un stéréotype.
Éric Dupond-Moretti :
Et ça lui a coûté très cher, à l’époque. Aujourd’hui, tout autre discours est inaudible. Pourtant, on continue à entendre que la justice laxiste génère de la délinquance… mais comment les citoyens pourraient-ils encore se reconnaître dans la justice ? Ce n’est plus possible. Et pourtant, la justice n’est pas laxiste. Elle cogne. Elle n’a jamais été aussi sévère. Les prisons sont pleines comme jamais.
Jean-Louis Bourlanges :
Il y a quand même deux problèmes fondamentaux, qui tiennent à l’exécution. La justice n’est pas laxiste, mais elle est très lente. En matière pénale, elle l’est souvent trop. L’exécution des peines est compliquée. Et en matière civile, c’est tout simplement effrayant. Je connais des gens qui ont entièrement raison sur le fond, mais cinq ans plus tard, ils n’ont toujours pas obtenu justice. Cette lenteur dilue totalement le rapport au droit.
Et puis, les peines sont souvent inadaptées. On alterne entre la prison ou rien. Ne pas incarcérer, c’est perçu comme du laxisme. Incarcérer, ce n’est pas forcément mieux. Que fait-on réellement en prison ? On ne sait pas très bien si on y punit ou si on y rééduque. Il y a une forme d’impuissance à agir après le constat du délit ou du crime, et après la sanction.
Éric Dupond-Moretti :
Je voudrais nuancer un peu ce qu’on dit sur l’inexécution des peines. L’extrême droite présente cela comme une masse stagnante de sanctions qui ne seront jamais appliquées, mais c’est faux. Beaucoup de ces peines sont en réalité en cours d’exécution. Prenons un exemple : un homme est condamné à quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt, l’exécution est immédiate. Mais si la peine est aménageable, elle nécessite l’intervention d’un juge d’application des peines, une enquête sociale… cela prend du temps. Ce sont des peines en instance, pas des peines oubliées. Il ne s’agit pas d’un stock immobile, mais d’un flux permanent. Et sur ce plan, la France fait partie des pays européens les plus performants, ce qu’on oublie souvent de rappeler.
Quant à la justice civile, oui, elle est trop lente. C’est pourquoi je suis allé m’inspirer de l’amiable aux Pays-Bas et au Québec. Là-bas, certains litiges se règlent en quatre mois, contre quatre ans en France. Et les premières expériences menées chez nous, comme à Aix-en-Provence, sont très prometteuses : magistrat, avocats des deux parties, tout le monde autour de la table, et un accord trouvé en quelques mois. C’est un vrai changement de culture qu’il faut opérer. Au Québec, en Belgique ou aux Pays-Bas, 70 à 80 % des affaires se règlent de cette manière.
Il faut aussi rappeler que la justice française a été dotée budgétairement comme jamais auparavant : +60% depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Quand il est arrivé, il n’y avait même pas de Wi-Fi dans les tribunaux. Depuis, 2000 personnes ont été recrutées dès la première année, moitié pour le civil, moitié pour le pénal. Évidemment, ce n’est pas encore suffisant — on manque encore de juges — mais l’effort est massif. Ce que je regrette, c’est qu’on n’entende jamais les syndicats de magistrats dire ce qu’ils ont pu faire avec cet argent, comment ils l’ont utilisé pour améliorer les choses. On entend des doléances, mais jamais un retour d’expérience. Or, la réalité, c’est que des choses ont bougé.
Jean-Louis Bourlanges :
Est-ce que, compte tenu de l’échevinage, le déficit de magistrats n’est pas en réalité moins important qu’on ne le dit ?
Éric Dupond-Moretti :
C’est exact. On compare souvent avec l’Allemagne, mais chez nous, les conseillers prud’homaux, par exemple, ne sont pas comptabilisés comme magistrats, car ce ne sont pas des professionnels. Il en va de même pour les juges consulaires dans les tribunaux de commerce. Tout cela réduit l’écart entre notre nombre de personnels judiciaires et celui d’autres pays.
Philippe Meyer :
Qu’est-ce qui freine ou empêche le développement de cette justice à l’amiable dont vous parlez, comme de la justice restauratrice que Jeanne Herry a magnifiquement illustrée dans son film ?
Éric Dupond-Moretti :
Quand je parle d’un changement de paradigme, ce n’est pas un mot en l’air. On a en France une vraie culture de la castagne. Même les avocats doivent évoluer vers l’amiable. Mais eux, leur objectif, c’est de gagner leurs procès. Il y avait donc un enjeu : il fallait les embarquer. Au sommet de la représentation du barreau, ils ont fini par adhérer à la démarche amiable. On a même mené une campagne publicitaire ensemble. Mais il y avait au départ un risque économique perçu. Pourtant, les avocats québécois ou néerlandais qu’on a rencontrés disent que c’est en réalité plus rentable : une affaire réglée en quatre mois, ce n’est pas quatre ans de procédures. L’honoraire de résultat reste significatif, et on satisfait le client plus vite.
Tout cela est en train de se mettre en place. À la Chancellerie, toute une équipe s’est mobilisée sur l’amiable, en particulier la directrice des affaires civiles et du Sceau, très investie. Il faut du temps. Mais c’est justement l’un des éléments du désamour entre les Français et leurs élites : le décalage entre ce qu’on promet et ce qui arrive. Et plus la réforme fait consensus, plus l’attente devient frustrante. L’amiable, oui, c’est très attendu, mais il faut laisser le temps aux choses de s’installer.
Philippe Meyer :
Je ne voudrais pas qu’on se quitte sans avoir évoqué la situation des prisons, leur état actuel, l’opportunité d’en construire de nouvelles, et la question des peines alternatives ou substitutives, leur efficacité, etc. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet comme garde des Sceaux, et vous avez sûrement des choses à dire.
Éric Dupond-Moretti :
Refaisons un petit détour par les Pays-Bas. L’extrême droite adore cette idée de la courte peine pour les mineurs, en disant que ça fonctionne très bien là-bas. C’est faux. Un rapport parlementaire néerlandais affirme que ça ne marche pas du tout. Et surtout, le risque, c’est qu’un jeune délinquant sorte de prison avec des galons. Je suis allé sur place, je l’ai vu. En revanche, ce qui fonctionne bien aux Pays-Bas, c’est qu’ils ont ralenti cette logique de répression systématique. Ils incarcèrent beaucoup moins. Ils ont même fermé des prisons. Eux, ils ne construisent pas, ils ferment. Et en même temps, la délinquance baisse. Ce qui prouve que la répression n’est pas la seule réponse. Ils la remplacent par quoi ? Par des structures, des bureaux, et notamment par le travail d’intérêt général, le TIG, qui a été créé par Badinter. Et ça marche. Pour certains jeunes, c’est même leur première vraie expérience de travail.
Moi, je suis contre la suppression du sursis. Si on en parle avec des parents, le sursis, dans la vie quotidienne, c’est l’équivalent d’un avertissement. Avant de sanctionner son enfant, on lui parle, on lui donne une chance. C’est ça, le sursis. Et j’aurai encore l’occasion de m’exprimer sur toutes ces mesures. Concernant les prisons, on en a déjà sorti de terre 5 000 places. 5 000 autres sont en cours de construction. Mais la grande difficulté que j’ai rencontrée, c’est l’obtention des terrains. Tout le monde veut des prisons, mais personne ne les veut près de chez soi… Et les élus qui réclament le plus de fermeté sont souvent ceux qui font le moins pour permettre la construction de ces établissements. Je le dis clairement. Alors bien sûr qu’il faut des prisons. Mais la prison, c’est trois choses : protéger la société d’un individu dangereux, punir, et réinsérer. Et aujourd’hui, on n’entend plus du tout parler de réinsertion. Ce mot a disparu.
Jean-Louis Bourlanges :
Il faudrait d’ailleurs parler d’insertion, plutôt que de réinsertion.
Éric Dupond-Moretti :
C’est vrai. C’est d’ailleurs pour ça qu’on a créé le contrat du détenu travailleur. J’avais lié la réduction de peine à l’effort fourni par le détenu, en tenant compte de ses capacités : se désintoxiquer pour certains, apprendre à lire, à écrire, et travailler dès qu’un poste est disponible. Et beaucoup d’entreprises sont venues en prison. On a lancé une grande campagne avec le MEDEF, qui a vraiment été un partenaire efficace.
Tout ça s’inscrit dans une politique d’ensemble. Il faut encore construire des prisons, parce qu’on en manque, c’est une évidence. Les conditions de détention, aujourd’hui, sont parfois totalement indignes. Faire payer la « nuitée » aux détenus — comme le propose le député LR Éric Pauget — c’est une idée qui me choque profondément. Il parle de 5 euros par jour, soit 150 euros par mois. Il faut vraiment ne jamais avoir mis les pieds dans une prison pour dire ça. La plupart des détenus sont indigents. Et ces 150 euros n’iront pas aux victimes. Alors, on fait quoi ?
À Lutterbach, on a inauguré une prison toute neuve avec le Premier ministre. Est-ce qu’on paye plus cher qu’à Seysses, où des détenus dorment par terre ? Je ne sais pas. Ce sont des réactions à chaud, dictées par l’opinion publique. On attrape une idée au vol, on pense que ça va marcher, mais ce n’est pas ma conception d’une politique pénale sérieuse.
Jean-Louis Bourlanges :
Vous êtes de Maubeuge, ce n’est pas très loin de Tourcoing. Est-ce que vous vous sentez très éloigné de ce qu’essaie de faire actuellement Darmanin ? Ou est-ce que vous trouvez qu’il est sur une voie très différente, très profondément différente de la vôtre ? Ou est-ce que vous vous trouvez seulement qu’il réalise une inflexion peut-être un petit peu forte, mais globalement justifiée ?
Éric Dupond-Moretti :
Je pense que parfois, Tourcoing est très éloigné de Maubeuge …
Philippe Meyer :
Alors, une dernière question qui, je crois, doit interroger pas mal de gens, c’est la réponse à l’augmentation du narcotrafic et à la violence de tout ce qui se passe autour. Est-ce que vous avez eu spécifiquement à étudier cette situation comme garde des Sceaux ? Et si oui, qu’est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Éric Dupond-Moretti :
Non seulement je l’ai étudiée, mais j’ai laissé un projet de loi sur le bureau quand j’ai quitté la chancellerie. Qui prévoyait notamment la création du parquet national anti-criminalité organisée. Et qui prévoyait un statut du repenti que je suis allé chercher en Italie. Je me suis inspiré des Italiens parce qu’on sait que s’il n’y a pas Tommaso Buscetta, il n’y a pas le procès de Palerme. Il va permettre la condamnation de Totò Riina et d’un millier de mafieux.
Donc je suis allé voir, précisément, à plusieurs reprises, comment on met les choses en place, qu’est-ce que l’on accepte, qu’est-ce que l’on n’accepte pas, quel est le type de contrat, quels sont les bénéfices pour le mafieux repenti, partant du principe que dans certains dossiers, on n’a pas l’ombre de l’once d’un renseignement et que la justice est obligée de se nourrir, évidemment, de telles informations. Ensuite, on a rajouté à ce texte un certain nombre de choses qui, pour certaines d’entre elles, ont été censurées par le méchant Conseil constitutionnel. Ça ne vous a pas échappé. Mon projet était un peu plus sage. C’est le qualificatif qui me vient à l’esprit, puisque je viens d’évoquer le Conseil constitutionnel.
Ces mesures-là, moi, je ne les portais pas. Il y avait essentiellement PNACO (Parquet national anticriminalité organisée), il y avait la refonte du régime des repentis … Voilà. Ensuite, oui, les prisons spécialisées, j’entends tout ça. Il faut aussi, on a le devoir de se protéger, évidemment, du narcotrafic qui a pris beaucoup d’ampleur. Mais moi, je veux redire quelque chose. Ce qui me chagrine le plus, c’est tous ces consommateurs-là. S’il n’y a pas de consommateurs, il n’y a pas de trafic. Dans les années 68, il n’y a pas ces règlements de comptes, là. Mais chaque fois que ces types fument un pétard, ils devraient quand même penser qu’à la clef, il y a des gamins dont le sang va couler sur le trottoir. C’est une réalité, ça, quand même. Certains sont pour la légalisation. C’est une catastrophe. Au Canada, ils ont légalisé. Vous circulez dans les rues de Montréal à 22 h, ça pue le shit. Mais les organisations criminelles font autre chose maintenant. Elles exportent de la cocaïne vers les États-Unis. On n’a rien gagné. Enfin, ils n’ont rien gagné. De mon point de vue, si je puis me permettre d’avoir cette analyse, j’ai lu un rapport des autorités canadiennes. Moi, je suis tout à fait contre la légalisation. Mais dans le système actuel, c’est quand même les consommateurs qui sont là samedi soir, peinards. C’est la détente après le travail. Mais enfin, derrière, il y a des morts. Il faut quand même le redire, ça.
L’AFD, l’amende forfaitaire délictuelle, moi je pense qu’elle doit être appliquée. Tant qu’on aura des consommateurs, on aura des trafiquants. Donc moi, je veux bien qu’on se décarcasse. Nouvelles prisons, haute sécurité, tout ça me paraît important et nécessaire. Nouvelles législations, oui. Enfin, on peut aussi regarder du côté des consommateurs et tenter de les responsabiliser. Alors je sais, quand on dit : « Moi, je suis contre la légalisation du shit », on passe pour un affreux ringard, un affreux réac. Mais voilà, la réalité, c’est quand même celle-là. Très pragmatique : s’il n’y a plus de consommateurs, il n’y a plus de trafiquants.
Jean-Louis Bourlanges :
Je dois dire que cette émission est quand même assez remarquable, parce qu’on a invité quelqu’un qui a été la bête noire absolue de la magistrature quand il a été nommé, et qui est aujourd’hui, dans la classe politique française, l’un des plus déterminés défenseurs de la noblesse, de la grandeur du métier de magistrat. Donc, je ne sais pas si c’est un progrès, mais en tout cas, c’est un paradoxe qui mérite d’être souligné, et qui, je crois, montre que les critiques dont vous avez été l’objet manquaient singulièrement de nuances et d’équilibre.
Éric Dupond-Moretti :
Dans mon spectacle, je tape (fort) sur ceux qui m’ont fait du mal, mais je les nomme et je dis pourquoi je suis amené à régler mes comptes. Mais je ne vise pas tout le monde. Ce qui m’est insupportable, c’est la globalisation. C’est vrai qu’on dit « les journalistes ». Non, la justice, c’est d’abord la signature de ceux qui la rendent. Donc, il y a des types formidables dans la magistrature. Il y a des types qui sont nuls. Au barreau, c’est exactement la même chose. Chez les journalistes, etc. Une espèce de globalisation : « la décision de justice est antidémocratique ». Regardons une seconde, Mme Le Pen, c’est toujours bien de conclure par là où on a commencé. C’est une bonne règle rhétorique. Mais enfin, cette magistrate qui préside, d’abord, c’est une décision collégiale. On a cité son nom, elle a été physiquement menacée, mais c’est une honte. Comme d’ailleurs dire publiquement que telle décision n’est pas à la hauteur des enjeux.
Jean-Louis Bourlanges :
Il faut dire qu’elle a présenté sa décision de façon un peu singulière.
Éric Dupond-Moretti :
Qu’on n’adhère pas à la décision, très bien. Moi, je n’ai pas un regard agiographique de tout ce qui se fait dans la magistrature. Mais là, on est allés très très loin. On a tout globalisé. Bon, de la même façon, les types qui commentent des décisions de justice, qui n’ont jamais mis un pied dans un palais de justice, qui n’ont même pas lu les procès-verbaux, ils n’y ont pas eu accès — je pense aux jeunes qui ont été condamnés après les émeutes. Enfin, on est dans la surenchère permanente. Vous voyez, moi, un gamin qui rentre dans un Foot Locker, qui pique un maillot du Paris Saint-Germain, ou d’une autre équipe d’ailleurs, c’est un petit con qui mérite d’être condamné, mais c’est pas un barbare. On ne peut pas être dans la surenchère permanente. Parce que ça, ça va finir par tuer notre démocratie.
Jean-Louis Bourlanges :
De toute façon, « barbare » est un nom malheureux, parce que ça désigne l’étranger. C’est celui qui ne parle pas notre langue.
Éric Dupond-Moretti :
Exactement. D’ailleurs, celui qui avait utilisé cette expression avait dit : « Allez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. » Moi, j’y suis allé. Et on a, chez les Grecs, chez les Romains, des étrangers ; chez les catholiques aussi. Alors, est-ce que ça a été utilisé par hasard ? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça fait beaucoup de mal. Parce que si un gamin qui vole dans des conditions insupportables, et qui casse une vitrine, et tout ça, on ne peut pas être d’accord avec ça. Moi, je n’ai pas envie de me faire casser la vitre de ma bagnole ou de me la faire brûler. Mais enfin, un barbare, c’est quelqu’un qui commet des actes de barbarie. D’abord, soyons d’accord sur les mots.