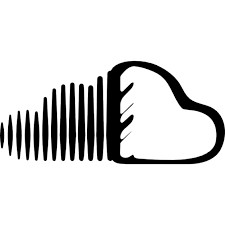« GEORGES POMPIDOU L’INTEMPOREL » AVEC JÉRÉMIE GALLON
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
En 1969 Georges Pompidou s’interrogeait sur la place que pourrait conserver la France dans l’avenir du monde et de la société et dans Georges Pompidou, l’intemporel, vous montrez qu’il n’a cessé de se battre pour maintenir la capacité de la France à rester maîtresse de son avenir. Pour lui, cette maîtrise de l’avenir ne pouvait se réduire à la quête du bien-être matériel. Ni le progrès technique, ni la hausse du niveau de vie ne pouvaient suffire à donner du sens à une nation. L’homme, écrivez-vous, a besoin d’une espérance collective, d’un horizon moral et politique.
Vous expliquez aussi que Pompidou avait saisi la portée des bouleversements de Mai 68. C’était pour lui le signe avant-coureur d’une transformation profonde : l’effondrement des grandes structures d’encadrement (la famille, Église, patrie) annonçant une société d’individus livrés à eux-mêmes. Il redoutait que ce désengagement moral, combiné à une domination croissante de la science et de la technique, crée un vide politique et ouvre la voie à l’autoritarisme. Une intuition qui résonne fortement aujourd’hui. Mais vous montrez que Pompidou n’était pas un nostalgique. Il voulait moderniser la France, encourager l’innovation et l’industrialisation, mais sans jamais renoncer à la culture ni à l’exigence morale. Il appelait les Français à regarder en face leurs fragilités, non pour s’en plaindre, mais pour retrouver leur ambition. Pourtant, à la fin de sa vie, marqué par la maladie, il semble frappé par une inquiétude plus intime : et si, après avoir échappé à l’effondrement de 1940 et à la guerre civile de 1958, la France avait renoncé à la grandeur ?
À travers votre livre, vous dessinez le portrait d’un homme d’État dont l’héritage interroge notre époque. Vous insistez sur son autorité morale, sa culture, son enracinement hors des grandes machines technocratiques. Pompidou, selon vous, incarne une époque où la politique pouvait encore être portée par ceux qui avaient le désir de servir et l’ambition d’élever leurs concitoyens.
Vous soulignez aussi combien Pompidou attachait de l’importance à l’autorité politique fondée sur la culture, la responsabilité, et la compréhension du peuple. L'époque paraît si éloignée de cette conception et de cette réalité de l'autorité, la défiance envers les élites et la fragmentation démocratique sont si grandes que la première question qu'on est amené à vous poser en reprenant votre titre c'est : « Georges Pompidou l'intemporel », ne serait-ce pas un oxymore ?
Kontildondit ?
Jérémie Gallon :
Vous avez mis en lumière plusieurs aspects de Georges Pompidou qui ont nourri mon travail et que j’ai découverts au fil de l’écriture. Ce qui m’a conduit vers lui, c’est la promesse qu’il incarne, longtemps au cœur du pacte républicain et aujourd’hui menacée : celle d’un enfant d’origine modeste — fils d’instituteur du Cantal, petit-fils de paysan — qui, grâce à ce que Marc Fumaroli appelait une « musculation morale et intellectuelle », gravit l’ascenseur social et parvient à influer sur le destin de la France.
À la question de savoir si Georges Pompidou est l’antithèse des figures politiques actuelles, il ne s’agit pas de dresser un tableau nostalgique ou de prétendre qu’il n’existe plus aujourd’hui de responsables dotés d’une colonne vertébrale morale et intellectuelle. Le vrai sujet est ailleurs : permet-on encore à des figures construites hors de la politique, ayant eu plusieurs vies avant d’y entrer, d’accéder aux plus hautes fonctions ? Ou bien évolue-t-on dans un système où les professionnels de la politique, les apparatchiks, dominent le jeu, au prix de barrières à l’entrée de plus en plus nombreuses ? Parmi elles, une exigence de transparence bien légitime, mais devenue une hyper-transparence, voyeuriste et robespierriste, qui dissuade les personnalités dotées d’une véritable densité intellectuelle de s’engager. C’est une question collective à laquelle il faut répondre.
Nicolas Baverez :
Le sous-titre n’est-il pas trompeur ? Georges Pompidou, n’était-ce pas plutôt « l’incompris » que « l’intemporel » ? Pour deux raisons. D’abord, c’était un homme très secret. Et il y a très peu de figures en France qui, comme lui, aient été à la fois hommes d’État, hauts fonctionnaires, hommes d’affaires à succès, hommes de lettres et amateurs d’art. Cette palette est proprement exceptionnelle.
Par ailleurs, on continue souvent à le percevoir comme une parenthèse entre le général de Gaulle et Valéry Giscard d’Estaing. Or, si la Vème République a battu tous les records de longévité de nos régimes politiques, c’est en grande partie grâce à lui. Il a réussi ce que Guizot avait manqué avec la monarchie constitutionnelle, et Émile Ollivier avec l’Empire libéral : réconcilier stabilité politique, liberté et développement économique.
Jérémie Gallon :
Être intemporel n’empêche pas d’être incompris. Pompidou l’est, parce qu’il incarne des qualités et une vision politique qui restent pertinentes à toutes les époques. Il portait une matrice intellectuelle et institutionnelle solide, encore opérante aujourd’hui. Là où je vous rejoins, c’est sur la manière dont son action a souvent été caricaturée. On s’est arrêté à quelques phrases, à quelques épisodes. On a voulu le réduire à un simple héritier du général de Gaulle, en politique intérieure comme en politique étrangère. Or, il est bien plus que cela. Certes, il s’est construit auprès du général de Gaulle, qu’il sert dès septembre 1944, à l’âge de 33 ans. Il est façonné par lui, intellectuellement et institutionnellement. Mais il sera capable, non pas de rompre, mais d’introduire de vraies inflexions. Je fais le parallèle avec Mazarin face à Richelieu.
Quant à la Vème République, vous touchez un point fondamental. Un des grands legs de Georges Pompidou, c’est d’avoir ancré durablement ses institutions. Quand le général de Gaulle quitte le pouvoir le 28 avril 1969, une grande incertitude plane : ce régime, tenu jusque-là par la seule autorité du général, va-t-il lui survivre ? La force de Pompidou, c’est d’avoir su passer d’une légitimité charismatique à une légitimité démocratique.
Mais cela ne relève pas du hasard. Sa vision institutionnelle s’est construite dans la durée. Si l’on avait voulu former un homme d’État doté d’une colonne vertébrale institutionnelle, on ne s’y serait pas mieux pris. À partir de 1944, il se forme auprès du général de Gaulle, qui a déjà une vision claire, exprimée notamment dans le discours de Bayeux en 1946. De 1947 à 1953, il siège au Conseil d’État, où il acquiert les fondements du droit public. Puis, en 1958, en tant que directeur de cabinet du général de Gaulle, il participe directement à l’élaboration de la Constitution. Dès lors, aucune question clef ne lui échappe.
Nicolas Baverez :
Et pas seulement. Il y a aussi toute la politique économique, la politique monétaire, avec M. Pinay hostile au nouveau franc.
Jérémie Gallon :
Tout à fait. Ensuite, il est nommé au Conseil constitutionnel. Lorsqu’il devient Premier ministre en 1962, puis président de la République en 1969, son attachement à la Vème République est profond, parce qu’elle apporte deux éléments que les régimes précédents n’avaient pas su garantir : la stabilité et la souplesse institutionnelle. Il fera tout pour les ancrer durablement.
En 1969, un débat national reste ouvert : la Vème République survivra-t-elle au départ du général de Gaulle ? Or en 1974, lors du débat présidentiel entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand, cette question a disparu. La pérennité du régime n’est plus en cause.
Lucile Schmid :
Votre livre est d’autant plus fort que vous l’organisez en chapitres thématiques. Ce n’est pas une simple chronologie de la vie de Georges Pompidou, mais une série de chapitres : « rue d’Ulm », « modernisateur », « poésie », « De Gaulle », « Léopold Sédar Senghor » qui permettent d’embrasser les multiples facettes de sa personnalité. C’est très réussi.
Je voulais vous interroger sur son goût pour la poésie. Vous venez de dire qu’il faudrait donner accès à des profils différents en politique, mais celui que vous décrivez est tout de même très singulier dans ses talents, sa manière d’être, ce caractère auvergnat que vous soulignez souvent. Vous racontez notamment cette anecdote de 1969, au moment où il prépare sa candidature : lors d’une soirée, il devait prononcer un discours sur le lien entre poésie et politique. Et il connaissait par cœur un grand nombre de poèmes. C’est tout de même peu banal.
Alors, peut-on vraiment parler d’un lien entre poésie et politique ? S’agit-il de deux univers parallèles, ou bien interagissent-ils réellement ? Peut-on faire de la poésie en politique quand on est aujourd’hui président de la République ? Emmanuel Macron, en 2019, a dit se sentir proche de Pompidou, peut-être justement dans ce rapport à la culture ou à la littérature. Mais ce que vous décrivez là est d’un tout autre ordre.
Jérémie Gallon :
Chez Georges Pompidou, la culture n’est jamais exhibée. Il en a un rapport pudique, intime. Henry Kissinger disait de lui que c’était un être « suprêmement cultivé », mais il n’en faisait jamais étalage. La culture est d’abord un immense plaisir personnel. Elle l’accompagne depuis sa jeunesse, dans tous les moments de sa vie. Elle est parfois un refuge, mais toujours présente : la poésie, bien sûr, mais aussi la peinture — il est un grand amateur d’art moderne et contemporain — l’opéra, voire la mode, à laquelle Claude Pompidou l’avait initié. Sa curiosité intellectuelle est constante, profonde. En cela, il incarne un esprit européen au sens le plus noble.
Mais la poésie le façonne au quotidien. Il aimait en réciter seul, notamment en voiture, ou le week-end, à Orvilliers, devant son fils. Contrairement à Léopold Sédar Senghor, artisan et auteur de littérature, Pompidou ne cherche pas à écrire une œuvre. Il est un jouisseur de la littérature, elle nourrit sa réflexion politique. Cela se manifeste dans des épisodes précis : on se souvient de sa réponse, lors d’une conférence de presse, à propos du destin tragique de Gabrielle Russier, où il cite Paul Éluard ; ou encore, lors d’un débat constitutionnel avec François Mitterrand en 1964, où il le renvoie dans ses cordes en citant Scarron, parodiant Virgile — preuve d’une culture littéraire très affûtée.
Même son rapport à l’urbanisation, à l’architecture, est imprégné de poésie. Il est profondément influencé par Baudelaire, notamment dans sa réflexion sur l’atomisation de la société et la solitude de l’homme moderne. En 1967, lors d’un colloque à Nice, il évoque Baudelaire pour traiter de cette question. Le Monde l’avait d’ailleurs surnommé « le banquier baudelairien ».
Les arts nourrissent sa vision politique et lui permettent d’anticiper certaines évolutions sociétales. En mai 1968, il comprend plus vite que les autres la nature du mouvement. Parce qu’il s’est nourri d’art contemporain, de cinéma — notamment celui de Godard — il perçoit qu’il ne s’agit pas seulement d’une éruption sociale ou d’un caprice de jeunesse, mais d’un malaise civilisationnel. C’est ce qui lui permet de prononcer, le 14 mai à l’Assemblée nationale, un discours remarquable, qui prend de la hauteur sur les événements. Donc oui : chez Georges Pompidou, il existe un lien profond entre poésie, arts et politique.
Philippe Meyer :
Il y a une chose sur laquelle je me suis toujours interrogé, à propos de la référence à Paul Éluard lors de la conférence de presse où une question lui est posée sur l’affaire Gabrielle Russier. En réalité, la question était préparée, et la réponse aussi. Jean-Michel Royer, le journaliste, s’était mis d’accord en amont — difficile de dire qui a pris l’initiative. Mais cela interroge, à la lumière de ce que Lucile vient de soulever. N’est-ce pas une instrumentalisation de la littérature ? Est-ce une manière, dans la mise en scène de la communication politique, de placer le personnage « au-dessus » ? Mitterrand excellait dans cet exercice, multipliant les références littéraires, artistiques, pour construire une figure distanciée, presque surplombante. Est-ce que Pompidou fait la même chose ? Est-ce une ruse de communication ?
Jérémie Gallon :
Georges Pompidou est profondément structuré par la culture, au plus intime de lui-même. Ce n’est pas une façade, ce n’est pas une posture. Pour autant, ce n’est pas non plus « M. Smith au Sénat » : c’est un vrai politique. Il sait qu’il a cet atout — cette culture exceptionnelle — et il est capable de s’en servir. Il l’assume comme une ressource dans le jeu politique. Mais il y a, dans sa manière de l’utiliser, une forme d’authenticité qui ne trompe pas. Lorsqu’il répond à la question en citant Éluard, même si tout a été préparé en amont, l’émotion passe. Et cette émotion ne pourrait pas exister s’il ne croyait pas profondément à ce qu’il dit.
Matthias Fekl :
Il y a une phrase de Pompidou que vous citez et qui me semble résumer admirablement l’homme : « je suis de ceux qui pensent que dans 50 ans, la fortune consistera à pouvoir s’offrir la vie du paysan aisé du début du XXème siècle, c’est-à-dire de l’espace autour de soi, de l’air pur, des œufs frais, des poules élevées avec du grain, etc. ». On y ajoute des piscines et des automobiles, mais ce n’est pas une modification fondamentale, il reste le besoin d’air, de pureté, de liberté, de silence.
Au-delà de cette formule, il y a dans votre livre de très belles pages sur son rapport au bonheur, à la liberté, et sur cette dialectique qui a structuré sa vie : le désir d’être un homme heureux, un homme libre, et, en même temps, celui de participer à l’écriture de l’Histoire. J’aimerais vous entendre sur la manière dont il a réussi, ou non, à conjuguer ces tensions — à concilier sa passion pour l’art, la littérature, l’amitié, l’amour qu’il portait à son épouse Claude, et de l’autre côté, les contraintes, les exigences et les aspérités de la vie politique.
Jérémie Gallon :
Ce que vous décrivez est sans doute ce qui m’a le plus touché chez Georges Pompidou : cet attachement profond à ce qui fait le bonheur de la vie — l’amitié, la famille, son épouse. C’est pour cela qu’il souffrira tant lors de l’affaire Marković, qui touche à son intimité. C’est un homme sensible, un épicurien, un jouisseur au sens noble du terme, qui a connu des moments de liberté et de bonheur total, notamment lorsqu’il enseignait à Marseille. Jeune couple avec Claude, ils parcouraient la Provence, allaient de village en village, se nourrissaient de littérature, d’expositions, de vie.
Mais il y a aussi une ambition profonde. Contrairement à ce qu’aurait peut-être souhaité Claude, il ne se contente pas de cette existence. Il sent qu’il est appelé à un destin. Pas nécessairement à exercer les plus hautes fonctions, mais à jouer un rôle dans l’histoire de France, à servir. Cette tension entre bonheur privé et engagement public constitue sans doute le cœur de sa trajectoire. Il ne renonce jamais à l’un pour l’autre, et c’est ce qui rend son parcours si poignant. Lorsqu’il accède au pouvoir, il éprouve la satisfaction de peser sur les choses. Il le dit lui-même : s’il rejoint de Gaulle après la guerre, c’est pour « refaire la France ». Mais très vite, il découvre que le sommet du pouvoir se vit en marge du bonheur.
Il ressentira ce contraste jusqu’au bout. Ce qui me touche particulièrement, c’est que, même à l’Élysée, son humanité reste intacte. Là où d’autres figures politiques s’endurcissent, deviennent cyniques, voire desséchées, Georges Pompidou conserve son âme. Le contraste avec le général de Gaulle est éclairant. Sans le caricaturer, on peut dire que leur rapport à la raison d’État différait. De Gaulle répétait à Pompidou : « soyez dur, Pompidou, soyez dur. » Mais cette dureté n’était pas dans sa nature. Chez lui, il y a toujours eu une humanité, une forme de tendresse, qui ne l’a jamais quitté.
Matthias Fekl :
Les pages que j’évoquais, et dont vous parlez, devraient être lues par tous ceux qui veulent se lancer en politique — pour le faire en connaissance de cause, en sachant à quoi ils s’engagent — mais aussi par ceux qui passent leur vie à dénigrer les femmes et les hommes engagés.
Vous montrez, de manière très percutante, ce que signifie vraiment l’engagement : les sacrifices, les contraintes, tout ce qu’on perd … Et aussi, bien sûr, ce qu’on apporte.
Marc-Olivier Padis :
On a bien compris que votre livre relève en partie d’un exercice d’admiration. Vous êtes très élogieux à l’égard de Georges Pompidou, et on vous suit volontiers. Lucile a déjà évoqué la construction thématique de l’ouvrage, que j’ai trouvée particulièrement intéressante : il y a une vraie progression, même si elle n’est pas chronologique. On sent que vous avez longuement réfléchi à cette architecture.
J’aimerais apporter une note un peu plus critique. Ce que je trouve le plus intéressant chez Pompidou, c’est justement cette manière de sortir du gaullisme tout en consolidant son héritage. Vous en avez parlé à propos des institutions, mais cela vaut aussi pour la langue : il fallait sortir du grand style épique du général de Gaulle, sans sombrer dans le jargon technocratique. Pompidou parvient à une forme de simplicité maîtrisée, conquise sur une richesse de rapport à la langue.
Je voudrais revenir sur Mai 68, avec une lecture un peu différente de la vôtre. Vous avez évoqué sa capacité à prendre de la hauteur, mais je ne suis pas certain que ce soit le bon terme. Quand il parle de crise de civilisation, j’ai plutôt le sentiment qu’il noie le sujet. Ce n’est pas de la hauteur, c’est une sorte d’évaporation. Vous avez dit qu’il avait anticipé, mais justement, non. C’est un homme qui mise sur le développement économique, l’industrialisation, mais qui ne voit pas que cela exige aussi un effort massif en matière de formation. Certes, il parle de formation technique, mais il ne mesure pas ce que signifie, concrètement, l’arrivée massive de bacheliers à l’université. Or, cette population étudiante nouvelle a des conditions de vie, des attentes, une politisation que personne, y compris lui, n’a anticipées. Pompidou, normalien, khâgneux, n’a jamais connu l’université. Il n’en comprend ni les dynamiques ni les mutations. Et donc, il y a là une forme d’angle mort. Ce n’est pas une critique injuste ou excessive — tous les responsables ont leurs angles morts. Mais alors, justement : où se situe celui de Pompidou ?
Jérémie Gallon :
Il a bien sûr ses angles morts, comme tout dirigeant, mais je ne les situerais pas nécessairement là où vous les placez. Le discours du 14 mai 1968 vise, en effet, à prendre de la hauteur, mais il faut le replacer dans un contexte plus large. Ce qui est remarquable, c’est que Pompidou combine cette capacité à conceptualiser la crise avec une gestion extrêmement fine et pragmatique. Dans les heures qui précèdent et qui suivent ce discours, c’est le renard de Machiavel : il apaise, bâtit des alliances, empêche la jonction entre le mouvement étudiant et le Parti communiste. Il gère la crise avec efficacité, notamment lors des accords de Grenelle. C’est lui qui tient la barre, puisque le général de Gaulle part en Roumanie. Aux yeux des Français, c’est le moment où il apparaît comme son successeur naturel. Il incarne alors pleinement l’homme d’État : capable de hauteur, mais aussi de maîtrise opérationnelle.
Sur son rapport à la modernité, l’idée qu’il aurait défendu une modernisation déshumanisée me semble injuste. Sous sa présidence, de grandes réformes économiques ont été menées, accompagnées de réformes sociales majeures : mensualisation des salaires, réforme des retraites, mise en place d’allocations pour les personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité, entre autres — beaucoup portées par Jacques Chaban-Delmas.
Concernant l’éducation, je ne partage pas non plus votre analyse. Pompidou était lucide sur le risque d’une massification universitaire non maîtrisée, avec, en aval, une insertion professionnelle difficile. C’est pourquoi il a toujours soutenu activement l’apprentissage et l’enseignement professionnel. Il observait avec attention le modèle allemand, déjà à l’époque, et s’en inspirait. Son obsession était de faire de la France la première puissance industrielle européenne, plus compétitive que l’Allemagne. Il avait étudié ces questions de près, notamment chez Rothschild. A-t-il pu déployer toutes ses intentions ? Probablement pas. En porte-t-il seul la responsabilité ? Certainement pas.
Philippe Meyer :
Votre livre, comme le numéro que l’excellente revue Schnock a consacré à Pompidou, me semble frappé d’un même aveuglement : son action sur Paris. La destruction des pavillons de Baltard, la tour du commerce international à la place du pavillon de Ledoux, le projet de palais des congrès à la gare d’Orsay : tout cela relève d’une brutalité urbanistique inouïe. Pour quelqu’un qui fut conseiller d’État, ces procédés sont indécents. Cette absence totale de considération pour l’histoire et l’urbanité parisienne m’indigne encore. Louis Chevalier, son camarade normalien, avait tenté de l’alerter, dans une lettre bouleversante. Pompidou n’en a eu cure. Pourquoi avoir éludé cet aspect dans votre livre ? Et comment en justifiez-vous la violence ?
Jérémie Gallon :
Je vous attendais sur ce point, Philippe, connaissant votre amour pour Paris. J’évoque ce paradoxe dans les chapitres sur l’esthétique et la modernité : Pompidou est un homme épris de beauté, de littérature, d’art, et pourtant, ses années au pouvoir sont marquées par un enlaidissement urbain massif. Il ne s’agit d’ailleurs pas que de Paris, mais du territoire entier. Concernant la capitale, je ne crois pas qu’il ait été indifférent. Dans un entretien de 1972 au Monde, il défend une position nuancée sur les tours, par exemple celle de Montparnasse, qu’il critique pour son revêtement. Il sait que l’époque produit beaucoup de constructions très laides. Il assume la poursuite de projets comme La Défense ou Beaubourg, même s’ils suscitent des critiques. Je n’approuve pas toutes ces décisions, mais il y avait une ambition derrière.
Philippe Meyer :
Les Halles ne sont pas un projet culturel, c’est un centre commercial pur et simple. Pas un mètre carré pour la culture. Ce n’est pas simplement une affaire d’architecture, c’est un problème d’urbanisme, de compréhension de ce qu’est une ville comme Paris, de son histoire et de ce qu’elle impose comme responsabilité. Louis Chevalier, historien de Paris mais aussi homme du terrain, l’avait parfaitement compris. Ce que Pompidou a fait à Paris est un crime contre l’urbanité, que personnellement, je ne peux pas pardonner.
Jérémie Gallon :
Il espérait faire du quartier allant du plateau Beaubourg jusqu’aux Halles un espace culturel majeur — ambition qu’il exprime explicitement dans cet entretien. Même si, comme vous le rappelez, en 1972 les Halles sont déjà détruites. Je ne nie pas les échecs ni la brutalité de certaines réalisations. Mais je crois qu’il y avait tout de même une pensée, une réflexion sur la ville, l’art, l’architecture. Elle s’est parfois mal traduite dans les faits, mais elle existait.
Nicolas Baverez :
Vous avez choisi de mettre en exergue de votre livre un extrait du discours de Soljenitsyne à Harvard, « Le déclin du courage », qui date de 1978, donc postérieur à la mort de Georges Pompidou. Ce choix est intéressant, d’autant plus que, le soir même de sa disparition, c’est aussi sur le courage que revient François Mitterrand, pourtant l’un de ses grands adversaires, lorsqu’il lui rend hommage. Il insiste sur cette qualité, le courage, qui est chez Pompidou à la fois central et paradoxal.
On lui a beaucoup reproché, notamment chez les gaullistes, de ne pas avoir été résistant. Jusqu’en 1967, il a eu une trajectoire plutôt protégée. Mais à partir de cette date, les épreuves s’enchaînent : la crise de 1968, l’affaire Marković, la succession difficile du général de Gaulle, une société française travaillée par une violence que l’on a aujourd’hui tendance à sous-estimer, et bien sûr, la maladie. D’où ma question : pourquoi ne pas avoir fait du courage l’entrée principale de votre portrait de Georges Pompidou ?
Et puis il y a un deuxième aspect dans cette référence à Soljenitsyne : sa vision anticipatrice de la crise des sociétés occidentales. Les extraits du Nœud gordien que vous citez sont impressionnants — ce texte date de l’automne 1968, en pleine secousse. Pompidou y écrit : « le fascisme n’est pas si improbable. Il est même, je crois, plus près de nous que le totalitarisme soviétique. À nous de savoir si nous sommes prêts à l’éviter.»
Et puis il y a cette autre phrase : « quelqu’un tranchera le nœud gordien, et la question est de savoir si cela sera en imposant une discipline démocratique, garante des libertés, ou si quelque homme fort et casqué tirera l’épée d’Alexandre. » C’est une vision très sombre, très lucide aussi, du siècle qui s’ouvre — un siècle d’hommes forts et casqués.
Jérémie Gallon :
Sur la question du courage, c’est un thème que j’ai voulu laisser en filigrane tout au long du livre. Il traverse l’ensemble de son action, plus qu’il ne se cristallise dans un chapitre unique.
Effectivement, Georges Pompidou n’a pas été un résistant actif. Il parle lui-même de « résistant passif ». Et c’est un point essentiel. Dans la France de l’après-guerre, où la valeur des hommes est largement jugée à l’aune de leur comportement durant la Seconde Guerre mondiale, le fait que le général de Gaulle choisisse pour collaborateur le plus proche un homme qui n’a pas résisté est, en apparence, un paradoxe saisissant.
Mais ce paradoxe est révélateur. Je suis convaincu — même s’il ne l’a jamais exprimé directement — qu’il porte en lui une forme de dette intime. Non que son attitude pendant la guerre ait été médiocre ou déshonorante, mais elle n’était peut-être pas à la hauteur de l’homme qu’il voulait être. Et cette conscience-là va nourrir, après la guerre, son exigence personnelle, son besoin de servir, de se dépasser. Une forme de rattrapage intime, presque silencieux, mais constant.
La crise de la société occidentale est un autre point fondamental. Pompidou anticipe l’effondrement des grandes structures de référence — famille, Église, partis, patrie — parfois à juste titre remises en question, mais dont la disparition laisse l’individu sans repères. Il décrit ce glissement vers une société atomisée, privée de principes d’autorité et de responsabilité, livrant chacun à une forme de vertige. Et dans ce contexte, il identifie un danger majeur : la tentation de l’homme fort. Le risque autoritaire, pour lui, est bien plus proche que la menace soviétique. C’est là que se situe sa clairvoyance, et qu’il rejoint des figures comme Soljenitsyne ou même Kissinger.
À l’époque, l’obsession dominante est celle du totalitarisme soviétique. Lui, au contraire, considère que la politique de détente engagée par de Gaulle contient les germes de l’effondrement du système soviétique. Il a cette intuition très lucide : si les deux modèles — capitaliste et soviétique — s’ouvrent l’un à l’autre, le système soviétique, privé de libertés, changera le premier. Car Georges Pompidou avait une foi profonde dans la liberté. Et c’est cette conviction qui le rend moderne et visionnaire.
Lucile Schmid :
Ce qui est aussi passionnant dans votre livre, ce sont les portraits que vous dressez des autres figures politiques. Il ne s’agit pas seulement de Georges Pompidou, mais aussi de Jacques Chirac, de François Mitterrand, de Jacques Chaban-Delmas — un portrait d’ailleurs assez assassin, montrant comment Chaban incarne, au fond, toutes les qualités que Pompidou n’a pas : le charme, le goût du sport, le sens de la communication, l’enthousiasme pour l’idée de « nouvelle société ». Vous montrez bien comment l’inimitié entre les deux hommes naît de cette opposition de tempéraments autant que de visions.
Je voulais revenir sur la question européenne, et en particulier sur ce que vous racontez à propos d’Edward Heath. Il y a un passage très drôle dans le livre : on est à la veille d’un sommet au Royaume-Uni, chacun des deux hommes veut s’habiller de manière appropriée, Pompidou se demande s’il doit opter pour une tenue de sport ou un costume, en pensant qu’Heath sera en tenue décontractée ; de son côté, Heath choisit l’inverse pour la même raison … Et cette scène, un peu cocasse, finit par donner lieu à une forme de complicité, une relation presque amicale, où l’on voit que la politique européenne, à ce moment-là, passe aussi par une forme de lien humain. Vous montrez comment l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne a pu se construire sur cette relation personnelle. Mais vous expliquez aussi que cette ouverture européenne, qui aurait pu être un grand moment pour Pompidou, va se solder par une forme d’échec. Il organise un référendum sur l’entrée du Royaume-Uni, mais la participation est très inférieure aux attentes, les oppositions cherchant à l’affaiblir en appelant à l’abstention. Et c’est un peu le rêve brisé : Pompidou, le grand européen, confronté à une adhésion britannique qui ne tiendra pas ses promesses. D’autant qu’Edward Heath sera bientôt évincé par Margaret Thatcher au sein des conservateurs, et que son « Europe puissance » laissera place au « I want my money back ». Ce moment de convergence franco-britannique que vous décrivez si finement s’évanouit alors. Pourriez-vous revenir sur cet épisode et sur ce qu’il dit, selon vous, de la vision européenne de Pompidou ?
Jérémie Gallon :
Pour comprendre que Georges Pompidou n’est pas simplement l’héritier du général de Gaulle, la question européenne est en effet centrale. En 1972, dans un discours prononcé pour le centenaire de Sciences Po, il déclare : « la France est une puissance moyenne typique. » Il faut du courage, lorsqu’on se réclame de l’héritage gaullien, pour assumer une telle affirmation. Et la conséquence qu’il en tire, c’est que, si la France veut rester actrice de l’histoire, elle n’a pas d’autre choix que de s’engager pleinement dans la construction européenne.
Sa vision est celle d’une Europe des États-nations. Faire entrer le Royaume-Uni, c’est ancrer ce projet dans un cadre non fédéral, en intégrant un pays profondément attaché à sa souveraineté. C’est aussi, dans le contexte de l’époque, une manière de renforcer l’Europe occidentale, seule partie du continent libre de la domination soviétique. Pour atteindre une masse critique et peser sur la scène mondiale, il faut y inclure le Royaume-Uni. La relation personnelle avec Edward Heath joue ici un rôle fondamental. Elle contraste avec la mauvaise entente qu’il entretient avec Willy Brandt. Même s’il reste conscient de l’importance stratégique du couple franco-allemand, Pompidou sait s’appuyer ailleurs quand les affinités personnelles manquent, et c’est aussi ce qui fait de lui un homme d’État : sa capacité à ne pas laisser les relations personnelles compromettre les équilibres fondamentaux de la politique étrangère.
On a souvent voulu opposer ce choix d’ouvrir la porte au Royaume-Uni à l’héritage gaulliste, y voyant une rupture, voire une trahison. Je crois qu’il faut nuancer. Le général de Gaulle a opposé deux vétos à l’adhésion britannique, mais ce n’était pas sur des bases idéologiques. Il estimait que l’Europe communautaire n’était pas encore assez solide pour accueillir un pays économiquement affaibli comme l’était alors le Royaume-Uni. Peu avant de quitter le pouvoir, dans un entretien avec Christopher Soames, il dit clairement que si l’économie britannique se redresse, les conditions finiront par être réunies. Pompidou fait ce constat quelques années plus tard et en tire les conséquences.
Il faut aussi rappeler un aspect souvent oublié : vu des États-Unis, l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne n’allait pas du tout de soi. Il y a alors un intense lobbying de la part de grandes entreprises, du département du Trésor, de l’Agriculture, pour convaincre la Maison-Blanche — Nixon et Kissinger — de s’y opposer. Ces acteurs redoutaient que l’Europe devienne un monstre économique capable de concurrencer les États-Unis sur tous les plans.
Quand on regarde cela avec le recul, on ressent une certaine mélancolie en constatant le décrochage économique de l’Europe actuelle. Mais cela remet aussi en perspective l’ambition qui animait Pompidou à cette époque. Et c’est à l’honneur de Nixon et Kissinger d’avoir compris qu’il ne fallait pas contrer ce mouvement, mais le laisser se faire, au nom d’une certaine idée de l’équilibre mondial.
Matthias Fekl :
Je voudrais rester sur l’Europe et revenir sur le franco-allemand, que vous avez évoqué brièvement. On a le sentiment que, sur ce point, Georges Pompidou reste un président classique : il connaît l’importance stratégique de l’axe franco-allemand dans la construction européenne, mais il ne s’en empare pas avec la même intensité ou la même créativité que certains de ses successeurs. Il n’y a pas vraiment d’atomes crochus avec Willy Brandt, qui, en Allemagne, incarne pourtant une figure politique majeure. Vous évoquez dans votre livre une forme de méfiance de Pompidou à l’égard de l’Ostpolitik, cette politique d’ouverture à l’Est, d’apaisement, dont l’image la plus forte est celle de Brandt s’agenouillant au ghetto de Varsovie. On a un peu l’impression que les deux hommes se croisent sans se rencontrer. Et que, durant la présidence de Pompidou, il n’y a pas de grandes initiatives marquantes sur le plan franco-allemand. Ce sont plutôt ses successeurs — Valéry Giscard d’Estaing, puis François Mitterrand — qui, eux, impulseront des gestes forts, des initiatives emblématiques, et donneront au monde des images symboliques durables. Je serais curieux de vous entendre là-dessus : comment comprenez-vous cette réserve ou prudence de Pompidou sur le franco-allemand ? Est-ce simplement une question de tempérament, d’antipathie réciproque avec Brandt, ou y a-t-il une dimension politique plus structurelle dans cette distance ?
Jérémie Gallon :
Georges Pompidou et Willy Brandt « passent l’un à côté de l’autre », je trouve que cette expression résume très bien leur relation. D’abord, il y a une inimitié personnelle réelle. Il n’y a jamais eu entre eux de lien de confiance. Pompidou le dit très clairement : « qui est cet homme, Brandt ? Devant moi, il dit qu’il est d’accord, et puis derrière, il fait exactement le contraire. » Ce déficit de confiance contraste avec la relation qu’il peut entretenir avec Edward Heath ou d’autres dirigeants.
Ensuite, le contexte international a évolué. Le général de Gaulle avait amorcé une politique de détente, dans laquelle la France était, selon les mots de Pompidou, « seule sur l’autoroute de la détente ». Or, soudain, les États-Unis de Nixon et la RFA de Willy Brandt s’engagent à leur tour dans cette voie. Brejnev, habilement, exploite les rivalités entre ces trois puissances, ce qui rend la position française plus délicate.
Il y a aussi, chez Pompidou, une crainte sérieuse : que Brandt ne fasse trop de concessions à Moscou et que l’on aboutisse à une « finlandisation » de l’Allemagne, autrement dit une perte d’autonomie au profit de l’Union soviétique. Derrière cela, une inquiétude plus large affleure : la peur d’un condominium américano-soviétique sur l’Europe.
Enfin, il y a des considérations de puissance. Pompidou veut faire de la France la première puissance industrielle européenne. Il le dit très clairement à Alain Peyrefitte. Et ce dessein s’inscrit dans une forme de rivalité assumée avec l’Allemagne. Or, il constate avec irritation que les échanges économiques entre la RFA et l’URSS sont bien plus importants que ceux entre la France et l’URSS. Cela nourrit une forme de frustration, voire de jalousie, vis-à-vis de Willy Brandt.
Donc effectivement, sous Pompidou, il n’y a pas ce binôme franco-allemand au sommet que l’on retrouvera avec Giscard-Schmidt ou Mitterrand-Kohl. Mais il faut tout de même souligner que malgré cette distance personnelle, Pompidou veille à ce qu’un dialogue régulier se poursuive aux échelons intermédiaires — entre administrations, entre diplomaties, parfois même entre sociétés civiles. Et c’est une leçon : si l’alchimie personnelle ne peut jamais être garantie, il reste du devoir des dirigeants de préserver les structures de dialogue.
Marc-Olivier Padis :
Je voudrais revenir sur la question institutionnelle. Vous dites que l’un des grands mérites de Pompidou, c’est d’avoir stabilisé la Vème République. Vous y consacrez d’ailleurs un chapitre, qui est particulièrement intéressant dans le contexte politique actuel, notamment en ce qui concerne le débat sur le caractère présidentiel ou parlementaire du régime. Ce qui frappe, c’est que Pompidou adopte une lecture résolument présidentielle de la Vème République. C’est d’ailleurs lui qui, en 1968, conseille au général de Gaulle de dissoudre l’Assemblée et mène la campagne qui donne une majorité écrasante aux gaullistes. Et pourtant, malgré ce succès, de Gaulle le remercie. Une décision très dure pour Pompidou. Et lui-même, lorsqu’il est président, agira de la même manière avec Jacques Chaban-Delmas. Malgré une majorité parlementaire confortable, il lui signifie que c’est terminé. Dans les deux cas, la logique présidentielle prévaut sur toute autre considération.
Mais cela fonctionne à l’époque parce qu’il y a une majorité parlementaire nette. Ce que l’on découvre aujourd’hui, avec l’éclatement des forces politiques, c’est que sans majorité à l’Assemblée, le régime ne reste plus vraiment présidentiel : il se transforme, de fait, en régime parlementaire. Ce retournement, eux ne l’avaient pas anticipé — sans doute parce qu’il leur paraissait inconcevable, compte tenu du mode de scrutin, qu’un président puisse ne pas disposer d’une majorité claire.
Cela dit, on voit aussi chez Pompidou une certaine limite dans son rapport au Parlement. Il n’a jamais été sénateur, même s’il a été député du Cantal, à Saint-Flour. Dans votre chapitre sur la Cinquième, vous montrez qu’il accorde tout de même une certaine place au Parlement. Mais si je simplifie, cela revient un peu à dire : « c’est bien que les parlementaires délibèrent, cela les aide à s’approprier nos décisions ». Il y a là une conception très verticale, très descendante, du pouvoir.
Jérémie Gallon :
Il est indubitable que Georges Pompidou tient à la prééminence présidentielle. Pour lui, c’est l’un des piliers de la Vème République, et il veille à en préserver l’équilibre lorsqu’il consolide les institutions. Le cœur du malentendu avec Jacques Chaban-Delmas se joue dès le début : en prononçant son discours sur la « nouvelle société », Chaban s’inscrit dans une posture quasi présidentielle, renouant avec le style des présidents du Conseil de la IVème République. Or cela est inacceptable pour Pompidou.
Pour autant , il ne conçoit pas un régime strictement présidentiel. Il défend au contraire l’hybridité de la Cinquième. À ceux qui lui suggèrent d’aller vers un système à l’américaine, il oppose une formule frappante : « les corniauds sont souvent plus intelligents que les chiens de pure race ». Il voit dans le semi-présidentialisme un équilibre fécond.
Concernant le Parlement, il y a chez lui un respect réel. Il l’écrit d’ailleurs dans Le Nœud gordien. Il considère qu’une des erreurs du général de Gaulle fut de ne pas accorder assez d’importance aux deux chambres. Pour Pompidou, le Parlement ne doit surtout pas devenir une chambre d’enregistrement. Cela dit, il existe un décalage entre sa vision théorique — que je trouve remarquable — et sa pratique. Dans Le Nœud gordien, il affirme que le Premier ministre est le véritable chef du gouvernement. Mais dans les faits, il ne laisse pas cette place à Chaban. Marie-France Garaud l’a bien résumé : Pompidou a nommé à Matignon un homme dont il attendait qu’il soit, en réalité, un simple ministre des relations avec le Parlement. Lui-même, ancien Premier ministre, n’a jamais cessé de gouverner. Il connaissait mieux les dossiers que Chaban, travaillait plus que lui, et cette supériorité le poussait à intervenir au quotidien. Mais ce n’était pas cohérent avec sa propre conception institutionnelle.
Enfin, il y a une autre réflexion intéressante chez lui, peut-être liée à l’évolution de son état de santé : le débat sur le quinquennat. Pierre Juillet pousse en ce sens à l’Élysée. Pompidou y réfléchit sérieusement, mais dès le départ, il pose une condition claire : en cas de quinquennat, il ne faut surtout pas aligner les calendriers présidentiels et législatifs. Or, c’est précisément ce qu’on a fait depuis, en 2002. Et sur ce point, on peut dire que la réflexion de Pompidou n’a pas été entendue.
Nicolas Baverez :
L’économie est finalement assez peu présente dans votre livre, ce qui est paradoxal. Le septennat interrompu de Georges Pompidou reste considéré, à juste titre, comme une forme d’âge d’or économique. Les chiffres font rêver : 6% de croissance annuelle, 4,5% de gain de productivité, un chômage qui passe seulement de 2,2% à 2,7%. En 1973, la France enregistre son dernier excédent budgétaire (+ 0,2%), avec une dette publique autour de 10% du PIB. Et en parallèle, ce sont les grands lancements industriels et technologiques : le programme nucléaire, le TGV, la modernisation des télécommunications, Ariane, Airbus, le premier sous-marin nucléaire d’engin, les autoroutes … Vous consacrez un chapitre à la modernisation, mais je le trouve finalement assez court au regard de cette séquence, d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte difficile : juste après Mai 68, au moment où le système de Bretton Woods se désintègre, où survient le premier choc pétrolier et où commence la stagflation, marquant la fin de l’ère keynésienne. La performance, dans ce contexte, est véritablement exceptionnelle.
Philippe Meyer :
Et j’ajouterais, à propos du chômage : ce qui est très impressionnant avec Pompidou, c’est qu’il voit le problème arriver. Il anticipe que ce sera l’enjeu central des années à venir.
Jérémie Gallon :
Juste un mot sur le tandem Pompidou-Chaban : Edgar Faure avait cette formule assassine — « Pompidou, c’est la compétence froide ; Chaban, c’est l’incompétence animée ». Elle dit beaucoup de leur rapport.
Sur le bilan économique, vous avez parfaitement résumé les faits : il est remarquable, surtout lorsqu’on le compare à la situation actuelle. Ce que j’ai voulu explorer dans le livre, peut-être pas assez en détail, c’est ce qui permet à Pompidou d’avoir les outils, à ce moment précis, pour guider la France.
Dès son passage à Matignon, il montre une certaine frustration face au dirigisme économique et au colbertisme de De Gaulle. Il considère qu’on ne peut pas continuer à soutenir artificiellement des secteurs en déclin — comme la sidérurgie ou les charbonnages — et qu’il faut réorienter les investissements vers des filières d’avenir : l’aéronautique, la pétrochimie, l’informatique. Il lance d’ailleurs des initiatives fortes dans ces domaines. Pour autant, il ne bascule pas dans un libéralisme pur. Il reste attaché à un certain dirigisme. C’est là toute la richesse de sa position : un équilibre entre planification stratégique et ouverture.
Deuxième point fondamental : sa connaissance du tissu économique français. Elle vient de son expérience chez Rothschild, qui n’a pas été anecdotique. Il y passe deux fois, à des postes de haute responsabilité, et en retire une compréhension fine de la structure économique française. Il voit notamment que celle-ci est trop morcelée, et impulse des politiques de consolidation sectorielle.
Troisième dimension, européenne cette fois : beaucoup de grandes réussites industrielles européennes trouvent leur origine dans cette période. Airbus, par exemple, naît en 1971, sous son impulsion, même si le consortium n’a pas encore ce nom. Le premier vol interviendra plus tard, mais la dynamique est lancée. Il y a chez Pompidou une vraie volonté de créer des champions européens.
Sa vision est globale. Il sait que l’économie suppose aussi des infrastructures solides. Sous son impulsion, la France comble une partie de son retard par rapport à l’Allemagne : le réseau autoroutier est massivement développé, notamment sous l’égide d’Albin Chalandon. En parallèle, alors qu’on ferme beaucoup de petites lignes, il engage le projet de lignes à grande vitesse. L’une de ses toutes dernières décisions, trois semaines avant sa mort, sera le lancement de la ligne TGV Paris-Lyon.
Enfin, l’énergie. C’est un sujet central aujourd’hui, et il l’avait pleinement anticipé. L’un de ses legs majeurs reste le lancement, avec Pierre Messmer, du premier grand programme nucléaire civil français. Ce programme reste au cœur de notre indépendance énergétique, du moins dans ce qu’il en reste aujourd’hui.
Je terminerai par un point sur les finances publiques. Pompidou y tenait beaucoup. Il avait une conception rigoureuse de la dépense, avec une exception : la culture. Là, il estimait que c’était un investissement modeste aux effets démultipliés. Il disait en substance : nous aurions mieux fait d’acheter à temps les impressionnistes, les fauves, plutôt que de devoir aujourd’hui espérer quelques dons pour remplir les cimaises de nos musées.