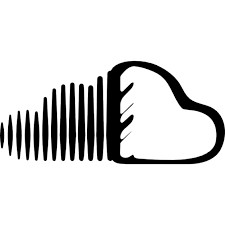CENSURE, RUE, GRÈVE : DANS QUELLE CRISE SOMMES-NOUS ?
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Lundi, le premier ministre François Bayrou n’a pas obtenu la confiance des députés n’obtenant que 194 voix contre 364. Après sa démission le président de la République a nommé Premier ministre Sébastien Lecornu. Depuis sa réélection en 2022, Emmanuel Macron a désigné cinq Premier ministres. Elisabeth Borne, Gabriel Attal, puis Michel Barnier, dont le gouvernement n'a duré que trois mois, le plus court jamais enregistré sous ce régime et le premier de la Vème République à être censuré par l’Assemblée nationale. François Bayrou, censuré à son tour par l’Assemblée, n’aura duré que neuf mois. Cette crise politique s’accompagne d’une crise économique et budgétaire profonde à laquelle s’ajoute une crise sociale, avec des appels au blocage du pays le 10 septembre et à la grève le 18. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l’Ifop, observe que « la division des forces politiques au point qu’une majorité semble introuvable est le reflet de l’archipellisation de la France ». Des divisions sociologiques, politiques et idéologiques qui fracturent le pays bien au-delà de l’ancien clivage droite-gauche.
Dans la rue, si la France ne s’est retrouvée ni bloquée ni à l’arrêt mercredi, de nombreuses actions ont eu lieu toute la journée partout dans le pays, avec des rassemblements d’ampleur dans certaines villes – entre 197.000 et 250.000 - personnes recensées – et une très forte présence des forces de l’ordre. Né en mai à l'initiative d'un site souverainiste, proche de la droite et de l'extrême droite, "Bloquons tout" a été repris et développé par des sympathisants de la gauche radicale. Le conflit des « Gilets jaunes » comme le rendez-vous de mercredi s'inscrivent dans la continuité d'une série de mobilisations citoyennes 2.0, qui se sont succédées depuis le référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. Les deux mouvements partagent la même forme d'auto-organisation horizontale en réseaux que celle des Gilets jaunes et une absence de leader. Toutefois, une récente enquête menée sous l’égide de la Fondation Jean Jaurès, souligne que le profil des animateurs de Bloquons tout est assez différent de celui des Gilets jaunes. Il s’agirait de citoyens plus jeunes, plus actifs, plus politisés et plus proches de la gauche radicale. Appartenant aux classes moyennes, ils sont souvent diplômés du supérieur. Seulement 27% d’entre eux prirent d’ailleurs part à la révolte des ronds-points de 2018. La plupart des organisations de salariés se sont placés à distance de l’initiative. Seuls, Solidaires et la CGT ont soutenu la démarche du 10 septembre. Le 18 septembre sera une journée d’action à l’appel de l’intersyndicale qui avait mené le combat contre la réforme des retraites et dénoncé la copie budgétaire de François Bayrou.
Kontildondit ?
Marc-Olivier Padis :
Churchill disait : « never let a good crisis go to waste », autrement dit, ne jamais gâcher une bonne crise. Nous sommes en plein dans ce cas : crise politique, institutionnelle, crise de régime. Le mouvement Bloquons tout, difficile à cerner, semble aimanté par un rejet personnel d’Emmanuel Macron. Ce qui a frappé cette semaine, c’est que le président, au lieu de temporiser pour laisser le mouvement retomber, a choisi de nommer à Matignon, la veille du blocage, un responsable perçu comme son double, par lequel il espère reprendre la main. Cela fait des mois qu’il résiste à l’idée de laisser les choses se faire sans lui, alors même que sa personne cristallise le rejet.
Si Lecornu échoue, le président sera exposé en première ligne et soumis à la pression d’une démission anticipée, possible si la crise de régime s’aggrave. Pour l’heure, nous sommes encore dans une crise parlementaire d’une simplicité extrême : sans majorité, il est impossible de gouverner, comme l’ont montré les expériences Barnier et Bayrou. La seule issue est de constituer une coalition, scellée par un accord écrit, solide, explicitement négocié et partagé. Mais les parlementaires, peu habitués à cet exercice, en semblent incapables. Depuis des mois, on observe la lenteur et la difficulté de cet apprentissage. La nouveauté avec la nomination de Lecornu, c’est qu’il a annoncé vouloir consulter avant de former son gouvernement, se posant en conciliateur pour trouver les équilibres d’une vraie coalition. Espérons qu’il y parviendra, car son bilan aux Outre-mer ne plaide pas en ce sens, notamment en Nouvelle-Calédonie où il a provoqué une véritable catastrophe, apparaissant moins conciliant encore que Manuel Valls.
Les négociations se concentrent désormais sur le budget : il faut trouver 100 milliards. Bayrou avait ramené le chiffre à 44 milliards, mais pour stabiliser la dette et éviter une spirale, l’effort doit être de 100 milliards par an. La gauche réclame une taxation accrue des hauts patrimoines. Les économistes discutent de la meilleure formule. Sur le principe, augmenter l’impôt des plus riches paraît légitime, mais les estimations actuelles parlent de 5 à 15 milliards de recettes, 20 dans le meilleur des cas, soit 5 à 15 % du total nécessaire. Tout le reste est à trouver pour boucler le budget.
Nicole Gnesotto :
Cette crise de régime présente plusieurs aspects. D’abord le blocage institutionnel : l’Assemblée n’a pas de majorité et aucun parti ne veut de compromis. Marc-Olivier Padis disait que nous n’avons pas créé de culture du compromis en France. Mais c’est lié à notre régime présidentiel : la Vème République concentre l’essentiel du pouvoir sur le président, ce qui rend le compromis inutile. Aujourd’hui, tous les chefs de partis ont les yeux tournés vers 2027 et refusent de s’allier à Lecornu de peur de compromettre leurs chances à la présidentielle. Notre régime est donc aux antipodes d’une culture du compromis, contrairement à des pays plus fédéralistes comme l’Allemagne.
Deuxième aspect : l’illégitimité du gouvernement. Même si ce n’est pas inscrit dans la Constitution, le président devrait choisir un Premier ministre issu du parti majoritaire à l’Assemblée. Depuis la dissolution de 2024, Emmanuel Macron a nommé deux LR, qui avaient obtenu 7,4% des voix, puis Sébastien Lecornu, dont le parti Renaissance avait fait environ 17%. C’est la première fois dans l’histoire de la Vème République qu’un Premier ministre n’est pas issu du parti arrivé en tête aux législatives. Certes, aucune majorité n’existait, mais ce gouvernement, comme les précédents, reste en décalage avec l’esprit des institutions.
Troisième aspect : le président lui-même. Personne n’a compris la dissolution de juin dernier. Même ses alliés potentiels, comme Valérie Pécresse, demandent désormais sa destitution. Son projet politique était clair et séduisant : structurer la vie politique en deux blocs, progressiste et nationaliste, pour dégager des majorités stables. Or, c’est l’inverse qui s’est produit : trois blocs se font face — un centre affaibli et deux extrêmes — ce qui empêche toute majorité.
Reste la question : que faire ? La logique économique impose de réduire de 100 milliards par an un déficit public de 5,8%, l’un des pires d’Europe après la Roumanie et la Bulgarie. Mais deux mesures me semblent essentielles. D’abord, contrairement à Bayrou qui proposait 44 milliards d’économies, Lecornu devrait viser la moitié, 22 milliards, pour espérer rester en place au moins un an. Ensuite, il faut associer réduction des dépenses et hausse des recettes en taxant les plus riches. On ne peut pas maintenir la suppression de deux jours fériés sans y ajouter un impôt Zucman de 2% sur les très grandes fortunes. Deux jours fériés en moins et 2% d’impôt en plus : c’est l’équation nécessaire. Si le gouvernement refuse à la fois de revoir les 44 milliards et de lever le tabou fiscal sur les très hauts patrimoines, il échouera, entraînant une nouvelle dissolution et mettant le président en danger.
Matthias Fekl :
Au lendemain des élections de 2022, j’avais écrit un article intitulé « bienvenue dans la neuvième République ». J’y expliquais qu’on vivait un mélange ]d’hyper Vème République], concentrée à l’Élysée, et ]d’hyper IVème République » au Parlement, avec une fragmentation déjà perceptible avant la dissolution. 5 + 4 = 9, vous l’aurez compris. Depuis, cette logique s’est aggravée : absence de majorité et refus du président de tirer les conclusions des élections. On ne peut pas dissoudre pour des raisons contestables ou incompréhensibles, puis n’en tirer aucun résultat. Dans une élection, les choses sont simples : des forces arrivent en tête. Après la dissolution, le message n’était pas parfaitement clair, mais quelques constantes existaient : une extrême droite toujours très forte et un Front républicain qui, contre toute attente (y compris la mienne), avait plutôt bien fonctionné.
En tirer les conséquences signifiait nommer un Premier ministre issu de l’une des forces arrivées en tête, et non d’un parti en queue de scrutin, et n’ayant même pas appartenu au Front républicain. Mettre de côté le Nouveau Front populaire, arrivé en tête, a été une faute. Tout ce désordre découle de ce refus de reconnaître le résultat des urnes. Même dans une Assemblée éclatée, d’autres options étaient possibles. Depuis, tout a été fait à rebours et nous voilà dans une situation difficile : un contexte international exigeant une France capable de décider et d’être crédible, une situation budgétaire extrêmement grave, une tension sociale très forte. Tous les ingrédients sont réunis pour que cela se passe mal.
Quand les élections ne produisent plus d’effet politique, l’exutoire devient la rue, les mobilisations extra-parlementaires et la haine contre les responsables politiques. Ce climat m’inquiète profondément. J’espère que Sébastien Lecornu saura se montrer à l’écoute, dialoguer avec tous les partis et prendre en compte la gauche. On ne peut pas continuer à l’ignorer, même si elle est divisée. Dans une situation sociale aussi explosive, on ne peut pas faire comme si les choix fiscaux de 2017 étaient intangibles. L’acceptabilité de toute réforme suppose que l’effort soit équitablement réparti et que ceux qui s’en sortent très bien depuis presque dix ans contribuent à l’effort national dans cette période critique.
Enfin, je n’ai jamais trouvé très sain le projet qui consistait à structurer la vie politique entre les « gentils » pro-européens et progressistes, et les « méchants » nationalistes. Dans une démocratie fondée sur l’alternance, il était inévitable qu’un jour l’alternance ait lieu. Et ce jour-là, ce clivage moral manichéen sera balayé, ouvrant la voie à des forces qui risquent de causer beaucoup de tort à la France.
Philippe Meyer :
Il faudrait que vous nous éclairiez sur les talents pour le dialogue de Sébastien Lecornu. Je ne sais pas s’il a beaucoup dialogué avec l’état-major ; avec les militaires, c’est généralement du haut vers le bas, même s’il a sûrement eu d’intéressantes consultations ...
Matthias Fekl :
Ce que je sais, c’est que Sébastien Lecornu est l’opposé du macronisme triomphant. Ce n’est pas quelqu’un qui méprise le fait d’être élu ni qui considère qu’écouter sur les marchés soit indigne. Au contraire, il a un vrai parcours d’élu, un ancrage local, et il retourne régulièrement sur le terrain pour entendre ce qui se dit à la base. Je ne suis pas son porte-parole, mais cela nous éloigne, de l’hubris qui a trop souvent marqué l’exercice du pouvoir ces dernières années.
Richard Werly :
Pour ma part, j’ai surtout des interrogations. D’abord, dans n’importe quel autre pays européen, un président aussi décrié, au cœur du problème — toutes les études le montrent — serait contraint de se remettre en cause. Qu’on apprécie ou non la politique d’Emmanuel Macron ou ses analyses géopolitiques, il fracture le pays et reste enfermé dans son personnage de président hyper-élitiste, perçu comme méprisant. Peu importe que cela soit exact ou non : c’est ainsi qu’il est vu. Et voilà qu’il nomme son clone. J’ai entendu ce que disait Matthias : ce serait un clone sympathique, le macronisme sans hubris, sans arrogance, le macronisme des marchés du dimanche. Mais politiquement, c’est culotté, une gifle à ceux qui pensent que pour débloquer le pays, le président doit se remettre en cause. Il l’a reconnu du bout des lèvres à propos de la dissolution (sans jamais prononcer le mot « erreur » cependant). Et maintenant, il nomme un ministre qui, pour moi, incarne autre chose : il est ministre depuis 2017 sans discontinuer, ce que certains présentent comme de l’expérience. On peut aussi y voir une preuve de soumission. Il est celui qui a avalé le plus de couleuvres. Les autres sont partis, lui est resté. C’est cela qui est récompensé, et c’est un mauvais signe.
Autre interrogation : les affaires du pays sont confiées à quelqu’un qui n’a jamais travaillé en dehors des couloirs de l’Assemblée ou des cabinets ministériels. Matthias, vous êtes aujourd’hui dans le privé, vous avez été avocat, beaucoup de politiques alternent entre public et privé. Lui, jamais. Quel est le cerveau d’un homme qui, depuis l’âge de 19 ans, n’a connu que la politique et l’administration ? Certes, son expérience de maire compte, mais le rôle principal d’un maire reste de chercher des financements publics. Or, l’argent public est précisément le problème en France, il se raréfie. Je m’interroge donc : comment Emmanuel Macron peut-il penser que Sébastien Lecornu est l’homme pour débloquer la France ?
Ma deuxième interrogation porte sur les Français. J’ai l’impression qu’ils vivent dans l’inconscience. À part quelques économistes libéraux qui rappellent les ordres de grandeur, peu de voix s’élèvent pour dire qu’il manque 100 milliards dans les caisses. 100 milliards ! Et pourtant, on donne l’impression de tirer sur la corde tant qu’elle ne casse pas. Je suis frappé par le constat de Nicole : selon elle, 20 milliards suffiraient, inutile d’aller plus loin. Mais si l’État continue de dépenser à ce rythme, sans maîtriser ses dépenses, la faillite n’est pas loin. Et cette contradiction est terrible : on dépense toujours plus pour des services publics de moins en moins efficaces. Or, les études le montrent, l’électeur demande avant tout de l’efficacité. Les Français ne semblent pas le voir. Je suis stupéfait de l’aveuglement du président et stupéfait de celui des Français.
Nicole Gnesotto :
Je n’ai jamais dit que la situation n’était pas grave, ni que 100 ou 200 milliards manquants dans le budget étaient sans conséquence. Mais il y a deux options. Soit le gouvernement veut obtenir une majorité et faire passer un budget qui permette à la France de tenir jusqu’à la présidentielle de 2027 : dans ce cas, il ne peut pas suivre la ligne Barnier-Bayrou, car il serait immédiatement censuré par toutes les forces politiques. Soit il veut franchir l’obstacle, et alors il doit écouter la gauche. Celle-ci dit d’abord que le gouvernement n’est pas légitime, puisqu’il est issu de partis perdants des élections, et non des partis arrivés en tête. Ensuite, elle exige un minimum de justice fiscale dans le budget. Cela signifie moins d’efforts demandés aux classes moyennes - passer de 44 à à 22 milliards (ou à 30, peu importe) - et plus aux ultra-riches. C’est le compromis politique majeur qu’il faudrait aujourd’hui pour que la Vème République tienne. Or, le président ne semble pas vouloir entendre ce compromis.
Matthias Fekl :
J’ai perdu mes élections législatives en 2017 parce que j’avais refusé de suivre Emmanuel Macron, avec qui j’avais siégé au gouvernement pendant deux ans et demi, et dont j’avais perçu … certaines caractéristiques. Je n’ai donc aucune intention de devenir ici le porte-parole du macronisme. Simplement, j’essaie de voir comment, dans un moment très difficile, avec un Premier ministre nommé, on peut s’en sortir. J’espère que cela fonctionnera, car une démission du président ne me semble pas souhaitable, malgré sa responsabilité immense. L’édifice politique était déjà fissuré quand il est arrivé au pouvoir. S’il a réussi à l’époque, c’est aussi parce que les anciens partis étaient affaiblis et s’étaient accommodés de beaucoup de choses. Mais depuis, rien n’a été reconstruit : ni projet, ni doctrine, ni structure.
Les institutions n’ont pas besoin d’être encore fragilisées, elles ont besoin de vivre selon leur logique. La Vème République, dont je ne suis pas un grand admirateur, doit être réformée en profondeur pour en finir avec le présidentialisme. Mais même dans ce cadre, il n’a jamais été dit qu’il ne fallait pas tenir compte du résultat des élections. C’est inédit : même dans l’ancien monde, de mauvais résultats électoraux entraînaient un changement de Premier ministre ou une adaptation de la politique. Aujourd’hui, quoi qu’il arrive — Gilets jaunes, élections, opinion hostile — rien ne change. Forcément, cela ne peut pas fonctionner.
Marc-Olivier Padis :
Je suis entièrement d’accord avec Matthias : il aurait fallu écouter davantage la gauche après les élections législatives. Mais lorsque LFI a aussitôt déclaré « notre programme, tout notre programme, rien que notre programme », les conditions n’étaient évidemment pas réunies …
Pour mettre fin au présidentialisme, il existe pourtant une solution simple, et je ne comprends pas que les parlementaires ne s’en emparent pas. Aujourd’hui, la balle est pourtant dans leur camp, pas dans celui du président. On passe notre temps à discuter de Macron, de ses intentions, de son « clone », mais si les parlementaires s’accordaient sur un contrat de coalition et désignaient la personne pour le diriger, le président serait obligé de la nommer. Il suffit de pratiquer le parlementarisme et de sortir de cette infantilisation que les parlementaires acceptent encore aujourd’hui.
Matthias Fekl :
Je suis d’accord sur le fond, mais cela ne fonctionne pas pour une raison simple : il y a la présidentielle en ligne de mire. C’est l’élection phare, et chacun rêve d’être le prochain Dalaï-Lama, qui résoudra tous les problèmes et deviendra président. Résultat : la plupart des forces politiques se disent qu’entrer dans une coalition compromettrait leurs chances en les rendant coresponsables d’une situation qu’il vaut mieux combattre plutôt que résoudre. C’est tragique, mais c’est ainsi.
Richard Werly :
J’aimerais revenir sur l’aspect budgétaire. Il y a d’abord l’obligation de faire des économies, mais aussi l’inévitabilité de faire contribuer les plus gros patrimoines. Gabriel Zucman fixe la barre à 100 millions d’euros : au-dessus de ce seuil, une contribution temporaire paraît nécessaire, sous réserve de l’avis du Conseil constitutionnel. François Hollande s’y était essayé, et on se souvient des difficultés juridiques. Mais le donnant-donnant ne peut pas se limiter à la seule équité fiscale, même si elle est essentielle pour apaiser le ras-le-bol des classes moyennes. Il faut aussi proposer quelque chose à ces très riches contribuables, qui disposent de moyens d’influence et de lobbying considérables.
Il faut leur démontrer que l’État va se réformer. Qu’au moment où on leur demande une ponction de 2% de leur patrimoine, l’État s’engage simultanément à réduire réellement ses dépenses. Car le moteur de l’évasion fiscale n’est pas seulement l’envie de payer moins, c’est aussi le rejet d’un État perçu comme un panier percé. Je l’entends souvent à Genève, dans les rencontres avec des Français exilés fiscaux : ils reprochent à l’État français de dépenser sans compter. Il faut donc que ce gouvernement, ou le suivant, prouve que la puissance publique peut faire des efforts crédibles pour dépenser moins. C’est impératif.
Philippe Meyer :
Le reproche dont parle Richard, on l’entend dans toutes les classes sociales, y compris chez celles qui n’ont ni les moyens ni sans doute l’envie d’échapper à l’impôt : « moi, ce n’est pas payer mes impôts qui me gêne, c’est de voir cet argent aussi mal utilisé. »
Matthias Fekl :
N’oublions pas cependant que, même parmi les exilés fiscaux, beaucoup reviennent lorsque l’âge ou la maladie les rattrape, car il faut se faire soigner ... Il y a donc aussi une question de responsabilité. Je crois qu’il y a eu une rupture à la fin des années 1970 et dans les années 1980, avec l’arrivée de Thatcher et Reagan, où l’impôt en tant que tel a commencé à être contesté. Avant cela, les élites économiques, y compris aux États-Unis, acceptaient de payer des taux d’imposition extrêmement élevés, parfois jusqu’à 95%, ce qui paraît inimaginable aujourd’hui. Elles en éprouvaient même une certaine fierté, celle de réussir et de contribuer à un projet commun. Cela s’est défait et il faut y remédier.
Encore faut-il que l’argent ne se perde pas dans les méandres bureaucratiques et que le service public suive. La concomitance d’impôts très élevés et de services qui se dégradent est insoutenable. La réforme de l’État est donc indispensable. Un ami m’a suggéré une idée intéressante : maintenir des impôts très élevés mais les placer sur un compte séquestre, versés uniquement une fois la réforme de l’État réalisée. Je ne sais pas si c’est faisable, mais l’idée illustre bien l’attente : on n’est pas contre l’impôt, on veut qu’il soit bien employé.
Enfin, il ne faut pas confondre un revenu et un patrimoine productif. Taxer une entreprise qui vaut beaucoup d’argent peut être théorique si ses bénéfices sont réinvestis dans l’outil de production, créant emploi et richesse. Cela doit être traité différemment d’une ressource individuelle disponible pour une personne.
Nicole Gnesotto :
D’abord, sur l’attitude des riches : je crois que la réforme de l’État leur est indifférente. Comme Matthias l’a dit, dès qu’ils sont malades, ils reviennent en France pour profiter des services sociaux. Ensuite, l’argument selon lequel on ne peut pas taxer 2% des grandes fortunes sous peine de les voir partir ne me convainc pas : qu’elles partent ! Elles paient déjà très peu d’impôts en France, cela ne nous pénaliserait pas beaucoup. Je rappelle que Zucman conclut son étude en disant qu’aujourd’hui, un patron d’une grande entreprise paie moins d’impôts que sa secrétaire … C’est un sentiment d’injustice fiscale qu’il faut absolument prendre en compte.
Sur l’idée que les Français seraient inconscients de la gravité de la dette, je voudrais relativiser. Depuis 1974, le budget n’a jamais été à l’équilibre. Ce n’est pas nouveau, ce n’est pas propre à Macron, c’est une vieille histoire. Aujourd’hui, le service de la dette est de 58 milliards par an, soit 2% du PIB, ce qui correspond peu ou prou aux 44 milliards d’économies visés par Barnier et Bayrou. En 2022, quand nous avons emprunté pour le Covid, ce service représentait 3,4% du PIB et ce n’était pas un sujet de crise nationale.
Par ailleurs, la moitié de la dette française est détenue par des Français, un quart par des prêteurs européens et un quart par des prêteurs extérieurs. Nous ne sommes donc pas dans la situation du Mexique ou de la Grèce, dont les dettes étaient majoritairement détenues à l’étranger. La France est un pays stable dans le remboursement de sa dette.
Enfin, en 2024, la France est restée le premier pays d’accueil des investissements directs étrangers en Europe. Cela montre que, malgré la gravité de la situation, d’un point de vue macroéconomique, nous sommes loin d’être désespérés.
La France n’est pas la Grèce : nous n’avons pas truqué nos comptes publics. Certes, il y a peut-être des cas de corruption, mais nous restons dans un système politique et administratif qui respecte la loi et prélève l’impôt sur le revenu. Bref, il faut agir, mais ne pas dire que la France est au bord du gouffre ni qu’une démission du président et l’élection de M. Bardella seraient la seule solution.
Marc-Olivier Padis :
Sur la dépense publique, il y a un paradoxe que nous n’expliquons jamais : pourquoi l’État dépense-t-il autant alors que les citoyens ont le sentiment que le service rendu se dégrade ? Je ne vois pas ces fameux « méandres bureaucratiques » dont parlait Matthias. Ils ne sont ni à l’hôpital, ni dans la justice (notoirement sous-financée), ni dans l’école ou la police. Où sont-ils ? Si l’on regarde les grandes masses, elles concernent les retraites et la santé.
Peut-on vraiment faire des économies là-dessus ? On ne peut pas reprocher à l’hôpital public de gaspiller l’argent. Ce n’est pas le cas. C’est un choix de société : nous voulons être bien soignés en France, et nous le sommes souvent, surtout comparé à d’autres pays, pour un coût bien inférieur (notamment à celui des États-Unis).
Pour les retraites, les Français tiennent à leur système. La vraie difficulté, c’est que nous creusons la dette non pour financer des investissements d’avenir, mais des dépenses courantes. Cela ne peut pas durer. Quant à la proposition de réduire massivement le nombre de fonctionnaires, elle est absurde. Prenons un calcul simple, avec les préconisations les plus dures de la droite : 100.000 fonctionnaires supprimés (je ne sais pas où on les prendrait, mais admettons). Le coût moyen d’un fonctionnaire est de 40.000 euros par an, cela représenterait donc 4 milliards. Or, nous devons trouver 100 milliards : cela ne couvrirait que 4 % de l’effort, et c’est une économie qu’on ne pourrait faire qu’une seule fois. Faudrait-il supprimer 100 000 fonctionnaires chaque année pendant neuf ans ? C’est délirant.
Richard Werly :
Pour revenir sur la dette, j’ai sans doute exagéré en disant que la France est au bord de la faillite. Mais il faut garder en tête le risque d’engrenage : quand la situation se détériore, elle le fait de façon cumulative. Les promesses d’investissement dont parlait Nicole sont issues des sommets « Choose France » qu’Emmanuel Macron organise chaque année. Mais ce sont des promesses, pas des investissements acquis. Il faudrait vérifier le montant réellement investi, mais il est sans doute bien inférieur aux annonces. Cela dit, il est vrai que la France reste un pays attractif, et c’est probablement l’un des succès d’Emmanuel Macron d’avoir redoré son image auprès des investisseurs étrangers.
Reste que la dette est préoccupante. Elle est détenue à 55% par des investisseurs étrangers, le niveau le plus élevé de l’OCDE. Ce n’est pas un signal d’alarme immédiat, mais on ne peut pas le prendre à la légère. Avec une dette à 120% du PIB — soit 3 415 milliards d’euros, le chiffre rappelé par François Bayrou avant sa censure — pour un pays qui croît de 1% au mieux et affiche 5,4% de déficit public en 2025, c’est tout simplement trop. Ce n’est pas la faillite, mais c’est intenable. Il faudra donc s’attaquer aux causes de cette dette : les dépenses publiques dans leur ensemble, y compris les collectivités locales et la sécurité sociale.
Enfin, il faut tenir compte de la confiance de nos partenaires. La France profite aujourd’hui de la signature allemande via l’euro. Mais si demain le président de la Bundesbank exprimait publiquement son inquiétude, les marchés s’affoleraient. Pour un pays riche qui entend jouer un rôle international — notamment sur l’Ukraine, où Emmanuel Macron s’investit beaucoup — se maintenir dans une situation où les compteurs peuvent s’affoler à tout moment est extrêmement dangereux.
Nicole Gnesotto :
Je suis tout à fait d’accord sur la nécessité de réduire les dépenses de l’État, mais il faut aussi augmenter les recettes. Je le répète : il faut un impôt Zucman, ces 2% sur les très grandes fortunes. C’est ce qui rendrait l’effort socialement acceptable, car un budget n’est pas qu’une affaire de mathématiques, c’est une question d’acceptabilité sociale. Et personnellement, je préfère que cet équilibre soit trouvé par les voies démocratiques plutôt que par la rue.
Pour compléter ce qu’a dit Marc-Olivier Padis, je nuancerais l’idée d’inefficacité des services publics. Nous sommes le pays d’Europe qui prélève le plus d’impôts, qui redistribue le plus, et qui connaît pourtant le plus fort mécontentement populaire. Il y a un choc entre deux modèles de société qui n’a pas été résolu. D’un côté, le modèle social que décrit Marc-Olivier : santé pour tous, modèle envié partout dans le monde et qui justifie, à mon avis, la couverture médicale pour les réfugiés et immigrés. De l’autre, le modèle libéral des années 1980-1990, avec numerus clausus pour limiter les coûts, fermetures de lits, financement des hôpitaux à l’activité. La coexistence de ces deux logiques explique en partie la crise actuelle de l’hôpital, qui ne répond plus aux attentes.
Plus largement, Bernard Manin l’a bien montré : la démocratie maximise les libertés individuelles tout en rendant plus difficile l’action collective. Nous avons des individus de plus en plus libres — sur le plan sexuel, religieux, intellectuel — mais des actions collectives de plus en plus rares et difficiles à mener. C’est cela qui m’inquiète : cette crise française pourrait nourrir la montée de l’extrême droite en France et en Europe, car nous butons sur l’inefficacité de la démocratie.
Sur l’Europe enfin, la France était autrefois jugée irréformable, désormais on la juge ingouvernable, ce qui inquiète. Certains, comme Giorgia Meloni, y voient une revanche : Emmanuel Macron avait dit qu’il la jugerait sur les faits, et les faits en Italie sont plutôt positifs. Mais globalement, l’inquiétude domine, surtout face à la divergence croissante entre la France et l’Allemagne. Cela dit, la situation allemande n’est pas florissante : si sa dette et son déficit sont maîtrisés, son économie reste fragile. Les Allemands ont été totalement dépendants de la Chine pour leurs exportations, de la Russie pour leur énergie, et ils le sont aujourd’hui des États-Unis sur d’autres plans, alors même que l’Amérique devient de plus en plus anti-allemande. Il ne faut donc pas idéaliser l’Allemagne trop vite.
Richard Werly :
Sauf que les problèmes allemands que vous venez d’énumérer sont le résultat de trois chocs extérieurs, alors que les problèmes français relèvent d’un choc interne.
Matthias Fekl :
Il y a tout de même la panne d’investissement en Allemagne, qui est un choc intérieur. Pour le reste, vous avez raison.