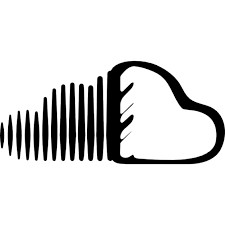LECORNU ET LA QUADRATURE DU CERCLE
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Arrivé à Matignon le 10 septembre, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a promis une inflexion sur la forme et sur le fond. Cinquième premier ministre de ce quinquennat, dépourvu de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il va devoir affronter sans tarder les mêmes murs budgétaires et parlementaires que ses prédécesseurs. Il se trouve confronté à la délicate équation de trouver un compromis avec la gauche sans déplaire à la droite. La composition de la nouvelle équipe gouvernementale ne sera pas connue avant plusieurs semaines, puisque le chef de l’Etat a enjoint son Premier ministre de mener des discussions préalables avec les différentes formations politiques avant de bâtir son gouvernement.
L’idée du Premier ministre de chercher un accord, sur le budget, mais également « sur deux ou trois textes forts », convient aux dirigeants de la droite. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau a fait, en gage de bonne volonté, deux concessions : renoncer à l’« année blanche » – le gel des dépenses publiques – et à l’aide sociale unique, mais il ne transigera pas sur le « durcissement sur l’immigration » ou « l’assistanat ». Au-delà du « socle commun », Sébastien Lecornu devra obtenir au minimum une non-censure du Parti socialiste pour faire adopter le budget 2026. Le parti socialiste a défendu le 15 septembre à Matignon une position comprenant la suspension de la réforme des retraites, l’instauration de la taxe Zucman sur les grandes fortunes et la baisse du quantum d’économies à réaliser d’ici à 2029. À l’Élysée, on assure n’avoir fixé aucune ligne rouge au Normand. Pour ne fâcher personne, il a d’ores et déjà été acté qu’il ne procèdera à aucun débauchage au sein du Parti socialiste pour composer son gouvernement. À l'occasion de son interview le 13 septembre, dans la presse régionale, pour amadouer les socialistes, Sébastien Lecornu s’est dit « prêt » à l'abandon de la suppression des deux jours fériés, à augmenter la fiscalité des plus riches, mais sans toucher à leur « patrimoine professionnel ». Quant à un aménagement de la réforme des retraites, il reste évasif, mais rejette un retour du « conclave ». Il ne renie pas la totalité de la copie budgétaire de M. Bayrou sur laquelle il devrait, en partie, se fonder. Mais il lui faudra peut-être aussi faire un geste sur le pouvoir d'achat et un autre sur les retraites, sans perdre le soutien des Républicains ou braquer le patronat, ni oublier la réduction du déficit ...
Kontildondit ?
Lionel Zinsou :
16 %, c’est un taux d’approbation qui n’est pas très éloigné de celui de son prédécesseur, M. Bayrou, mais celui-ci avait déjà montré ce qu’il savait faire. Dans le cas de M. Lecornu, il y a une réserve importante de popularité, car il est peu connu. Ce n’est donc pas un accueil aussi négatif qu’on l’a dit. On a affirmé qu’il était le Premier ministre de la Vème République le plus mal accueilli par l’opinion. Je crois plutôt qu’il est simplement méconnu, grâce à ses qualités de discrétion et de modération. Sa nomination ne me semble pas être une quadrature du cercle : il a une vraie chance de remplir sa mission, c’est-à-dire de durer.
La rapidité de sa nomination est un premier progrès. Si on avait connu un mois supplémentaire de troubles sociaux, après un été tendu et les Jeux olympiques, la situation aurait été grave. Nommer un Premier ministre trois heures après une démission, à 20 h, était une bonne chose. Deuxième élément : la sobriété de sa déclaration dans la cour de Matignon, qui reflète toute sa carrière, marquée par l’humilité, la simplicité et la brièveté. C’est un bon signe. Recevoir les syndicats avant les partis est aussi un progrès. Être chargé de chercher une majorité avant de constituer un gouvernement rappelle les méthodes belges ou allemandes : on trouve d’abord une solution, puis on forme l’équipe, au lieu de négocier après coup des coalitions de nature à changer la composition de l’équipe. Enfin, M. Lecornu paraît proche des Français : par ses origines dans l’Eure, par son parcours social, par ses études supérieures (il ne fait pas partie de l’Énarchie). Tout cela envoie des signaux très positifs.
Philippe Meyer :
Selon le sondage publié jeudi dernier par Le Figaro, 52% des Français se disent satisfaits des débuts de M. Lecornu à Matignon, mais 72% pensent qu’il ne mènera pas une politique de rupture.
Lionel Zinsou :
Le dernier progrès, c’est d’avoir dit devant son prédécesseur ce que l’immense majorité des Français avait besoin d’entendre : « on va changer de méthode, passer au sérieux et faire des ruptures ». Habituellement, et hypocritement, on se contente de féliciter son prédécesseur ; là, c’était un jugement en creux, un peu plus sévère.
Mais surtout, la situation économique des Français n’est pas aussi tragique que la pédagogie de la tragédie de François Bayrou. Son discours n’a convaincu ni mobilisé personne : aucun parti, aucun syndicat, aucun groupe n’a changé d’avis. Ce discours sur la dette ne convainc pas, car il ignore des réalités essentielles. L’épargne des Français est à un niveau record. Certes, nous avons 3.300 milliards de dette publique, mais les Français, une fois leurs dettes déduites (immobilier, consommation, automobile), disposent d’environ 5.000 milliards d’épargne financière. Nous ne sommes pas dans la situation du Japon ou de l’Italie, où la dette est majoritairement nationale ; mais nous sommes un pays au patrimoine élevé.
Pourquoi ? Parce que le supplément de revenu distribué après les Gilets jaunes n’a pas été dépensé et qu’une grande partie de l’épargne forcée du Covid n’a pas été décaissée. Jamais le patrimoine et l’épargne des Français n’ont été aussi hauts. Parler sans cesse de dette et de « ruine des générations futures » ne peut donc pas être entendu : les Français connaissent leur situation financière.
Les sondages sur les finances publiques révèlent un pessimisme quant à l’avenir du pays, mais les enquêtes de l’INSEE et de la Banque de France montrent qu’ils jugent positivement leur situation personnelle. Quant au discours alarmiste sur la hausse des taux d’intérêt : pour une population qui détient beaucoup d’assurance-vie, de livrets et d’obligations, c’est aussi un revenu. 90 % des Français ont un instrument d’épargne. Ce pathos économique est inutile, et il ne fait pas partie de la psychologie de M. Lecornu. Il l’a déjà prouvé : en 2023, il a trouvé des accords majoritaires, notamment sur la loi de programmation militaire, votée massivement avec seulement une quarantaine de députés contre.
Le vrai problème de la France n’est pas la dette, mais l’inégalité et le taux d’emploi trop bas. Il faut plus d’opportunités d’emplois et de longévité du travail. Dans le fameux conclave sur les retraites, nous étions très proches d’un accord entre la CFDT et le MEDEF ; il ne faudra donc pas de pressions énormes pour aménager la réforme. Le problème, ce ne sont pas les retraités, mais les petites retraites, les inégalités fiscales et l’excès de revenus et d’épargne d’une minorité très riche. Ce n’est pas une crise financière ni un effondrement de l’économie. Ce pathos a échoué, et c’est une bonne chose. M. Lecornu en est parfaitement conscient.
Antoine Foucher :
Je suis content que Lionel aille sur le fond des sujets, car je suis en grande partie en désaccord, et cela promet un débat animé.
Le point d’accord d’abord : il faut relativiser l’importance de la dette. L’indicateur clef, c’est la part du PIB consacrée aux intérêts de la dette. On ne rembourse jamais le capital de la dette, seulement les intérêts, et on fait rouler la dette en empruntant à nouveau. Aujourd’hui, ces intérêts représentent 2% du PIB, contre 3% il y a vingt ans : la situation était donc pire à l’époque. Cela va dans le sens de ce que dit Lionel.
Mais mon désaccord porte sur l’état global de la France. La dette n’est que la partie émergée de l’iceberg du déclin français. On peut le constater en comparant les fondamentaux de notre pays avec ceux des autres. L’école décroche : nous sommes entre la 20ème et la 25ème place de l’OCDE. Concrètement, si l’on voulait choisir la meilleure éducation pour nos enfants, il vaudrait mieux les scolariser dans une vingtaine d’autres pays européens. Même constat sur les compétences des actifs : l’enquête PIAC de l’OCDE nous classe également 25èmes. Cela révèle un déclin structurel des compétences et de la formation.
Sur l’industrie, en volume, la production française ne représente plus qu’un tiers de l’allemande. Même si l’Allemagne était deux fois moins puissante, elle resterait devant nous. Nous n’avons jamais aussi peu construit de logements depuis 1945, et il faut aujourd’hui plus de temps pour aller à Limoges ou Clermont-Ferrand qu’au début du XXème siècle, hors TGV. Les biens et services publics régressent objectivement, pendant que d’autres pays s’enrichissent plus vite. La France est désormais 26ème en PIB par habitant, alors qu’elle était 5ème il y a cinquante ans : vingt-cinq pays sont aujourd’hui plus riches que nous. Cela me semble un indice objectif de déclin. Mon désaccord avec Lionel, c’est que la situation économique et sociale de la France, au-delà de la dette, est structurellement très inquiétante.
Dernier point : l’épargne. C’est positif qu’elle soit abondante, mais elle est très inégalement répartie et concentrée chez les plus âgés. Cela complique toute réforme, car ce sont eux qui votent le plus. Il faudrait soit modérer les pensions, soit envisager un emprunt national pour financer l’éducation et la réindustrialisation. Mais aucun parti, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite, n’adresse aujourd’hui un discours de vérité à cette partie de l’électorat.
Michaela Wiegel :
Je voulais revenir sur la méthode Lecornu et sur ses chances de succès par rapport à son prédécesseur. En décembre dernier, le président Macron voulait déjà le nommer, mais il s’était finalement résolu, sous la pression, à choisir François Bayrou. Ce qui me frappe dans ce second mandat, alors qu’il ne reste que deux budgets à préparer, c’est le progrès dans la méthode. Dès 2022, le résultat des élections aurait dû nous amener vers ce que toutes les démocraties parlementaires européennes pratiquent : ce que Lecornu a appelé dans son discours des « conversations sérieuses et précises » avec les forces de l’opposition. Ce n’était pas seulement une critique de son prédécesseur, mais la reconnaissance qu’on ne pouvait plus se complaire dans un système où les majorités étaient acquises d’avance.
En Allemagne, la campagne électorale est aussi clivante qu’en France, mais une fois l’élection passée, on en appelle au sérieux. Avec sa personnalité réservée et discrète, Lecornu pourrait incarner cette volonté de sortir des querelles pour avancer sur les dossiers. Il a d’ailleurs modifié l’ordre des consultations, en commençant par les syndicats avant les partis, ce qui répond au signal d’alerte envoyé par les électeurs trois ans plus tôt.
Il faudra qu’il prenne son temps. En Allemagne, les négociations peuvent durer jusqu’à 136 jours. Certes, ce serait trop tard pour le budget, mais cela montre que la rapidité n’est pas une fin en soi. Avancer sur les grandes lignes nécessite parfois de le faire pas à pas.
Un changement constitutionnel introduisant la motion de censure constructive, comme en Allemagne, serait souhaitable : on ne pourrait voter une motion de censure que si l’on est capable de former une majorité alternative. Cela éviterait l’alliance ponctuelle de forces opposées qui veulent faire tomber le gouvernement sans pouvoir gouverner ensemble.
Jean-Louis Bourlanges :
C’est très intéressant, cette idée de défiance constructive, mais je crois qu’elle est inapplicable en France, pour des raisons profondes liées à la Vème République. En Allemagne, le chancelier est élu par le Parlement. Quand les partis décident de le remplacer, comme ce fut le cas pour Schmitt, ils élisent Kohl. Chez nous, le Premier ministre est nommé par le chef de l’État. Si l’on ne peut le renverser qu’en se mettant d’accord sur un successeur, Emmanuel Macron serait assuré de ne jamais être mis en difficulté : il est évidemment impossible que le RN et LFI s’accordent sur un candidat. Pour que ce système fonctionne, il faudrait que le Président renonce à nommer le Premier ministre et qu’il soit élu par l’Assemblée, comme le président de l’Assemblée nationale. Mais alors, à quoi sert l’élection du président de la République au suffrage universel ? On basculerait vers un système parlementaire, aux antipodes de la Vème République, et qui concentrerait en réalité encore plus de pouvoirs au profit du président, ce que les Français refusent aujourd’hui.
Il faut donc raisonner à trois niveaux. D’abord, la capacité de Sébastien Lecornu à bâtir un compromis, même bancal, sur le plan technique. Lionel a raison : Lecornu est talentueux, sympathique, empathique, attentif, compétent et vif. Il a les qualités nécessaires pour réussir. François Bayrou, lui, gouvernait plutôt sur le mode « statue du commandeur ». Nous sommes dans un autre registre, manifestement plus populaire.
On voit bien l’équilibre qui pourrait se dégager : un ajustement budgétaire moins sévère, autour de 35 à 38 milliards d’économies plutôt que 44 ; une contribution accrue des hauts revenus, sans toucher au capital, peut-être via une tranche supplémentaire d’impôt sur le revenu, comme le suggérait Jean Peyrelevade ; un geste de solidarité demandé aux plus fortunés ; et des économies maintenues. C’est faisable. Mais ce qui est exigé par les Français va au-delà : il y a une exaspération sur les inégalités. Elle est documentée par ceux qui dénoncent la situation, mais insuffisamment reconnue par les gouvernements, qu’ils soient Barnier ou Bayrou. Hier encore, à la télévision, un ouvrier de Peugeot comparait son salaire aux rémunérations astronomiques de M. Tavares. On sait que ce dernier était un implacable « cost-killer » mais on sait aussi qu’après avoir coupé les coûts, il n’a plus rien fait. Cela nourrit le sentiment d’un profit indû. Lecornu aura du mal à répondre à cela.
Troisième niveau : l’attitude des forces politiques. Le RN réclame une dissolution immédiate. LFI ne la souhaite pas vraiment — elle pourrait lui être défavorable — mais brandit la menace de destitution et ne pourra pas ne pas voter une motion de censure. Quant aux socialistes, leur position reste incertaine. Les sondages montrent que le bloc central est au plus bas, autour de 11 à 14%, ce qui libère de l’espace au RN et à la gauche. Il y a une opportunité à saisir : Glucksmann l’a bien compris, et Olivier Faure semble décidé à rétablir un rapport de force favorable face à LFI. Fidèle à la tradition mitterrandienne, sa tactique consiste à surenchérir idéologiquement à gauche. L’objectif serait de bâtir une alliance avec les communistes, une partie raisonnable des Verts, et les ex-LFI (Corbière, Ruffin, Autain), pour attirer une partie de l’électorat macroniste. Mais cela suppose que l’élection législative ait lieu avant la présidentielle : sinon, Jean-Luc Mélenchon, présidentiable incontestable, reprendrait la main sur la gauche. La grande incertitude, c’est donc le calendrier : dissolution avant ou après les municipales ? Et sur ce point, Sébastien Lecornu n’a aucune prise.
Michaela Wiegel :
Jean-Louis vient de décrire le dysfonctionnement actuel de la Vème République. Mais son argument contre la motion de censure constructive ne vaut que si l’on se place dans le cadre d’une Vème République fonctionnelle. Or ce cadre est déjà abîmé. Toutes les analyses sur les effets d’une dissolution ou sur l’horizon de 2027 montrent qu’on n’est plus dans une configuration où le scrutin produit automatiquement des majorités absolues pour gouverner. L’introduction d’une motion de censure constructive devient donc pertinente. On voit bien que le président a déjà perdu une partie de son pouvoir de nomination : François Bayrou a pu lui forcer la main, ce qui aurait été impensable dans une configuration normale.
Sébastien Lecornu a été nommé parce qu’il se situe au barycentre de la majorité qu’il faut construire. Avec une Assemblée fragmentée pour longtemps, il faudra repenser les mécanismes institutionnels afin de recréer une stabilité durable.
Lionel Zinsou :
Je suis d’accord avec ce qu’a dit Jean-Louis : le destin du pays est dans les mains des socialistes. Mais il y a beaucoup de courants chez eux, c’est dans leur culture. Nous allons probablement vers un soutien sans participation, une façon de retarder le renversement du gouvernement. Beaucoup de socialistes, y compris l’ancien président de la République, savent qu’en renversant un Premier ministre de plus, on se rapproche d’une crise de régime, pas seulement d’une crise parlementaire, car la pression sur le président deviendrait énorme. Plutôt que de vouloir reconstituer une social-démocratie en récupérant la partie « saine » du macronisme de gauche, on prend un risque considérable. D’abord, celui de voir le RN gagner les élections. Le front républicain n’existe plus, il y aurait de nombreuses triangulaires, et le RN pourrait atteindre une majorité quasi absolue. Par ailleurs, une minorité LR, menée par MM. Sarkozy et Wauquiez, pourrait leur servir d’appoint et devenir le pivot d’une nouvelle donne politique. C’est donc un double risque : celui de la crise de régime et celui d’accélérer l’arrivée du RN au pouvoir. Normalement, cela devrait inquiéter des responsables politiques traditionnellement peu aventureux. Mais Olivier Faure, qui a pris de l’ampleur après avoir gagné la tête du PS avec 0,1 % d’avance dans un contexte de scrutins internes parfois contestés, tente de rétablir un rapport de force.
Avec Antoine, nous sommes entièrement d’accord : il y a un déclin de l’école, un problème à l’hôpital public, une crise du logement. Depuis dix ans, les progrès budgétaires nécessaires n’ont pas été faits, pas plus que les investissements en recherche. Les déficits ont profité à d’autres secteurs. En revanche, le modèle social a été renforcé : couverture universelle, tiers-payant, et surtout une hausse massive des revenus des retraités. Cela a considérablement accru le patrimoine des Français. On parle toujours des salaires comme s’ils représentaient 100% des revenus, alors qu’ils n’en constituent que 50%. Si l’on prend en compte la propriété immobilière, l’épargne et les placements, le patrimoine a connu une croissance historique. Les ménages se sont enrichis : multipropriétés, résidences secondaires, placements locatifs, nombre de voitures par foyer … Les impôts ont baissé, les pensions augmenté, et une part importante des dépenses publiques a été transférée vers les revenus et le patrimoine des ménages. Collectivement, nous avons endetté l’État pour accroître nos patrimoines.
Quant à l’industrie, si nous sommes à 10% du PIB contre 20% en Allemagne, c’est parce que nous avons un secteur tertiaire plus développé. Il n’y a pas de raison d’avoir les mêmes spécialisations.
Antoine Foucher :
Sauf que ces emplois du tertiaire sont mal rémunérés, et cela nourrit la colère sociale.
Lionel Zinsou :
Antoine, je vous rends hommage : vous êtes un amoureux du passé. Vous parlez de réindustrialisation, donc revenons aux Trente Glorieuses, voire à la fin du XIXème siècle, recréons des usines … Cette nostalgie vous honore. Mais l’économie française a choisi une autre spécialisation. Je rappelle qu’avec une industrie très performante, l’Allemagne en est à sa deuxième année de récession. La fascination pour un modèle économique industriel relève de ce que Karl Marx appelait le « fétichisme de la marchandise », mais cela reste une illusion.
Antoine Foucher :
C’est dommage, j’allais presque dire que nous étions d’accord … Deux points. D’abord, Lionel a eu raison de rappeler que nous nous endettons depuis un demi-siècle, mais pas pour financer les biens et services publics qui assurent notre prospérité et notre liberté collective. Nous nous endettons pour augmenter les prestations individuelles : retraites, remboursements de médicaments, etc. Autrement dit, depuis quarante ans, la seule dépense publique qui augmente est la dépense sociale, et en son sein, les prestations individuelles.
C’est cela qui explique notre endettement et notre affaiblissement collectif. Pour le dire de façon gaullienne : depuis quarante ans, nous faisons passer les Français avant la France. Sauf qu’à force d’affaiblir la France, nous compromettons l’avenir des Français. S’enrichir grâce aux transferts sociaux ne sert à rien si l’on ne prépare pas l’avenir : école, industrie, économie prospère, logements, transports, défense (surtout si les Américains nous lâchent).
Quant à l’industrie, il ne s’agit pas de revenir au passé, mais de construire celle de demain. Être en retard peut être un avantage : comme dans les années 1950, nous pouvons rattraper notre retard technologique sur les Américains et les Chinois, à condition d’investir. Socialement et territorialement, il n’y a pas d’avenir pour une France libre et indépendante en Europe sans réindustrialisation. Nulle part dans le monde le progrès social n’existe sans industrie, car les services génèrent moins de gains de productivité. En outre, les services qui enrichissent la France se concentrent dans les métropoles, pas dans les villes moyennes ni les territoires ruraux. Il n’y a que l’industrie qui peut redynamiser ces régions. Si nous voulons une France où l’on peut vivre et améliorer sa vie grâce à son travail partout, et pas seulement dans cinq métropoles, alors il faut réindustrialiser. Et ce n’est en rien passéiste.
Jean-Louis Bourlanges :
D’abord, sur la querelle à propos de l’industrie et des services, je penche plutôt du côté d’Antoine. Je ne crois pas, contrairement à Lionel, que les services suppléent aux défaillances industrielles. Ce qui caractérise l’économie française, c’est un double déficit, budgétaire et extérieur, massif. Cela signifie que nous consommons plus que ce que nous produisons, en quantité et en qualité. Comme disent les syndicalistes, « le compte n’y est pas ». Le problème est posé : il faut créer beaucoup plus de valeur. Pas forcément refaire de la sidérurgie, mais développer une industrie plus sophistiquée.
Deuxième point : la dette que nous accumulons sur la tête de nos enfants. Deux approches existent. Certains craignent un scénario à la Liz Truss : un retrait brutal des marchés financiers qui plongerait le pays en crise. C’est possible si le gouvernement Lecornu prenait des mesures radicales, ce que je ne crois pas. Lionel a raison de dire que ce n’est pas le risque principal.
En revanche, il existe un risque de strangulation progressive : le poids croissant du remboursement de la dette dans le budget. Aujourd’hui, un tiers du budget sert à cela, et cette part va augmenter. Si elle avait baissé ces vingt dernières années, c’est parce que les taux étaient exceptionnellement bas grâce à l’euro et à la garantie qu’offraient les Allemands. Mais rien ne garantit que cela se poursuive. Or, comme nous continuons à laisser filer les déficits — de 27 à 29, de 29 à 32, voire 34 selon les demandes socialistes — nous restons au-dessus de 3% et la dette continue de croître. Nous consommons donc les ressources de nos enfants.
Lionel Zinsou :
Jamais aucune génération n’a fait payer ses dettes à ses enfants. Jamais. En 1946, à la sortie de la guerre, la dette atteignait 250% du PIB. Tout a été résorbé par la croissance et l’inflation, et nous étions retombés à 25% en 1958. Votre scénario ne s’est jamais produit. C’est du pathos : les gens raisonnent comme s’il s’agissait du budget de leur ménage.
Michaela Wiegel :
Dans toutes les comparaisons historiques, il faut intégrer le fait que la France n’est plus une nation monétairement souveraine. Elle ne peut plus jouer avec son endettement aussi librement que par le passé. Cet élément est trop souvent oublié dans le débat public.
Au-delà du fait que la France bafoue actuellement ses engagements européens, c’est une responsabilité collective : à long terme, elle met en péril l’euro si elle continue ainsi. On voit déjà se dessiner la tendance à repousser l’échéance : ne plus viser 2029 pour revenir sous les 3%, abandonner l’objectif des 60% de dette … Si l’on reporte encore, à 2032 ou au-delà, il y a un risque réel de sortie de fait de la zone euro.
Antoine Foucher :
Les générations futures ne remboursent jamais les dettes des générations passées … sauf maintenant. C’est déjà ce qui se passe. La dette actuelle ne vient pas d’investissements destinés à bâtir un meilleur avenir — plus de logements, des transports ferroviaires améliorés, une éducation d’excellence, une défense renforcée avec 3% du PIB pour l’OTAN, ou une industrie rééquilibrant notre balance commerciale. Non. Les 60 milliards d’intérêts que nous payons chaque année proviennent uniquement des dépenses courantes, surtout sociales, notamment les retraites, qui font que le taux d’épargne des personnes âgées n’a jamais été aussi élevé. L’an prochain, budget Lecornu ou pas, nous consacrerons encore plus d’argent à rembourser une dette contractée non pour préparer l’avenir, mais pour financer le niveau de vie du passé.
Aujourd’hui, nous dépensons 75 milliards pour la dette contre 65 milliards pour l’éducation : c’est déjà la preuve que les générations présentes paient les dettes des générations passées, qui n’ont pas investi pour améliorer la vie de leurs enfants. Pour finir sur un pique un peu provocatrice, je reprendrai la brève de Matthias Fekl de la semaine dernière : il citait Michel Schneider, qui disait que la génération du baby-boom était « la première génération à avoir tué le père et le fils ».