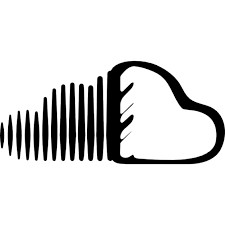L’ASSASSINAT DE KIRK ET LES TENTATIONS ILLIBÉRALES AUX ETATS-UNIS
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Le meurtre par balle de Charlie Kirk, l’influenceur de la galaxie Maga lors d’un meeting dans l’Utah aux États-Unis le 10 septembre, pourrait débrider davantage une violence politique déjà bien ancrée. Trump et ses ministres se disent prêts à limiter le Premier amendement et à déclencher une chasse aux sorcières. Avant même l’arrestation d’un suspect, Donald Trump avait accusé « la gauche extrémiste » d'être responsable de l'attentat, mais également les médias critiques et les démocrates. Le président et ses alliés visent aussi les organisations de gauche accusées de « fomenter » la rébellion, comme la Ford Foundation et The Open Society Foundations du milliardaire George Soros, bête noire des conservateurs. L'administration envisage de supprimer leurs exemptions fiscales. Le Département d'Etat, de son côté, tente d'identifier tout étranger qui a « glorifié, rationalisé, ou fait peu de cas » du meurtre de Charlie Kirk pour révoquer son visa. L’administration américaine menace de réduire la durée des visas des journalistes étrangers et le Pentagone vient d'annoncer que les reporters qui couvrent la Défense devront s'engager à ne publier que des informations approuvées par les militaires, sous peine de perdre leur accréditation. Certains républicains œuvrent à une campagne de délation nationale encouragée par le vice-président J.D. Vance qui a déclaré : « démasquez-les et allez-y, appelez leur employeur ». Des centaines d'employés dans des ministères, des cabinets d'avocats, des compagnies aériennes, ainsi que des dizaines d'enseignants font l'objet d'enquêtes disciplinaires ou ont été limogés pour leurs commentaires « insensibles » et « inappropriés » sur les réseaux sociaux. Lundi, au lendemain d'une cérémonie ayant rassemblé des dizaines de milliers de personnes en hommage à l’influenceur Maga, Donald Trump a signé un décret classant officiellement comme une « organisation terroriste » le mouvement « Antifa ». Il s'agit d'une première puisque les Etats-Unis n'ont à ce jour aucune liste d'« organisations terroristes nationales ».
En 2023 déjà, 48% des Américains reconnaissaient s'auto-censurer en raison du climat politique, selon une étude de l'université de Saint Louis. Pendant la Peur rouge des années 1950, ils ne représentaient que 13,4%. De quoi antagoniser un peu plus la vie politique aux États-Unis. Les étudiants, qui ont grandi pendant le premier mandat de Donald Trump, n’ont pratiquement connu que ce climat de tension politique. Selon un très récent sondage de la Fondation pour les droits individuels et d’expression (FIRE), un tiers de cette génération estime que la violence peut être une réponse légitime pour s’opposer à un interlocuteur public.
Kontildondit ?
François Bujon de l’Estang :
L’assassinat de Charlie Kirk est plus qu’un fait divers : c’est un événement politique et social de la plus grande importance. On pourrait hausser les épaules en disant « encore un assassinat aux États-Unis », pays qui a vu quatre de ses présidents tués et deux autres, Reagan et Trump, échapper de peu au pire. Mais il y a eu bien d’autres personnalités assassinées, de Martin Luther King à George Wallace. Ce serait une erreur de considérer cette affaire comme un épisode ordinaire.
Cet assassinat survient dans un climat de violence politique chronique, exacerbé par Trump, son administration et la majorité républicaine. Ce climat est devenu le cadre naturel de la politique américaine. Lors des funérailles de Kirk, Trump a contredit sa veuve en déclarant qu’il ne pardonnait pas et qu’il haïssait ses adversaires. Il se nourrit de haine et de ressentiment, porté par un goût obsessionnel de la vengeance, comme on l’a vu encore récemment avec la condamnation de l’ancien directeur du FBI, dont il s’est publiquement réjoui. Beaucoup alertent : les États-Unis seraient au bord d’une guerre civile. Non pas une guerre comparable à la guerre de Sécession avec des armées se faisant face sur un champ de bataille, mais une période de troubles graves, comme les années de plomb en Italie ou celles de la bande à Baader en Allemagne.
Charlie Kirk n’était pas un politicien, ni un apparatchik, ni un pasteur. C’était un influenceur de 31 ans, suivi par quatre millions d’abonnés sur YouTube et près de neuf millions sur TikTok, surtout des jeunes de 18 à 24 ans. Il a pesé dans la campagne électorale comme un acteur d’influence inédit. Il incarnait surtout la fusion entre la droite conservatrice dure et les chrétiens évangéliques du Sud, très tôt ralliés au trumpisme. Il portait un « nationalisme chrétien » qui attire aujourd’hui énormément de monde. Or, dès l’attentat, Trump a accusé la gauche radicale, alors que l’assassin présumé appartient en réalité à une mouvance droitière incontrôlée. Et tous les Démocrates ont condamné l’attentat. Ce décalage donne une coloration particulière à l’affaire, qui ne peut qu’encourager la dérive illibérale de Trump et de son administration. Le président américain gouverne déjà de manière autoritaire, sans se soucier des équilibres institutionnels. On l’a vu empiéter sur le Congrès, attaquer les juges, instrumentaliser la Cour suprême, renforcer les pouvoirs présidentiels au détriment de toutes les autres institutions. Aujourd’hui, il appelle à une nouvelle forme de maccarthysme : dénoncer ceux qui ne s’indignent pas assez fort, provoquer licenciements et enquêtes dans les médias, l’éducation, l’administration. Une véritable chasse aux sorcières.
Tout cela renforce une crainte déjà présente : Trump est la plus grave menace pour la démocratie américaine de notre vivant. Rappelons le 6 janvier 2020 et l’assaut contre le Capitole : c’était un coup d’État manqué, comparable à ce qu’ont tenté Gbagbo en Côte d’Ivoire ou Bolsonaro au Brésil. Ce dernier a d’ailleurs été condamné par la justice brésilienne, alors que la justice américaine n’a pas fait le quart de ce travail face à Trump. Avec l’assassinat de Charlie Kirk, il est possible que nous soyons entrés dans une phase qui dépasse la simple menace illibérale : celle d’un régime véritablement autoritaire.
Béatrice Giblin :
Nous sommes en effet bien au-delà d’une « tentation » illibérale : la situation aux États-Unis est aujourd’hui extrêmement préoccupante. Nos collègues universitaires américains vivent dans une profonde inquiétude, une véritable peur. On avait beaucoup parlé du wokisme et du risque de se faire épingler si l’on n’adoptait pas le bon discours. Mais là, c’est autre chose : c’est l’autocensure. On pourrait dire que ces gens manquent de courage, mais ils ont une famille, des enfants, la nécessité de gagner leur vie. Et même les fonctionnaires n’ont pas la même sécurité de l’emploi qu’ici. La recherche, en particulier en sciences sociales, est minée par un climat de suspicion et de dénonciation, aggravé par les rivalités pour obtenir des postes.
Dans ce contexte, j’ai été frappée par les mots de James Comey, l’ancien directeur du FBI : « je n’ai pas peur. » Et surtout : « n’ayez pas peur. Nous devons affronter, nous devons résister. » Une exhortation qu’on entend rarement. À l’inverse, le silence des Démocrates est assourdissant. Même Obama, qui garde une certaine autorité, n’a rien dit alors qu’il aurait pu prendre la parole.
Quant à Trump, il balaie tous les contre-pouvoirs, y compris la Cour suprême où il place ses fidèles. Ils n’obéiront peut-être pas toujours, mais le risque est réel. Son acharnement contre le responsable de la Fed, qu’il avait lui-même nommé, est révélateur : il attend seulement la fin de son mandat parce qu’il ne supporte pas que les taux d’intérêt ne baissent pas. Nous sommes donc déjà au-delà de l’illibéralisme. Les casquettes rouges qu’arborent les MAGA portent désormais la date de 2028, signe qu’il envisage sérieusement un troisième mandat. On parle même de réviser la Constitution. Qui aurait imaginé cela, même au moment de sa réélection ? Les choses vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu’on ne le pensait. Et n’oublions pas que, bien souvent, ce qui se passe aux États-Unis nous atteint ensuite, avec un certain décalage. Serons-nous capables d’y résister ?
Nicolas Baverez :
Ce qui se produit depuis la réélection de Trump était prévisible : c’est un président réélu après avoir organisé une tentative de coup d’État, et les Démocrates comme les magistrats ont fait preuve d’une naïveté incroyable. L’assassinat de Charlie Kirk est donc un tournant. Son organisation s’appelait Turning Point, et c’en est vraiment un. Pour moi, c’est l’équivalent de l’incendie du Reichstag en 1933, que les nazis avaient utilisé pour dissoudre l’État de droit et instaurer un régime totalitaire. L’Amérique ne bascule pas dans un État totalitaire, mais elle n’est plus dans la tentation illibérale : elle est déjà une démocratie illibérale, à la Orbán. C’est une rupture, non seulement avec l’Amérique de notre temps, mais avec l’Amérique telle que Tocqueville l’avait décrite, fondée dès l’origine sur la liberté politique. Trump est en train de rompre définitivement ce lien entre démocratie et Amérique, et il y a une part irréversible dans ce divorce.
Cet assassinat dit beaucoup de l’Amérique actuelle : la violence politique, la désintégration sociale, et cette cérémonie d’obsèques hybride, entre religion, divertissement et meeting politique, reflet d’une vie publique dominée par les réseaux sociaux. Derrière, on retrouve les mêmes dynamiques que dans les années 1930 : individualisme radical, atomisation de la société, communautés juxtaposées, effondrement éducatif – avec 21 % d’illettrés – et, au final, la loi du plus fort.
On retrouve aussi le tournant politique : la veuve et les proches de Kirk ont tenu des propos mesurés, mais Trump, son vice-président et son entourage ont tenu des discours incendiaires. Résultat : les organisations de gauche sont qualifiées de terroristes, on appelle à la délation, aux licenciements, on parle de retirer des licences aux chaînes de télévision. Nous entrons dans une « cancel culture » d’État. Et c’est la fusion de la politique, de la finance, de la technologie et de la religion qui rend la dérive redoutable.
La gauche américaine a une responsabilité énorme : les wokistes ont armé la critique des droits de l’homme et de l’universel, sans voir que ces outils pouvaient être retournés contre la démocratie par un camp disposant en plus de l’État, de la finance, de la tech et de la religion. Aujourd’hui, la machine de guerre « cancel culture d’État » est infiniment plus puissante.
Nous sommes pleinement dans la démocratie illibérale : le suffrage universel demeure mais il est manipulé, les circonscriptions sont redessinées, l’État de droit n’est plus respecté, les pouvoirs sont absorbés par l’allégeance personnelle. Université, médias, science passent sous contrôle politique. La modération et la tolérance disparaissent, remplacées par la peur et la violence.
La conséquence est claire : l’Europe doit réagir. Or, elle fait exactement l’inverse en voulant se réarrimer à l’Amérique de Trump par des concessions commerciales, financières, stratégiques. C’est criminel. Il faut au contraire se dérisquer vis-à-vis de cette Amérique. Sartre avait dit une énormité dans les années 1950 en déclarant « l’Amérique a la rage » pour défendre l’URSS stalinienne. C’était absurde à l’époque. Mais aujourd’hui, si un Sartre du XXIème siècle disait « l’Amérique a la rage », il aurait raison. Nous devons en tirer toutes les conséquences.
Lucile Schmid :
La liberté d’expression est constitutive de la démocratie américaine. George Washington écrivait : « la liberté d’expression peut nous être retirée et, muets et silencieux, nous pouvons être conduits comme des moutons à l’abattoir. » C’est extraordinairement éclairant sur ce que fait Donald Trump : détruire les États-Unis et les fondements universels de la démocratie. Je repense à la déclaration de J.D. Vance à Munich, lorsqu’il reprochait aux Européens de ne pas pratiquer la liberté d’expression, en prétendant vouloir leur offrir un espace. Quelques mois plus tard, il tient un discours totalement opposé. Lui et Trump assument ces contradictions avec aplomb, ce qui traduit un récit incohérent, qui désoriente à la fois la société américaine et les alliés des États-Unis. Elon Musk, de son côté, a osé déclarer que les Démocrates étaient « le parti du meurtre ». Ce n’est pas seulement la violence réelle, c’est l’image de la violence utilisée pour discréditer des adversaires politiques, tandis que les Démocrates restent étrangement silencieux, comme s’ils acceptaient la culpabilité qu’on leur fait endosser.
On a peu parlé de Charlie Kirk lui-même. Son assassinat est intolérable, mais certains Républicains ont appelé à la modération, comme Ted Cruz ou le gouverneur de l’Utah, refusant l’esprit de vengeance. Par contraste, certains élus Démocrates à la Chambre ont tenu des propos révoltants, allant presque jusqu’à excuser l’assassinat au nom des tueries scolaires. C’est donc du côté des Républicains qu’est venu un appel à ne pas franchir une ligne dangereuse. Ce n’est pas anodin, car le Parti républicain a historiquement défendu la liberté d’expression avec plus de force que les Démocrates, longtemps centrés sur la défense des minorités.
Il faut aussi revenir sur la notion de « terrorisme intérieur ». Après la cérémonie d’hommage, Trump a signé un décret classant les antifas comme terroristes. Que signifie un tel terme dans une société coupée en deux ? Potentiellement, chacun peut être considéré comme un terroriste de l’intérieur. Vance a repris la parole après l’assassinat, se plaçant lui-même en figure à la fois de vice-président et d’influenceur, et appelant à la délation. On a compté 60.000 signalements et même des départs en direct, comme celui de Jimmy Kimmel, suspendu pour avoir simplement rappelé qu’on ignorait le profil du suspect.
Cela pose la question des médias officiels. Comment garantir le respect du freedom of speech dans un tel climat ? Le règne de la peur touche aussi des personnalités pourtant protégées par leur notoriété. Les contre-pouvoirs apparaissent aujourd’hui extrêmement affaiblis.
Enfin, je ne crois pas que cette dérive doive être pensée seulement comme une menace future pour l’Europe. Elle est déjà à l’œuvre. Dans nos médias, l’offensive de la droite radicale est manifeste. Et lorsqu’on peut imaginer Jordan Bardella président de la République, on mesure que quelque chose se joue quant à la compétence politique elle-même.
Philippe Meyer :
Concernant l’affaire Jimmy Kimmel, la sanction était-elle trop sévère ou justifiée ? Je n’en sais rien. Ce que je retiens surtout, c’est qu’il a été réinstallé et qu’on n’est pas passé loin de le voir disparaître. Peut-être ai-je tort de choisir le point de vue optimiste, mais face à MAGA, si peu de gens résistent que chaque fissure compte. Il y a eu l’ancien directeur du FBI, le patron de la Réserve fédérale, et maintenant, alors que le Congrès est extraordinairement dégonflé et que la Chambre des représentants est acquise à Trump, il reste quelques individus. Notamment à la Cour suprême, qui n’a pas encore pleinement avalisé l’autoritarisme de Trump. Elle a déjà sacrifié le droit dans bien des circonstances, mais certaines décisions de justice contre Trump sont encore en appel devant elle. On ignore ce qu’elle fera. Les raisons d’espérer sont minces, mais tant qu’elle ne s’est pas totalement avachie, gardons un brin d’espoir.
François Bujon de l’Estang :
Nous vivons effectivement un véritable point de bascule, un moment très menaçant où chacun constate que la démocratie américaine est en péril. Que se passera-t-il en 2028 ? Nul ne le sait. Trump, lui, a déjà annoncé que cela ne le concernait pas et qu’il faudrait changer la Constitution, parce qu’elle est trop formelle. Depuis Franklin Roosevelt, un amendement interdit de faire plus de deux mandats, mais il entend le remettre en cause. Deux mots caractérisent aujourd’hui l’Amérique : la peur et la passivité. La peur est évidente : menaces de licenciement, poursuites, violences. Mais la passivité est plus frappante encore. J’ai vécu vingt ans aux États-Unis, sous des administrations républicaines et démocrates, et je n’ai jamais vu un tel silence.
On déplore l’absence de voix dissidentes chez les Démocrates, mais il n’y en a pas non plus chez les Républicains. Ce climat rappelle celui décrit par Sebastian Haffner dans Histoire d’un Allemand, ou au Rhinocéros de Ionesco. Tout est dit.
LA NOUVELLE CALÉDONIE, APRÈS LES ACCORDS DE BOUGIVAL
Introduction
Philippe Meyer :
Après les accords de Matignon de 1988, puis ceux de Nouméa de 1998, dont l’issue heurtée avait plongé la Nouvelle-Calédonie dans la violence au printemps 2024, un nouvel accord obtenu par le ministre des Outre-mer Manuel Valls a été signé à Bougival, dans les Yvelines, le 12 juillet dernier, entre les indépendantistes, qui demandent l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie, et les loyalistes, qui désirent le maintien de l’archipel dans la République française. L’Accord de Bougival prévoit la création d’un État de Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française, qui jouira de la compétence de relations internationales « dans le respect des engagements internationaux et des intérêts de la France » (sécurité, défense et intérêts vitaux). Il crée une nationalité calédonienne, et donc une double nationalité, puisque les nouveaux nationaux Calédoniens auront aussi la nationalité française. Enfin, il formalise un éventuel processus de transfert des compétences régaliennes – la justice, l’ordre public, la défense et la monnaie, assujetti à un vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes du congrès, et à sa validation ensuite par un référendum.
Toutefois, les indépendantistes du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) ont annoncé début août le « rejet total et sans ambiguïté » de ce texte considéré comme « incompatible avec le droit à l'autodétermination » et « porteur d'une logique de recolonisation ». Une décision jugée « incompréhensible » par Manuel Valls, qui vient d'installer à Nouméa le « comité de rédaction » chargé de traduire l'accord, tout en invitant le FLNKS à « poursuivre la discussion » avec l'Etat et les autres signataires. Si cette opposition frontale de l’Union calédonienne-Front nationaliste calédonien confirme et clarifie la fragmentation préexistante au sein de la mouvance indépendantiste, la question de la viabilité de cet accord se pose avec acuité.
Le durcissement des indépendantistes les plus radicaux fait craindre de nouvelles exactions à une partie de la population, traumatisée par la flambée de violences de mai 2024, à la suite du projet de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral. La mort de douze civils et de deux gendarmes a depuis exacerbé les divisions ethniques au sein de la société calédonienne. Ces émeutes ont également dévasté une économie déjà très fragile, conduisant à la destruction de 500 entreprises et occasionnant pour 2 milliards d’euros de dégâts. Chaque année, l'Etat investit en Nouvelle-Calédonie sous forme de dotations et de rémunérations à hauteur de 1,4 milliard d'euros. En 2024 et en 2025, ces sommes ont été doublées, atteignant 3 milliards d'euros par an. Toutefois, l’économie souffre en Nouvelle-Calédonie : son produit intérieur brut a régressé de plus de 20%, la filière du nickel est à l’arrêt et les institutions calédoniennes demeurent fortement endettées.
Kontildondit ?
Lucile Schmid :
Je ne suis pas sûre que chacun en France sache ce qu’est la Nouvelle-Calédonie et où elle se situe. C’est un territoire lointain, à 17.000 kilomètres, à mi-distance entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et qui couvre plus de 18 000 km², soit 13% de la zone économique exclusive française. Quand Emmanuel Macron parlait d’une stratégie française dans l’Indo-Pacifique, il pensait bien sûr à la Nouvelle-Calédonie. Or ce territoire reste méconnu, bien plus que les Antilles, alors que la Martinique, par exemple, est plus petite que Lifou, l’une des trois îles Loyauté.
La Nouvelle-Calédonie est pourtant un enjeu stratégique majeur. Elle suscite des fantasmes : une convoitise chinoise, une volonté australienne d’en faire une zone d’influence. Il est même apparu que l’Azerbaïdjan aurait joué un rôle dans les émeutes de 2024 pour se venger de la France au sujet de l’Arménie. Depuis 1986, elle figure sur la liste de l’ONU des territoires non autonomes, ce qui confère aux Kanaks, qui veulent faire de la Kanakie un État indépendant, des droits internationalement reconnus. Avec l’accord de Bougival, dénoncé depuis par le FLNKS, on passe d’une logique héritée de Rocard – trois référendums tranchant entre « oui » et « non » à l’indépendance – à une logique du « quand » et du « comment ». L’indépendance est entrée dans l’horizon. Manuel Valls a voulu parier sur la capacité des acteurs calédoniens à définir ensemble l’avenir. Mais l’accord a été adopté sous condition, les négociateurs devant ensuite obtenir l’aval de leurs mandants. Il a fallu s’y reprendre à plusieurs fois, avec un premier accord à Deva, puis une intervention d’Emmanuel Macron, avant d’arracher Bougival.
Et cet accord tord les principes constitutionnels français : il crée un État de Nouvelle-Calédonie au statut d’État associé, pouvant transférer progressivement des compétences régaliennes à la majorité des trois cinquièmes, puis par référendum. Déjà, l’État calédonien dispose de compétences internationales et peut être reconnu par d’autres pays. Il y aura un passeport calédonien lié au passeport français, mais la perte de la nationalité française entraînerait la perte de la nationalité calédonienne …
Tout repose sur le jeu des acteurs. Or le FLNKS s’est divisé entre radicaux et modérés. Même Emmanuel Tjibaou, fils de Jean-Marie Tjibaou et élu lors de la dissolution, n’a pu empêcher son camp de dénoncer l’accord. Du côté loyaliste, au contraire, l’adhésion semble plus nette. Mais un exode migratoire a commencé autour de Nouméa et dans la province Sud, et les difficultés économiques entraînent fermetures d’entreprises et départs massifs. Démographiquement et économiquement, le territoire est en crise. Si l’accord de Bougival n’est pas validé, l’avenir de la Nouvelle-Calédonie restera profondément incertain.
Béatrice Giblin :
Pourquoi cette radicalisation d’une partie du FLNKS ? Emmanuel Tjibaou avait une légitimité et une autorité, mais le FLNKS est une coalition de courants indépendantistes : une lecture binaire masque toute la complexité du dossier. Rappelons qu’il y a eu trois référendums — le dernier, en période de Covid, a été boycotté par les indépendantistes ; les deux précédents (2018 et 2020) avaient donné un « non » nettement majoritaire. Le rapport de forces n’évolue donc pas en leur faveur et, pour beaucoup, jouer le jeu démocratique revient à risquer la défaite. Leur conviction première reste d’obtenir une victoire politique au nom des peuples premiers.
Qu’est-ce que le peuple kanak ? C’est un peuple mélanésien très composite. La Nouvelle-Calédonie compte aujourd’hui environ 260. 000 habitants, dont environ 180.000 dans le Grand Nouméa : la répartition spatiale a été profondément bouleversée (Nouméa comptait moins de 30.000 habitants dans les années 1950). L’urbanisation crée des mélanges et des quartiers très ségrégés ; l’idée d’une « pureté kanak » justifiant l’indépendance est beaucoup trop simpliste. Dans le jeu démocratique, les indépendantistes ne sont pas majoritaires, et la démographie de la population kanak est à la baisse.
Les inégalités sociales sont énormes et le chômage des jeunes, souvent mal formés, est très élevé. Une jeunesse partie du Nord vers le Sud pour trouver du travail peut être utilisée et radicalisée — comme on l’a vu en mai 2024 — provoquant des poussées de violence. La situation est donc extrêmement complexe. Il existe pourtant de sincères volontés de dialogue, tant chez des loyalistes et des Calédoniens non kanak que chez une partie des Melanésiens ; mais une radicalisation s’explique en partie par l’incapacité — ou la crainte — d’obtenir ce qu’on veut autrement que par la force.
Nicolas Baverez :
La Nouvelle-Calédonie est mal connue, mais il faut mesurer l’ampleur de ce qui s’est passé avant Bougival. En temps normal, on compte cinq à six mille policiers et gendarmes sur place. Or, alors qu’on savait le projet de révision constitutionnelle vigoureusement contesté par la frange la plus radicalisée des Kanaks, le dispositif d’ordre public a été réduit à 2.000–2.500 hommes à cause des Jeux olympiques. Résultat : 2,5 milliards de destructions, soit l’équivalent du tiers du PIB local — à comparer aux 8 milliards du PIB de l’archipel. On a détruit un tiers du potentiel économique de l’île, un tiers de la population est au chômage, 18.000 personnes ont quitté le territoire, et l’endettement public atteint 500 % du PIB. C’est une véritable situation de guerre civile.
Dans un tel contexte, aucun investissement n’est possible sans accord politique. Bougival est pourtant un objet politique et constitutionnel non identifié. Sous la Vème République, on connaissait deux schémas : la période transitoire, comme l’avait conçue Rocard, ou l’État associé. Ici, on crée un État au sein même de la République française. En droit, un État suppose un gouvernement, un peuple, et un territoire. Or rien n’est fixé : certains envisagent même une partition. Comment intégrer ce dispositif dans la Constitution, à un moment où nous n’avons ni gouvernement, ni majorité, ni budget ?
Politiquement, une partie seulement du FLNKS est radicalisée et menace les autres. Emmanuel Tjibaou, par exemple, vit sous protection policière et a dû disparaître de la scène publique en raison des menaces. Cela illustre l’incompréhension d’Emmanuel Macron face aux enjeux régaliens. On le voit aussi à Mayotte, en Corse, ou aux Antilles, où la situation est délétère.
Au plan stratégique, la Nouvelle-Calédonie était l’un des piliers de l’axe indo-pacifique français. On peut ironiser sur la menace chinoise, mais l’archipel était la seule île de la région historiquement hors de l’influence de Pékin. L’Australie et la Nouvelle-Zélande, peu portées à la sympathie pour la France, ont réagi avec une grande prudence, preuve qu’elles mesurent le danger : si la Chine mettait la main sur la Nouvelle-Calédonie, ce serait un pistolet braqué sur elles.
François Bujon de l’Estang :
D’abord, il y a un parfum d’anachronisme autour de la Nouvelle-Calédonie. Au moment où la politique intérieure française rappelle la fin de la Quatrième République et les débats parlementaires des années 1950, nous voilà confrontés à un problème de décolonisation qui ne devrait plus être celui de 2025. Même le vocabulaire employé est daté : parler d’« État associé » rappelle les discussions sur le Cambodge et le Laos dans l’Union française.
Ensuite, l’accord de Bougival n’était pas si mauvais. C’était un compromis difficile entre indépendantistes et loyalistes. On avait effectivement produit un « opni » institutionnel, un objet politique non identifié, mais qui pouvait peut-être fonctionner. Le problème est venu du FLNKS : ses trois représentants avaient accepté l’accord, puis ils se sont rétractés. Il faut espérer qu’on réussira à le ranimer, car sans cela, avec un gouvernement limité aux affaires courantes, je ne vois pas comment aborder des sujets constitutionnels d’une telle ampleur.
Enfin, la Nouvelle-Calédonie est essentielle pour notre politique étrangère. La stratégie indo-pacifique que nous tentons de construire avec les États-Unis, la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande repose largement sur elle. Dans le Pacifique, nous n’avons que deux points d’appui : la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Ce qui s’y joue remet donc en cause tout un pan de notre action extérieure.
Lucile Schmid :
Sur ce qu’on appelle le peuple calédonien, Manuel Valls a eu raison de rappeler qu’il s’agit déjà d’un peuple métissé. Le problème actuel, c’est qu’on imagine encore une opposition entre les Blancs et les Kanaks. Or la société calédonienne est aujourd’hui profondément métissée. Le vrai danger serait d’installer une forme de démocratie ethnique qui ne correspond en rien à sa réalité.