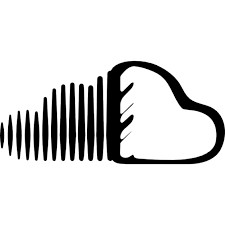LE CHAMBOULE-TOUT FRANÇAIS
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Quatre gouvernements en treize mois, un président affaibli, une Assemblée fragmentée : la France semble prise dans un tourbillon sans fin. La présentation, dimanche soir, par Sébastien Lecornu d'une équipe « resserrée » de 18 membres, dans laquelle les traces de la rupture annoncée n’étaient pas très apparentes a été vivement critiquée à droite comme à gauche. Lundi, en quelques heures, les Français ont assisté à la démission d’un Premier ministre, Sébastien Lecornu, nommé vingt-sept jours plus tôt, puis, en fin d’après-midi, à la désignation par le président de la République du même Sébastien Lecornu pour une mission de quarante-huit heures ayant pour but de « définir une plateforme d’action et de stabilité », soit précisément ce que Le Premier ministre démissionnaire n’avait pas réussi à faire. M. Lecornu a accepté tout en faisant savoir qu’il ne redeviendrait pas chef du gouvernement, même dans le cas, très hypothétique, d’une réussite des discussions.
Estimant qu’il existe « une majorité absolue » de députés opposés à la dissolution, Sébastien Lecornu a affirmé mercredi sur France 2 que les conditions étaient réunies pour que le président nomme un nouveau premier ministre « dans les 48 heures ». La première option pour le président de la République est donc de nommer un nouveau Premier ministre. En cas d'échec, un deuxième scénario serait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale et un retour aux urnes. Le troisième scénario est celui d'une démission du président de la République. Une demande exprimée par l’extrême-droite, LFI, mais aussi, après l’adoption d’un budget par l’ancien Premier ministre Edouard Philippe.
La situation est inédite, puisque les passations de pouvoir n'ont pas eu lieu entre les deux gouvernements démissionnaires. Dans ces cas-là, le décret publié au Journal officiel fait foi. Il a été publié dimanche soir, les ministres démissionnaires sont donc bien ceux qui ont été nommés le 5 octobre. Cette équipe devra gérer les « affaires courantes ». Aucun texte n'indique ce que peut faire, ou pas, un gouvernement démissionnaire, mais ses prérogatives sont limitées. Il s'agit de faire face aux urgences, d'assurer le fonctionnement minimal de l'État ainsi que sa continuité. Ce gouvernement peut mettre en application des lois déjà votées mais pas déposer de nouveaux projets de loi. Généralement, le Conseil des ministres ne se réunit pas en période démissionnaire.
Si l’incertitude politique ne se traduit pas, à ce stade, par une crise économique aiguë, elle a toutefois déjà provoqué deux cassures dont les effets se feront sentir sur le long terme : le déclassement de la France sur les marchés, et la panne des investissements.
Kontildondit ?
Marc-Olivier Padis :
Je suis frappé par cette ambiance de frénésie et de mauvais esprit autour des péripéties politiques récentes. Certes, nous vivons une période de chamboule-tout, mais les termes de l’équation sont connus depuis juillet 2024 et n’ont pas changé : il faut trouver une majorité, et personne ne le veut. C’est autant la responsabilité du Palais-Bourbon que de l’Élysée. Ce piétinement n’a donc rien de surprenant, même s’il est déplorable. Il ne justifie ni la dérision généralisée à l’égard de la classe politique, ni la fébrilité médiatique, avec ses envoyés spéciaux sur « le terrain » (on se demande bien lequel) prêts à interrompre une émission parce que « la voiture du ministre arrive » …
Mais il faut aussi voir la catastrophe dans la catastrophe : à l’instabilité politique s’ajoute une crise budgétaire grave. Le dérapage des dépenses et de la dette a fait grimper le coût de l’emprunt français à des niveaux très élevés. Il y a quelques années encore, nous empruntions à 0%. Aujourd’hui, à 4 %, la situation est tout autre : la charge de la dette va bientôt dépasser le budget de l’Éducation nationale. Le risque est d’entrer dans une spirale où la dette croît plus vite que la richesse du pays. Pour l’éviter, il faudra un effort budgétaire d’environ 120 milliards d’euros, soit 3.500€ à 4.000€ par ménage. C’est colossal, et cela suppose des choix difficiles. Les deux crises se nourrissent l’une l’autre : l’instabilité politique alimente l’incertitude des marchés, ce qui renchérit l’emprunt, tandis que la situation budgétaire dissuade les responsables d’assumer le pouvoir. Il faut aujourd’hui un véritable esprit de sacrifice pour accepter des responsabilités publiques.
Reste à savoir si, comme on l’entend souvent, nos institutions seraient inadaptées à la situation actuelle. Je ne le crois pas vraiment, mais de toutes façons, nous ne sommes pas dans une conjoncture qui permette de les réviser. On peut cependant distinguer deux questions : celle du mode de scrutin et celle de l’usage que fait le président de la République de ses prérogatives.
Le mode de scrutin, d’abord : quand Michel Debré a conçu les institutions de la Vème République, le souvenir de la IVème et de son instabilité pesait encore. Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours avait pour but de construire des majorités stables. Cela a fonctionné pendant des décennies, même en période de cohabitation. Aujourd’hui, ce système présente un défaut majeur : il pousse au vote stratégique et au « barrage républicain ». Beaucoup d’électeurs ont le sentiment de ne plus pouvoir voter pour leurs idées, mais seulement contre un adversaire. Ainsi en 2022, les gens n’ont pas voté pour Macron, mais contre Le Pen ; lors des législatives, la question était « veut-on Jordan Bardella à Matignon ? ». Des électeurs LFI ont été jusqu’à voter pour Gérald Darmanin pour battre un candidat du RN. Ce sentiment d’impuissance nourrit une profonde frustration démocratique.
L’élection présidentielle au suffrage universel direct accentue le problème : le socle réel d’Emmanuel Macron en 2022 ne représentait qu’environ 20% des électeurs. Or, avec cette base réduite, il estime pouvoir appliquer son programme au nom de la démocratie, alors qu’il n’a pas de véritable assise sociale. Cette fragilité se retrouve chez les députés : beaucoup ont été élus grâce aux voix du camp adverse, grâce au barrage républicain, et auraient dû en tirer une obligation de compromis. Pendant un temps, je me disais que ce vote du « moindre mal » avait une vertu pédagogique. Mais à force de voter contre, élection après élection, les citoyens finissent par se sentir exclus. C’est de là que vient la grande frustration démocratique d’aujourd’hui.
Enfin, les institutions de la Vème République ont doté le gouvernement d’outils de discipline parlementaire redoutables : vote bloqué, article 49.3, renvoi en commission mixte paritaire… On en vient à des situations absurdes où un texte du gouvernement lui-même est renvoyé. Il faudrait sans doute réviser ces mécanismes pour rendre au Parlement sa capacité de débattre. Sur la loi Duplomb sur l’agriculture, il n’y a pas eu de discussion réelle ; sur la réforme des retraites non plus. Certes, on dit que les formes ont été respectées. Sauf que ces formes consistent à suspendre le débat. Il faut donc un Parlement qui puisse parlementer — mais aussi des parlementaires prêts à assumer leurs responsabilités.
Béatrice Giblin :
Nous avons aujourd’hui un président qui donne vraiment l’impression de ne pas comprendre le pays, de ne pas entendre ce qui s’y passe. Il se consacre au champ international, où il est applaudi à l’ONU ou bien accueilli dans les conseils européens, ce qui est sans doute plus valorisant que de se confronter aux difficultés internes. Il paraît ne pas mesurer la gravité de la situation, et son silence prolongé devient préoccupant. Peut-être vaut-il mieux qu’il se taise, puisqu’il est désormais si détesté que chaque mot risquerait de jeter de l’huile sur le feu. Mais sur le plan démocratique, cette absence de parole interroge : on dit qu’il faut retourner aux urnes, que cinq ans, c’est trop long, mais que représentent encore les partis ?
La moitié de leurs militants sont des élus ou leurs proches, donc des professionnels de la politique qui ont besoin d’être réélus. Les assemblées générales sont pleines d’assistants, d’élus, de gens qui travaillent dans la sphère politique. Les militants bénévoles, engagés par simple conscience citoyenne, sont devenus très rares. Les anciens partis de gouvernement, comme les Républicains ou le Parti socialiste, n’ont plus de base militante, plus de « troupes », seulement des professionnels qui défendent leur position.
Ce qui frappe aussi, c’est la violence des divisions : dès qu’on n’est pas d’accord, même au sein d’une même famille politique, on est traité de traître. À gauche, entre LFI et le PS, c’est toujours la même histoire : accusations de trahison, procès d’intention, sans débat ni réflexion de fond. Et ce n’est pas mieux à droite. On vit dans la dénonciation permanente.
Et puis il y a le patronat, qui ne montre pas non plus un grand sens des responsabilités citoyennes. Patrick Martin annonce un grand meeting du Medef pour exprimer son mécontentement, alors que lors du conclave, ils ont tout bloqué alors qu’on espérait des avancées sur la pénibilité ou les carrières des femmes. À un moment aussi difficile, ce manque de sens de l’État est consternant. Enfin, je pense à l’attitude des Républicains sur les retraites. Certains de leurs élus n’avaient pas voté la réforme proposée par Élisabeth Borne, la jugeant trop dure, préférant se réfugier derrière le 49-3 dont ils savaient qu’il passerait. Et aujourd’hui, les mêmes en font une ligne rouge, refusant qu’on touche à cette réforme. Écouter Bruno Retailleau parler de cohérence alors qu’il incarne une telle hypocrisie est assez édifiant. Ce manque de constance, cette absence de sens de l’État, résument le problème : comment gouverner avec un personnel politique pareil ?
François Bujon de l’Estang :
Je suis perplexe. La crise que nous traversons est très grave. Elle rappelle à bien des égards la fin de la Quatrième République : instabilité gouvernementale, absence de majorité, usure du pouvoir. S’y ajoutent aujourd’hui des traits propres à notre époque – la communication instantanée, la médiatisation excessive – et une impopularité record du président de la République. La Quatrième s’était effondrée sous le poids de ses institutions faibles et de la guerre d’Algérie ; la Cinquième, elle, ne s’effondrera sans doute pas, mais elle souffre d’un mal équivalent en gravité : la dette et la crise des finances publiques, dont personne ne veut s’occuper.
Ce n’est pas une crise de régime ni une crise constitutionnelle, comme on l’entend parfois. Les institutions tiennent, et elles ne sont pas en cause. Je ne crois pas qu’il faille songer à les réformer. Ce qui est en cause, c’est la manière dont elles sont utilisées. Nous vivons une crise politique profonde, nourrie par l’impopularité du président – tombé à 14 %, le niveau le plus bas depuis François Hollande – et par l’absence de majorité, aggravée par la pusillanimité du personnel politique. C’est aussi une crise de société, car le pays lui-même ne pousse pas ses dirigeants à s’attaquer au vrai problème : la dette. Quand surviendra la crise financière – dans trois ou six mois, peu importe – et que la Banque centrale européenne ou le FMI s’en mêleront, on comprendra qu’il aurait fallu agir plus tôt. Mais ces prises de conscience arrivent toujours trop tard. Nous sommes dans une impasse. Le calendrier politique rend la situation encore plus délicate : tout le monde a les yeux fixés sur 2027, mais la crise budgétaire, elle, n’attendra pas 19 mois. Aucun parti, ni à droite ni à gauche, ne propose de solution pour réduire le déficit, car cela supposerait des mesures impopulaires, impossibles à défendre à moins de deux ans d’une présidentielle.
Les trois scénarios envisagés – coalition, dissolution, démission – sont tous insatisfaisants. La coalition paraît hors d’atteinte : même entre partis alliés, les divisions sont profondes. La dissolution risquerait de reproduire la même impasse électorale : trois blocs se neutralisant les uns les autres. Quant à la démission, elle ne fait pas partie des usages de la Vème République. Si elle devait avoir lieu, il faudrait qu’elle soit préparée, comme celle du général de Gaulle en 1969, annoncée à l’avance, laissant au pays le temps de se projeter et à son successeur naturel, Pompidou, de se préparer. De ce point de vue, la proposition d’Édouard Philippe – avancer la date de l’élection présidentielle sans précipitation – mérite réflexion. Ce serait une façon de redonner du souffle à la vie politique sans provoquer de choc institutionnel. Mais, quelle que soit la solution retenue, une chose est certaine : nous ne pouvons pas attendre mai 2027 pour affronter la question des finances publiques et de la dette. Or pour l’instant, personne ne semble vouloir s’en charger.
Nicole Gnesotto :
Jean de La Fontaine est le premier à avoir employé l’expression « tomber de Charybde en Scylla » dans sa fable « La vieille et les deux servantes », qui se conclut ainsi : « c’est ainsi que le plus souvent, quand on pense sortir d’une mauvaise affaire, on s’enfonce encore plus avant. » C’est exactement ce qui arrive à notre pauvre pays. La première question que je me pose est de savoir si cette crise politique est spécifiquement française ou si elle s’inscrit dans la crise plus large de la démocratie représentative que connaît toute l’Europe. Il y a des deux, je crois.
Ce qu’il y a de spécifiquement français, d’abord, c’est la personnalité du président de la République, très égotique, très verticale. Ensuite, c’est l’hyperprésidentialisation du régime, poussée à un niveau que l’on ne retrouve nulle part ailleurs en Europe (à l’exception, peut-être, de la Turquie, mais elle n’est pas membre de l’Union). Enfin, il y a cette absence de culture du compromis, enracinée dans notre histoire. Depuis 1789, notre tradition politique repose sur l’affrontement : il y a des vainqueurs et des vaincus, et l’on ne transige pas. Cette logique s’est prolongée sous la Quatrième République : entre 1947 et 1958, on a compté vingt-quatre gouvernements. Certes, nous n’en sommes pas encore là, mais l’instabilité actuelle s’inscrit dans cette continuité. Par ailleurs, la France se distingue aussi par la présence simultanée de deux extrêmes forts. Partout en Europe, on observe des extrêmes droites puissantes, mais notre pays est le seul où une extrême gauche très populaire leur fait presque jeu égal. Cela donne à la crise française une coloration nationale singulière.
Mais cette spécificité s’inscrit dans un phénomène plus vaste : la crise de la démocratie représentative en Europe. Partout montent les partis populistes et d’extrême droite, portés par le rejet des élites, du bipartisme de l’après-guerre, de la mondialisation, et souvent par la peur de l’immigration. Vingt pour cent des députés européens ont été élus sur des positions anti-européennes, anti-élitistes, anti-mondialisation. Cette dynamique relie notre crise nationale à celle du continent. En France, le Rassemblement national reste, depuis 2019, le premier parti en intentions de vote. C’est profondément inquiétant. Et même en supposant qu’on règle la très grave crise budgétaire, cela ne suffirait pas à résoudre cette crise démocratique générale. À tout cela s’ajoute une crise de l’État-providence : la perte de confiance des classes populaires et moyennes envers un système qui ne peut plus tenir ses promesses de prospérité et de services publics, dans une économie où la croissance à venir ne dépassera pas 1%. C’est bien plus qu’une crise nationale : c’est une remise en cause profonde de la démocratie européenne.
Béatrice Giblin :
Il y a une autre spécificité française : il est très difficile de faire comprendre les réalités économiques et démographiques du pays aux Français. Le système des retraites est confronté à un double défi : l’allongement de l’espérance de vie et l’augmentation du nombre de personnes très âgées, alors que la population active, elle, diminue proportionnellement. Ce déséquilibre pèse lourdement sur le système par répartition. Partout en Europe, on a réussi à allonger la durée de travail sans provoquer de crises majeures. En France, cela fait plus de dix ans que nous tentons de résoudre cette question, sans succès. Pourquoi nos syndicats refusent-ils de regarder cette réalité en face ? Pourquoi ne parviennent-ils pas à se dégager de l’influence de l’extrême gauche ? Le Parti socialiste, à la traîne de LFI, s’aligne sur leurs revendications. Mais ce qui est frappant, c’est que le Rassemblement national tient exactement le même discours, tout comme Les Républicains, qui, avant même le 49.3, réclamaient eux aussi de maintenir l’âge de départ à 62 ans. Comment une telle convergence est-elle possible ? Et comment peut-on, comme le fait aujourd’hui le Parti socialiste avec seulement 69 députés, réclamer le poste de Premier ministre en affirmant qu’il pourrait faire adopter un budget ? Cette prétention à vouloir gouverner avec un poids aussi faible à l’Assemblée est tout simplement invraisemblable.
LE MOUVEMENT GENZ AU MAROC ET DANS LE MONDE (MADAGASCAR, NÉPAL …)
Introduction
Philippe Meyer :
Le Maroc est le théâtre depuis le 27 septembre de rassemblements quotidiens de jeunes protestataires − parfois mineurs − réclamant de meilleurs services d’éducation et de santé. Début octobre, des débordements violents à proximité d’Agadir ont causé la mort de trois manifestants. Face à une fièvre contestataire comme le Maroc n’en avait pas connu depuis la révolte du Rif en 2016-2017, le gouvernement semble pris de court. Parmi les jeunes urbains de 15-24 ans, la moitié est sans emploi et un quart a déserté l’école. Des marches spontanées avaient déjà eu lieu, début juillet, dans le Haut-Atlas pour l’accès à l’eau, poussant le roi Mohammed VI à manifester son refus d’un « Maroc à deux vitesses », lors de son discours du trône le 29 juillet.
Le mouvement actuel est spontané, sans tête d'affiche et assez flou sur le plan des revendications. Il n’a pas de plateforme ni de programme politique, mais défend des grands thèmes sociaux. Né d’une indignation générale face à la mort de huit femmes à la mi-septembre dans un hôpital d’Agadir après des accouchements par césarienne, il s’est structuré une dizaine de jours plus tard sur le réseau social Discord sous la bannière d’un collectif GenZ 212. Une déclinaison locale (212 est l’indicatif téléphonique du Maroc) d’une génération Z − née entre 1997 et 2012 − qui a déjà fait vaciller le pouvoir au Sri Lanka, au Bangladesh et au Népal, et enfiévré plus récemment Madagascar. Connexion numérique, aspiration à la dignité et rejet de la vieille politique : la jeunesse marocaine se met au diapason d’un soulèvement transnational. Les jeunes Marocains se gardent toutefois bien de franchir une ligne rouge : la sacralité de l’institution royale. Si nombre d’entre eux réclament la démission du chef de gouvernement Aziz Akhannouch, un homme d’affaires richissime, symbole d’une oligarchie conquérante, nul n’appelle à la fin de la monarchie, malgré l’acuité des doléances sociales.
Déjà électrique, le climat social n’a cessé de se tendre, à mesure que les prestigieux projets lancés dans la perspective de la Coupe d’Afrique des nations de football, qui s’ouvre fin décembre, et de la Coupe du monde de 2030 − que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal −détournaient les financements des priorités sanitaires et éducatives. Le régime espérait désamorcer le ressentiment populaire dans le patriotisme sportif : il s’est trompé. « Des écoles et des hôpitaux, plutôt que des stades ! », clame en substance la jeunesse soulevée. La GenZ 212 braque une lumière crue sur l’envers de la vitrine scintillante d’un Maroc « émergent ». Le coup est rude pour l’image que le royaume aime à projeter de lui-même à l’étranger. Le roi Mohammed VI doit faire un discours d’ouverture de la session parlementaire, ce vendredi.
Kontildondit ?
Béatrice Giblin :
Ce qui frappe dans cette révolte, c’est la jeunesse des manifestants. Les images montrent des adolescents de 15 à 17 ans, souvent lycéens, filles et garçons mêlés, certaines voilées, d’autres non, tous animés d’une forme de gaieté dans la contestation. Ce mouvement n’a rien à voir avec ceux du Népal, du Bangladesh ou de Madagascar. Au Népal, la colère visait la corruption et le népotisme d’une classe politique installée depuis des décennies, et elle s’est traduite par une violence extrême : incendie du palais royal, envahissement des institutions, chute du pouvoir. Rien de tel au Maroc.
Ici, le mouvement est né sur les réseaux sociaux — c’est le principal point commun avec les autres pays. Dans ces sociétés du Sud, la jeunesse est désormais massivement connectée, bien au-delà des élites. Contrairement à l’image que l’on en avait, l’accès à Internet est large et diffus, encore plus au Maroc qu’en Algérie. Le royaume a d’ailleurs misé sur le numérique, avec un ministère dédié aux nouvelles technologies dirigé par une femme. Cette jeunesse très connectée représente une part considérable de la population : environ 32% de 15-24 ans, soit quelque 12 millions de personnes. Les deux tiers vivent en ville, dans des zones urbaines qui ont connu une forte croissance démographique. Le niveau d’éducation a beaucoup progressé en une génération : les jeunes Marocains de 18 à 30 ans sont bien plus diplômés que leurs aînés, souvent au prix d’efforts financiers importants de leurs familles. Et pourtant, beaucoup se retrouvent au chômage, avec des taux parfois à 40 ou 50%, voire davantage, ou acceptent des emplois très inférieurs à leurs qualifications. D’où un sentiment profond d’injustice et de frustration ‘: un système bloqué.
Il faut aussi évoquer les inégalités criantes. Le Maroc n’est pas qu’une vitrine – il y a eu des progrès réels, comme la disparition de nombreux bidonvilles, par exemple à Salé (à côté de Rabat) – mais les écarts entre les élites et la majorité de la population restent abyssaux. Ce qui distingue surtout le mouvement marocain, c’est qu’il ne s’en prend pas au roi. Aucun manifestant ne réclame la fin de la monarchie. Par respect pour le commandeur des croyants, sans doute, mais aussi parce que la colère vise avant tout une classe politique affairiste, népotiste et corrompue. Le discours que doit prononcer le roi ce vendredi (10 octobre) sera donc déterminant : saura-t-il trouver les mots pour apaiser une colère profonde, qui ne réclame pas le pouvoir mais la justice, la santé et l’éducation ? Aucun parti politique n’a, pour l’instant, la capacité de récupérer ce mouvement.
Marc-Olivier Padis :
On est effectivement tenté de rapprocher ces manifestations marocaines d’autres mouvements récents : au Népal, à Madagascar, en Indonésie. Les contextes sont très différents, les régimes politiques aussi, et pourtant, certaines ressemblances sautent aux yeux. D’abord, les revendications sont avant tout sociales, et non politiques. Ces jeunes réclament l’accès à l’éducation, à la santé, au travail, bien plus qu’un changement de régime. Ensuite, ce sont des mouvements décentralisés, coordonnés par les réseaux sociaux, notamment Discord. Enfin, ces mouvements s’influencent mutuellement : ils partagent un même symbole, issu du manga japonais One Piece, une tête de pirate coiffée d’un chapeau de paille — celle de héros qui partent à l’aventure pour défier une oligarchie corrompue. Que ce symbole ait circulé du Népal au Maroc montre qu’il existe, sinon une convergence, du moins des échos entre ces soulèvements.
Cette mobilisation de jeunes connectés rappelle deux grandes séquences. D’abord les révolutions de couleur entre 2000 et 2005 : la chute de Milosević en Serbie, la révolution des roses en Géorgie, la révolution orange en Ukraine. Ces pays voisins, issus de l’ex-bloc soviétique, partageaient le même objectif : rompre avec l’influence russe et se tourner vers l’Europe. Puis il y a eu les printemps arabes, entre 2010 et 2012, avec leurs manifestations massives, très jeunes, organisées par les réseaux sociaux — en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie — et, dans un premier temps, l’effondrement de plusieurs régimes. Mais la suite a été tragique : chaos, répressions, retours autoritaires.
La situation semble différente aujourd’hui. Les mouvements sont nombreux, mais leur pouvoir de transformation paraît s’être affaibli. En Serbie, les étudiants manifestent depuis plus d’un an après un drame qui a fait quinze morts dans l’effondrement d’un préau ; le mouvement est massif, plus encore que celui qui avait renversé Milosević, mais le pouvoir reste sourd. Même chose en Iran, où des manifestations d’une ampleur exceptionnelle ont été réprimées par la violence et les pendaisons. En Géorgie aussi, les foules pro-européennes se heurtent à un pouvoir immobile. Les manifestations n’ont donc plus aujourd’hui la force qu’elles avaient autrefois pour changer les régimes. Les systèmes de pouvoir auraient-ils trouvé comment les contenir, les neutraliser, ou les discréditer ? C’est une question qui reste ouverte.
Nicole Gnesotto :
Alors qu’on parle de crise de la démocratie chez nous et en Europe, il est presque rassurant de voir ailleurs dans le monde des aspirations à plus de liberté et de justice sociale. Ce ne sont peut-être pas encore des étincelles démocratiques, mais cela montre que ce désir est universel. Je voudrais insister sur le lien entre ces différents mouvements. Chaque pays a ses spécificités, bien sûr, mais il se passe quelque chose de global. Depuis trois ans, on observe une série impressionnante de soulèvements menés par des jeunes, connectés, sans organisation hiérarchique, qui communiquent à la vitesse du réseau. Et contrairement à Marc-Olivier, je ne crois pas ces élans inefficaces. Au Sri Lanka, en 2022, ils ont renversé un pouvoir en place depuis vingt ans en cinq mois. Au Bangladesh, en 2024, six semaines ont suffi pour faire tomber la Première ministre. En 2025, au Népal, il a fallu deux jours seulement pour renverser le gouvernement. En Afrique, au Kenya, un mouvement de la Génération Z manifeste régulièrement malgré une répression violente. Au Pérou, en septembre dernier, une mobilisation du même type est apparue, et on a vu aussi émerger ces mouvements à Madagascar, et maintenant au Maroc.
Tous ces pays ont en commun d’être des nations en développement, non des pays pauvres. Ce sont des sociétés de niveau intermédiaire, marquées par la corruption, des régimes autoritaires, des inégalités criantes. Ces jeunes n’ont jamais connu un monde sans Internet : ils vivent connectés, informés en temps réel, partageant les mêmes références et les mêmes indignations. Cela crée une conscience collective mondiale. Si l’on reprend les catégories classiques de la science politique, nous sommes peut-être à un moment que l’on pourrait qualifier de pré-révolutionnaire dans plusieurs de ces pays. Autre point commun : ces mouvements surgissent sans structure partisane, à partir d’un incident souvent mineur que le pouvoir n’a pas vu venir. Comme les Gilets jaunes chez nous en 2018. À Madagascar, la colère est née des coupures d’eau et de courant ; au Népal, de l’interdiction de vingt-cinq réseaux sociaux ; au Maroc, de la mort de huit femmes dans une maternité d’Agadir ; en Indonésie, d’une indemnité extravagante votée pour les parlementaires. À chaque fois, c’est la même étincelle : un scandale qui révèle l’injustice sociale et déclenche un mouvement horizontal, spontané, très jeune.
Je vois là quelque chose de profondément positif. Autrefois on disait : « prolétaires de tous les pays, unissez-vous. » Peut-être faudrait-il dire aujourd’hui : « jeunes des pays en développement, unissez-vous. » Reste à mesurer l’effet de contagion. Deux pays me paraissent particulièrement à surveiller : l’Algérie, où le mouvement du Hirak, né en 2019, a été brisé par la répression et la pandémie, et l’Inde, surtout. L’Inde, c’est 1,5 milliard d’habitants, dont 46% ont moins de 25 ans. Pays hyperconnecté, leader des technologies informatiques, mais où 45% des diplômés du supérieur sont sans emploi. Ce cocktail-là pourrait devenir explosif.
François Bujon de l’Estang :
Il y a bien sûr des raisons spécifiquement marocaines à cette fièvre actuelle. L’affaire de la maternité d’Agadir a révélé de façon brutale le sous-développement des services publics. Le Maroc affiche un développement spectaculaire, notamment avec les grands travaux liés à la préparation de la Coupe du monde de football, mais cet étalage de chantiers et d’investissements contraste violemment avec la dégradation de l’école et de la santé. Lorsque le roi affirme ne pas vouloir d’un « Maroc à deux vitesses », il a raison, mais c’est pourtant précisément ce qu’il a aujourd’hui.
C’est une révolte sociale avant d’être politique. Les revendications portent sur les inégalités, sur la justice, sur l’accès aux services essentiels. C’est ce qui distingue ce mouvement marocain du Hirak algérien, qui, lui, était profondément politique et visait le système de pouvoir dans son ensemble. Il existe aussi un phénomène de contagion, comme souvent dans l’histoire. Des vagues de soulèvements traversent les frontières et se propagent comme une fièvre. Ce fut le cas en 1848, avec le printemps des peuples – et pourtant, il n’y avait ni Internet ni réseaux sociaux. Ce fut le cas aussi avec les printemps arabes de 2011-2012. Et avant encore, les protestations des campus américains contre la guerre du Vietnam avaient nourri Mai 68 en France. Chaque pays avait ses raisons propres, mais la contagion était réelle. Nous pourrions bien assister aujourd’hui à un phénomène du même ordre. Les raisons varient – Madagascar, l’Indonésie, le Maroc ont des contextes très différents – mais les réseaux sociaux, comme Discord, TikTok ou Instagram assurent une diffusion inédite des colères et des imaginaires. Que 150.000 Marocains soient sur Discord, ce réseau américain, est en soi révélateur de cette mondialisation des moyens d’expression.
Enfin, la comparaison avec l’Algérie est éclairante : deux pays voisins, en très mauvais termes diplomatiques, mais traversés par des mouvements de nature opposée. Le Hirak algérien exprimait une colère politique contre l’immobilisme et l’opacité du pouvoir. Le mouvement marocain, lui, reste respectueux de la monarchie. Il ne conteste pas le roi, mais dénonce une injustice sociale et un déséquilibre profond. Deux révoltes voisines, mais de nature très différente.