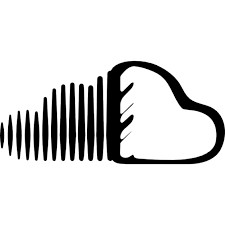QU’ATTENDENT LES FRANÇAIS DES HOMMES POLITIQUES ?
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Après la nouvelle nomination de Sébastien Lecornu à Matignon le 10 octobre, 56 % Français ne souhaitaient pas que l'une des motions de censure déposées par La France insoumise et le Rassemblement national soit votée, selon une enquête "L'Opinion en direct" menée par Elabe pour BFMTV, publiée mercredi. Ils ont été exaucés, avec le rejet des deux motions de censure jeudi matin. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, a annoncé dans sa déclaration de politique générale qu'il proposerait au Parlement la suspension de la réforme de 2023 sur les retraites « jusqu'à l'élection présidentielle ». Selon le sondage Elabe, 67 % des Français sont pour cette suspension et 29 % s'y disent même « très favorables » et 38% « plutôt favorables ». 33 % des Français sont contre cette suspension, dont 13 % de Français qui se disent « très opposés » à cette annonce du chef du gouvernement. Toutefois, 64 % des Français sont mécontents de la composition du gouvernement et 51 % des personnes interrogées sont même favorables à une dissolution et à de nouvelles élections législatives.
Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027, Jordan Bardella et Marine Le Pen se maintiennent en tête des personnalités suscitant le plus de satisfaction si elles remportaient l’élection présidentielle (33 % dans les deux cas), selon le baromètre politique Ipsos bva-CESI École d'ingénieurs pour La Tribune Dimanche. Pour la première fois, la troisième place du podium est occupée par une personnalité du même bord : Marion Maréchal, avec 24 % des Français qui seraient satisfaits. Cette progression de Marion Maréchal dans le classement s’explique par une baisse importante pour les autres personnalités, situées à droite et au centre, comme Bruno Retailleau qui enregistre une forte baisse (20 %, -7 points en un mois). Au centre, on observe aussi des baisses importantes pour Edouard Philippe (22 %, -3 points), Gabriel Attal (19 %, -5 points) et Gérald Darmanin (19 %, -5 points). Le pouvoir d’achat demeure la première préoccupation des Français (50 %, -1 point), devant l’avenir du système social, cité par 44 %. La préoccupation pour l’avenir du système social progresse de 3 points en un mois et de 9 points depuis juillet. 88 % des Français sont pessimistes sur la situation économique du pays et 67 % sur leur propre situation économique. Ils ont notamment le sentiment que la situation du pouvoir d’achat va se détériorer (78 %), tout comme celle du niveau de la dette publique (77 %) ou encore du niveau de la fiscalité (70 %).
Kontildondit ?
Lucile Schmid :
Je voudrais commencer avec une citation d’Olivier Faure : « les Français nous regardent et se demandent si le cirque va continuer. » Elle résume bien l’état d’esprit actuel des élus, des parlementaires et du gouvernement. Invoquer les Français, parler du peuple ou des citoyens est devenu un passage obligé du discours politique, précisément parce qu’on ne sait plus vraiment ce que pensent les Français. L’opinion publique est une boîte noire qu’on tente de sonder en permanence. Mais sait-on vraiment ce qu’est cette société française devenue si imprévisible, à l’image d’une vie politique elle-même imprévisible ? Ce qu’on constate, c’est une méfiance persistante envers le monde politique. Les Français jugent leurs élus corrompus, les partis égoïstes, et n’aiment pas le président de la République. Pourtant, ils font confiance à des personnalités qui n’ont jamais exercé le pouvoir. Et, paradoxalement, ils expriment une sympathie croissante pour leur maire, pour les entreprises et même pour les syndicats. Tout cela traduit le désir d’une démocratie plus large, plus participative, dans un monde où ils se sentent vulnérables. Ils restent toutefois contradictoires : ils veulent qu’on s’occupe de leur pouvoir d’achat, de leur santé, de leurs difficultés concrètes, mais ne croient pas vraiment que les responsables politiques puissent les protéger des effets de la mondialisation.
C’est sans doute pour cela qu’ils aspirent à une démocratie différente. Ils ne savent pas encore sous quelle forme — gouvernement d’engagement, coalition ou autre — mais souhaitent des relations plus directes entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui les élisent. On se souvient des Gilets jaunes et du référendum d’initiative citoyenne qu’ils appelaient de leurs vœux. Aujourd’hui, le Parlement lui-même ne peut guère organiser de référendum, tant les règles sont restrictives.
Enfin, il faut souligner la faiblesse de nos outils pour comprendre cette société : les sondages, souvent fondés sur quelques milliers de personnes pour un corps électoral de près de cinquante millions, montrent leurs limites. On n’interroge presque jamais les Français sur la dette, le budget ou les questions économiques. Les enquêtes tendent à renforcer la séparation entre ceux qui se préoccupent du social et ceux qui se disent responsables de l’économie. Il serait temps d’interroger les Français sur ces enjeux de responsabilité collective, partagée entre représentants et citoyens.
Antoine Foucher :
Je voudrais prolonger ce que vient de dire Lucile, notamment sur la contradiction de nos attentes vis-à-vis du personnel politique. Tout cela, à mes yeux, remonte à la Révolution française et à l’héritage qu’elle a laissé. Bernard Sananès résume bien cette ambivalence en disant : « nous, les Français, détestons les hommes politiques, mais nous en attendons tout. » Les sondages montrent d’ailleurs que nos attentes à l’égard du politique diffèrent profondément de celles des autres Européens. C’est, je crois, directement lié à la Révolution française, qui continue de peser sur nos consciences.
François Furet rappelait que la singularité de cette révolution, par rapport aux révolutions anglaise, américaine ou néerlandaise, c’est d’avoir absolutisé la politique. Nous sommes les seuls à avoir voulu rapatrier sur Terre la promesse du ciel. En suivant Rousseau, nous avons considéré que le mal ne venait pas de l’homme, mais de la société, et qu’en transformant cette société, la politique pouvait créer une société du bonheur. Le communisme n’a été, en ce sens, qu’un prolongement de cette idée révolutionnaire. De là découlent deux traits français. D’abord, une attente immense envers la politique, perçue comme capable de tout accomplir, au-delà même des réalités économiques ou démographiques — on l’a encore vu récemment avec les retraites. Ensuite, un volontarisme presque mystique, qu’on retrouve aussi bien dans le bonapartisme à droite que dans les grandes traditions de gauche : l’idée que la politique peut tout. Ce que nous vivons aujourd’hui, c’est la prise de conscience que cette croyance était une illusion. La politique ne peut pas apporter le bonheur sur Terre, et cette désillusion nourrit notre rapport ambivalent aux dirigeants. Si la formule de Sananès est juste — « nous les détestons, mais nous en attendons tout » — c’est parce que nous attendons l’impossible. Et quand cet impossible ne se réalise pas, la déception se transforme en ressentiment. Jean-Louis disait récemment à ce micro que la détestation des hommes politiques est, au fond, une sorte de haine de soi des Français. Je crois que c’est vrai, pour deux raisons. D’abord, quand on attend de l’État et du pouvoir politique qu’ils nous apportent le bonheur, on finit par les détester, car cette dépendance est insupportable. Elle infantilise la société civile, qui réagit par le rejet. Ensuite, si la Révolution française a effectivement nourri un messianisme politique en remplacement du messianisme religieux, alors nous haïssons les responsables politiques parce qu’ils nous ont maintenus dans cette illusion — et, à travers eux, nous nous reprochons à nous-mêmes d’y avoir cru. C’est cette désillusion collective, née de la foi révolutionnaire dans la toute-puissance de la politique, qui explique notre rapport si paradoxal à ceux qui nous gouvernent.
Jean-Louis Bourlanges :
Je trouve admirable la fresque que vient de dessiner Antoine. Comme Tocqueville ou Furet, il met en lumière ces deux siècles d’histoire qui nous séparent de la Révolution française. Son idée d’une déception religieuse me paraît juste, mais je crois qu’elle ne suffit cependant pas à expliquer la crise spécifique que nous vivons aujourd’hui. Ce qui change, c’est que l’attente quasi religieuse envers la politique se heurte désormais à la certitude qu’il n’y a plus de terre promise. Découvrir qu’aucun salut n’est à attendre du politique est déconcertant pour une société qui en a longtemps espéré le bonheur.
Je formulerais pour ma part un constat : la politique ne paye plus. On a souvent dit que le travail ne payait plus ; c’est vrai, et c’est aussi parce que la politique ne parvient plus à en réparer les effets. Pendant soixante-dix ans, elle a apporté des progrès considérables : sécurité, liberté, solidarité, ascension sociale. Or, sur tous ces fronts, nous marquons le pas ou reculons. D’où un décalage profond entre les attentes des citoyens et ce que la politique peut désormais offrir. Cette crise de confiance touche tout le monde : le président de la République, les partis, les parlementaires. Les seuls qui trouvent encore grâce aux yeux des Français sont les maires, figures de proximité. La participation est devenue le mot magique : « participatif », cela veut dire « je décide ». Mais que devient la participation quand la décision prise n’est pas celle qu’on souhaitait ? La logique conduit à dire que seule la décision qui recueille mon approbation est légitime, ce qui rend toute unanimité impossible. Rousseau l’avait bien vu : c’est parce que l’unanimité est impraticable qu’il faut inventer la règle de la majorité — une règle forcément frustrante. La politique ne paye plus non plus matériellement. Le pouvoir d’achat progresse un peu, mais sans offrir la libération qu’avaient connue les Trente Glorieuses — ce temps où, comme le décrivait Jean Ferniot dans Pierrot et Aline, un couple pouvait accéder à un logement, une voiture, la télévision, et voir sa vie transformée. Aujourd’hui, les progrès sont marginaux. À cela s’ajoute un sentiment de déclin national : notre poids dans la production mondiale diminue, nos valeurs sont contestées, et la comparaison avec d’autres puissances plus dynamiques nourrit l’inquiétude. Enfin, un sentiment d’impuissance s’installe face aux enjeux climatiques, qu’aucune gouvernance mondiale ne parvient à maîtriser.
Tout cela engendre deux types de réactions. D’un côté, des comportements de rupture : la génération des jeunes diplômés, décrite par Monique Dagnaud, se détourne des partis traditionnels et se reconnaît dans une logique de radicalité, voire de décroissance. De l’autre, chez les générations plus âgées, domine la nostalgie — celle du général de Gaulle, figure que tout le monde aime, mais dont personne ne voudrait aujourd’hui. Les contradictions françaises persistent : on rejette les motions de censure mais on réclame des dissolutions ; on veut le changement, mais sans désordre. Le mouvement des Gilets jaunes avait déjà incarné cette tension : un élan protestataire sans projet alternatif. Dominique Reynié le disait récemment : ce qui guette aujourd’hui notre système politique, c’est le vide. Nous n’avons plus de président véritablement légitime, plus de gouvernement soutenu, un Parlement fragmenté. Cette tentation du vide, qui prolonge l’attente déçue d’un pouvoir salvateur, est sans doute ce qu’il y a de plus inquiétant pour les responsables comme pour les citoyens.
Lionel Zinsou :
Vos analyses sont remarquables — théologiques, historiques, philosophiques — mais elles laissent la France enfermée dans son propre miroir, sans perspective comparée. Or, si l’on regarde ailleurs, on constate que cette crise de la politique est largement partagée. En Allemagne, le chancelier Merz est tombé à 29% de satisfaction après à peine 160 jours au pouvoir. Au Royaume-Uni, Keir Starmer, pourtant élu triomphalement il y a quatorze mois, est déjà le Premier ministre le moins populaire de l’histoire du pays. Aux États-Unis, Donald Trump, malgré des succès diplomatiques, affiche le taux de satisfaction le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale à ce stade de son mandat. Au Japon, après des décennies de stabilité, le gouvernement est menacé par une absence de majorité et des divisions internes inédites, au point que l’on pourrait voir pour la première fois une femme diriger l’Empire. Et que dire des pays émergents, où la jeunesse exprime dans la rue son rejet des élites politiques — au Népal, en Indonésie, à Madagascar, au Maroc ? On retrouve là une effervescence comparable à celle de 1968, présente sur tous les continents. La France n’a donc rien d’un cas isolé : elle subit les mêmes chocs qu’ailleurs — une récession plus forte que celle de 1930, une inflation brutale, le désordre des chaînes logistiques, les turbulences du marché du travail, sans oublier la pandémie. Il est normal qu’un tel enchaînement produise un désordre général des esprits.
Quant aux solutions, d’autres pays confrontés aux mêmes crises ont su en trouver. Le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Grèce ont traversé des périodes d’austérité douloureuses, mais en sont sortis avec des finances assainies et une croissance retrouvée. Pourquoi la France ne regarde-t-elle pas autour d’elle ? Nous ne sommes pas originaux. Enfin, la responsabilité n’incombe pas qu’aux politiques. D’autres forces pourraient aider à rétablir des équilibres : les intellectuels, les think tanks, les syndicats — je pense à Laurent Berger et au collectif du Pouvoir de vivre — ou encore la presse. Mais ces ressources sont très peu mobilisées. La presse, notamment, manque parfois des moyens nécessaires pour faire émerger la connaissance et la vérité. On continue à parler du « problème du pouvoir d’achat » alors qu’il existe un excès d’épargne inédit ; on oublie de dire que les aides versées aux Gilets jaunes ont, pour beaucoup, été épargnées. Ce sont pourtant des faits. La France dispose d’économistes, d’experts, de savants — je pense à Philippe Aghion, récemment récompensé par le prix Nobel — capables d’apporter des éclairages rationnels et apaisés. Il faudrait leur donner plus de place dans un débat public trop souvent dominé par la passion.
Lucile Schmid :
Je crois qu’il faut nuancer ce que nous venons de dire sur la passion politique des Français. Ce qui ressort des enquêtes, ce n’est pas tant une passion pour la politique que pour la vie démocratique elle-même, et le sentiment que leurs représentants (sauf ceux de proximité) ne savent plus l’animer. Nous vivons dans une société qui prend conscience que les élus ne sont qu’une partie de cette vie démocratique, désormais plus diffuse, plus partagée. L’instabilité politique récente a d’ailleurs contribué à élargir le nombre d’acteurs auxquels les Français prêtent attention. Il est frappant, par exemple, de voir qu’ils ont une bonne opinion du Conseil constitutionnel, tout en ayant une très mauvaise opinion du président de la République. Il n’y a pas si longtemps, bien peu savaient ce qu’était le Conseil constitutionnel ou le 49-3 ; c’est un signe d’évolution de la culture civique.
Les enquêtes révèlent aussi une société ambivalente, mais pas forcément contradictoire. Les Français veulent à la fois du concret et du symbolique, ce qui rend leurs attentes complexes. Sur la question des migrants, par exemple, ils estiment qu’il y a trop d’étrangers en France, tout en restant attachés à la lutte contre les discriminations ; ils considèrent aussi que, du point de vue de l’emploi, la France a besoin d’eux. Leur approche est souvent pragmatique sur le réel, et plus réactionnaire sur le symbolique. L’enjeu est donc d’articuler ces deux dimensions : le concret et le symbolique, le quotidien et la représentation. Comme le disait Lionel, il y a une forte épargne en France, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté. Il faut parvenir à relier ces deux réalités, à faire tenir ensemble les morceaux épars de ce puzzle qu’est aujourd’hui la société française.
Antoine Foucher :
Il y a effectivement une crise de confiance envers le personnel politique dans tout l’Occident, voire au-delà. Lionel a raison de rappeler qu’elle a un soubassement économique : la crise mondiale mine la confiance dans les gouvernements. Pourtant, au sein de ce mouvement général, la France présente une singularité. Les sondages internationaux le montrent : depuis cinq ans, le niveau de confiance des Français envers leurs responsables politiques est deux à trois fois inférieur à celui de leurs voisins européens. Deux fois inférieur à l’Allemagne, trois fois inférieur aux pays scandinaves. Il ne s’agit donc pas seulement d’un effet de conjoncture économique. En France, la méfiance est plus ancienne, plus enracinée, plus intense.
Ce qui nous distingue aussi, ce sont nos attentes. Nous sommes sans doute le peuple le plus politisé du monde, celui qui attend le plus de la politique. Les historiens le disent : notre société est passionnément politique. On le voit jusque dans la vie quotidienne — à Noël, en France, les conversations de famille tournent autour de la politique, alors que dans la plupart des autres pays, c’est un sujet qu’on évite ou qu’on juge secondaire. Cette passion nourrit forcément la déception : plus on attend, plus on est déçu. Sur le pouvoir d’achat, Lionel a raison de dire qu’il ne baisse pas. Mais il faut aller voir les séries longues de l’INSEE. On distingue trois périodes : les Trente Glorieuses, où le niveau de vie doublait en quinze ans ; les trente années suivantes, où il doublait en une vie de travail ; et les quinze dernières années, où il n’augmente quasiment plus. Ce n’est pas populiste de dire que, pour la première fois depuis 1945, ceux qui travaillent n’améliorent plus leur niveau de vie. Certes, cela ne recule pas, mais ça stagne.
Quant au taux d’épargne élevé, il n’est pas contradictoire avec ce constat : ce ne sont pas les actifs qui épargnent, mais les retraités. Les plus de 65 ans épargnent environ 25% de leurs revenus, et la valeur du patrimoine immobilier a doublé en vingt ans. Oui, le patrimoine français n’a jamais été aussi important, mais cela coexiste avec une génération de travailleurs qui, pour la première fois depuis la Libération, ne progresse plus matériellement au fil de sa vie.
Jean-Louis Bourlanges :
Je ne crois pas que le fait de nous concentrer sur la France signifie que nous ignorons la dimension internationale. Ce n’est pas parce qu’on étudie une maladie sur un rat qu’on pense qu’elle n’affecte pas d’autres spécimens. Le sujet du jour, c’était la France, mais personne ici ne nie que les phénomènes que nous décrivons existent ailleurs — dans tout l’Occident (y compris au Japon, qui, comme chacun sait, se situe à l’ouest de l’Europe et non à l’est). Cela dit, Antoine a raison : il existe bel et bien une singularité française. À savoir l’investissement quasi mystique dans l’État. L’État a été l’artisan de la nation, l’instrument de l’égalité, au prix d’une tension durable avec la liberté. Tocqueville le soulignait : les Américains ont eu la chance de bâtir un État à la fois égalitaire et libéral, alors que nous avons construit un État égalitaire sous l’Ancien Régime et passé deux siècles à courir après la liberté. Cette spécificité se retrouve jusque dans nos crises : Mai 68, par exemple, fut international, mais seule la France a connu cette tentation quasi régicide, habilement surmontée par Georges Pompidou. Elle ressurgit aujourd’hui dans le rapport des Français à Emmanuel Macron, devenu bouc émissaire d’un pays en proie à l’angoisse. Quelles qu’aient été ses fautes ou ses erreurs, la détestation qu’il suscite est disproportionnée. Nous avons besoin de figures à blâmer : le président, parce qu’il est au-dessus ; les riches, parce qu’ils sont trop loin ; les immigrés, parce qu’ils sont différents. C’est une hétérophobie diffuse, une peur de l’altérité, qui traduit une angoisse plus qu’une politique.
Ce qui m’intéresse, dans l’attitude actuelle de Sébastien Lecornu, c’est qu’il introduit un renversement de perspective : jusqu’à présent, tout — le bon comme le mauvais — venait de Macron, et comme Macron était haï, tout était jugé mauvais. Lecornu, lui, replace le Parlement face à ses responsabilités. Le gouvernement propose, le Parlement débat et vote. Il garde la dissolution comme ultime recours, mais il renonce au 49-3 pour que le débat se tienne. Cette démarche a un mérite : elle oblige à sortir des postures et des mythes. Prenons l’exemple des retraites : on va peut-être, enfin, aborder le fond, au lieu de s’enfermer dans un affrontement purement passionnel entre « pour » et « contre ». C’est peut-être — je dis bien peut-être — une voie vers un peu plus de rationalité dans le débat public.
Lucile Schmid :
Je poursuis le débat avec Jean-Louis sur la responsabilité partagée entre les élus et les citoyens. J’ai le sentiment que la société française est aujourd’hui plus intéressante, plus vivante que ses représentants politiques. Mais les études que nous avons examinées révèlent une inquiétude grandissante autour de l’Union européenne. Elle est perçue à la fois comme impuissante et comme une source de tracas pour les Français. Cette ambivalence nourrit peut-être une part de la détestation d’Emmanuel Macron, qui a toujours affiché son engagement pro-européen. Sur ce point, je crois qu’il a eu raison, mais cela lui vaut une impopularité qui en dit long sur notre rapport à l’Europe.
Autre sujet de préoccupation : notre relation au monde extérieur. Comme le disait Lionel, la question est de savoir si la France se replie ou s’ouvre. Personne ne croit à une société autarcique, mais beaucoup de Français se sentent vulnérables face à la mondialisation et attendent des réponses concrètes pour y faire face. C’est sans doute l’une des principales attentes adressées aujourd’hui à leurs élus. Enfin, il faut poser la question de ce que les Français attendent réellement de leurs responsables politiques. Les enquêtes montrent que les personnalités les plus populaires sont désormais issues de l’extrême droite. Cette progression traduit une porosité croissante entre l’électorat de droite et celui du Rassemblement national. Les Républicains, eux, sont à la croisée des chemins : ils doivent choisir entre ces deux pôles d’attraction. Éric Ciotti avait d’ailleurs perçu ce glissement dès l’an dernier. Mais il ne faut pas se tromper : les Français ne souhaitent pas nécessairement le programme du Rassemblement national. Ce qu’ils expriment, c’est une crise de la représentation. Si le Rassemblement national atteindrait aujourd’hui 36% au premier tour d’éventuelles législatives, contre 24% pour une gauche unie (et seulement 19% sans LFI), c’est aussi parce qu’aucun autre parti ne leur propose un projet clair, identifiable, auquel ils puissent adhérer. C’est ce vide de projet, plus que la force d’un programme, qui explique cette situation.
Lionel Zinsou :
Là encore, Lucile, cela n’a rien de spécifiquement français. C’est un phénomène que le Royaume-Uni a connu avec Nigel Farage, une évolution vers l’extrême droite déjà visible avant nous. L’Italie l’a expérimentée, tout comme des sociétés réputées calmes comme les Pays-Bas ou certains pays scandinaves, où se sont formées des coalitions autour d’une union des droites. Autrement dit, il n’y a pas de singularité française : c’est une réaction post-crise. Et c’est pour cela que la comparaison avec les années 1930 garde tout son intérêt — les crises profondes engendrent toujours une tentation populiste. La différence, c’est que nous connaissons la suite de l’histoire. Nous savons ce que deviennent les régimes extrémistes qui ne parviennent pas à se normaliser, à la manière de Giorgia Meloni. Nous savons vers quels dangers cela conduit. Mais cette mémoire historique est-elle encore enseignée ? Je n’en suis pas sûr.
Et il y a, dans ce mouvement de rejet généralisé, une forme de confort : on se défoule, on déteste tout le monde, mais sans réel risque, car nous sommes extraordinairement protégés. Nous ne ressentons plus le besoin vital de réformes qu’avaient connu nos aînés. En 1958, la France devait sortir de l’impasse de la IVème République ; en 1983, il fallait changer de cap pour rétablir les équilibres économiques. Aujourd’hui, l’euro nous protège des dévaluations à répétition, notre protection sociale est robuste, et nous pouvons nous permettre une certaine irresponsabilité budgétaire sans sanction immédiate. Je reviens juste des États-Unis : là-bas, l’absence de budget fédéral bloque tout. Depuis deux mois, les fonctionnaires sont chez eux, non rémunérés. Imagine-t-on cela en France ? Ici, même sans vote, nous aurons un budget, par ordonnance ou par douzième. C’est une véritable singularité française. Notre pays se permet donc un défoulement collectif, une détestation de tous, dans un confort que peu de nations connaissent. Les contradictions que Lucile évoquait — ce mélange de colère et de sécurité — tiennent à cela : nous vivons dans une société protégée, où la pensée politique peut se livrer à toutes les outrances post-crise, précisément parce que quasiment rien ne menace vraiment notre stabilité.
Antoine Foucher :
À propos de la singularité. La semaine écoulée illustre parfaitement, me semble-t-il, le contraire de ce que vient de dire Lionel. Nous avons bien une exception française sur un aspect essentiel du contrat social : l’âge de départ à la retraite. Alors que le Danemark discute d’un relèvement à 70 ans et que l’Allemagne vient de proposer de porter l’âge légal à 73 ans d’ici 2060, nous débattons encore pour savoir s’il faut rester à 62 ou 63 ans. Et pourtant, nous sommes plus jeunes que les Allemands et les Danois. Difficile de nier qu’il s’agit là d’une singularité, objectivement mesurable. Comment l’interpréter ? Par notre foi persistante dans la toute-puissance de la politique. Nous pensons que, malgré le vieillissement démographique, malgré la dégradation du ratio entre actifs et retraités, malgré des cotisations déjà doublées en quarante ans et des prélèvements parmi les plus élevés d’Europe, nous pourrons continuer à travailler plusieurs années de moins que nos voisins. C’est une illusion, et elle plonge ses racines dans la croyance révolutionnaire selon laquelle la politique peut tout, y compris contredire les lois économiques ou démographiques.
Sur la protection, maintenant. Lionel a raison de rappeler que nous vivons dans un système protecteur — et comment ne le serait-il pas, avec 33% du PIB consacré aux dépenses sociales ? Mais cette protection, si réelle à l’échelle individuelle, masque un déséquilibre collectif profond. Nous finançons notre modèle social en sous-investissant dans l’éducation, la formation, la défense, l’industrie, la transition énergétique. Résultat : notre richesse par habitant s’est effondrée. Nous étions le cinquième PIB par habitant il y a cinquante ans, nous sommes aujourd’hui vingt-sixième. Le diagnostic est clair : nous sommes en déclin. Jean Viard décrivait autrefois notre pays comme « bonheur privé, malheur public ». Cette formule s’effondre. Le malheur public devient si fort qu’il finit par entamer le bonheur privé. L’école ne fonctionne plus, les enfants vivront moins bien que leurs parents, nous dépendons des États-Unis pour notre sécurité comme pour notre technologie, et nous sommes dépassés par une industrie chinoise plus compétitive et plus innovante. Il y a de quoi ne pas se sentir protégé par rapport à ce qui vient dans le monde, même avec de bonnes pensions de retraite ...