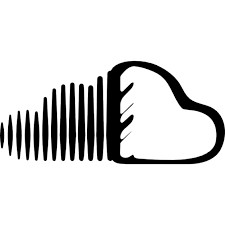BILAN DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Les députés ont commencé le 24 octobre l'examen de la partie recettes du projet de loi de finances (PLF), à l'Assemblée nationale.
Après les trois premiers jours de débat à l’Assemblée nationale, les députés ont dégradé d'environ 4 Mds d’€ l'équilibre de la copie initiale. Lundi, la hausse de 2 Mds d’€ de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises a été votée à l'initiative du gouvernement, mais contre son camp. Les députés ont également adopté une mesure plus favorable aux entreprises, en votant l'article 11 du PLF, qui prévoit de reprendre l'an prochain la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont l'exécutif souhaite la suppression progressive pour « soutenir la dynamique de réindustrialisation ». Mercredi, les députés ont continué à détricoter la copie budgétaire du gouvernement avec l’adoption de deux amendements déposés par LFI : l’un pour élargir le champ d’application de l’impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales, l’autre pour instaurer une taxe exceptionnelle sur les superdividendes. De son côté, le RN a fait adopter grâce à l’abstention de la gauche une taxe de 33% sur les rachats d’actions qui, selon lui, rapporterait 8 Mds d’€. Face à ces revers pour le gouvernement, le bloc central a dénoncédepuis mardi une « surenchère fiscale ». Vendredi, l’article 3 du projet de loi sur le budget : la taxation des holdings a été adoptée par 224 députés, contre 10. La gauche s’est abstenue. La taxe Zucman sur les très hauts patrimoines a été largement rejetée, ainsi que sa version allégée, malgré la pression du PS. Vendredi soir, les députés ont lesté le budget Lecornu près de 45Mds€ de taxes supplémentaires (notamment la taxation proportionnelle des multinationales : 25Mds€, l’extension de la taxe sur les rachats d'actions : 8Mds€, la surtaxe de l'Impôt sur les Sociétés : 6Mds€, et dans la nuit un impôt sur la fortune improductive ...) Le Premier ministre a annoncé de nouvelles discussions avec les différents groupes parlementaires durant ce week-end. Les débats reprendront lundi.
Les députés arrêteront leurs discussions sur le PLF lundi soir, avant de s’attaquer au projet de loi de financement de la Sécurité sociale à partir de mardi. Après son vote, prévu le 12 novembre, les débats pourront reprendre sur les recettes de l’État, pour enchaîner sur la deuxième partie du PLF, concernant les dépenses. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale doivent être adoptés avant le 31 décembre. Les délais sont serrés, entre promesse de ne pas recourir au 49-3 et débats sur la réforme des retraites.
Kontildondit ?
Antoine Foucher :
Même s’il ne s’est écoulé que trente-six heures depuis la fin de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, on peut déjà discerner cinq tendances de fond, en continuité totale avec ce que la France fait depuis un demi-siècle. La première, c’est l’accroissement de la dette. En 1975, elle représentait 20% du PIB ; aujourd’hui, 115%. L’an prochain, nous franchirons un seuil symbolique avec 80 milliards d’euros consacrés au service de la dette : pour la première fois, nous dépenserons davantage pour rembourser les intérêts de la dette que pour éduquer nos enfants.
La deuxième tendance, c’est la hausse continue des dépenses sociales. Elles représentaient 46% du PIB en 1975, 57% aujourd’hui, et cette progression est due uniquement aux retraites, à l’assurance-maladie et à la solidarité. Ce budget poursuit sur cette ligne : suspension de la réforme des retraites, refus d’instaurer une franchise sur les dépenses de santé … Depuis cinquante ans, nous augmentons sans relâche les prestations sociales.
Troisième tendance : la négligence des services publics. Nos dépenses pour l’éducation, la sécurité et la défense stagnent depuis un demi-siècle, en part de PIB. L’an prochain, il y aura 4.600 enseignants en moins. Certes, il y a moins d’élèves, mais la France reste tout de même l’un des pays d’Europe où les classes sont les plus chargées.
Quatrième tendance : la taxation du travail. Elle était de 31% il y a cinquante ans, 40% il y a trente ans, 46% aujourd’hui. L’an prochain, les 28 millions d’actifs — salariés, fonctionnaires, indépendants — paieront encore davantage de cotisations sociales, pour un montant d’au moins 4 milliards d’euros. Plus grave, 800.000 à 900.000 apprentis verront leurs charges augmenter de 22% sur la moitié de leur salaire, soit une perte d’environ 10%. Je trouve cela obscène : faire payer plus ceux qui travaillent pour financer leurs études …
Cinquième tendance : le niveau des prélèvements obligatoires. Il a fluctué : nous avions atteint un record à 45% du PIB en 2017, nous sommes à 43% aujourd’hui, et si les hausses de taxes votées — entre 50 et 60 milliards d’euros — se confirment, nous reviendrons à ce niveau record.
En conclusion, qu’un budget résulte d’un compromis parlementaire, d’une majorité stable ou d’un 49.3, le résultat reste le même : toujours plus de dépenses sociales, toujours moins de moyens pour les services publics, une taxation accrue du travail et un endettement croissant. Résultat : la France, cinquième PIB par habitant il y a cinquante ans, n’est plus que vingt-sixième. On peut blâmer le personnel politique, mais ce budget reflète malheureusement les choix de la société française. Loin de marquer une rupture, il prolonge les tendances profondes de notre société : plus de prestations individuelles, une indifférence aux services publics et une dette toujours considérée comme secondaire par une ancienne grande puissance.
Lucile Schmid :
La France reste attachée à un État-providence fort et à la redistribution sociale, mais la vraie question est : que veulent les Français aujourd’hui ? Les députés semblent convaincus qu’ils souhaitent le maintien de ces tendances lourdes, y compris du déficit. François Bayrou avait proposé d’affronter collectivement la question de la dette, de ce poids transmis aux générations futures. Les députés, eux, ont choisi de prolonger l’endettement pour financer les prestations sociales, sans parier sur l’avenir, ni sur l’éducation, ni sur l’écologie, ni sur la liberté d’entreprendre.
C’est un déni de la promesse portée par Emmanuel Macron en 2017, celle de libérer l’initiative individuelle et d’ouvrir la participation politique. Une grande partie de la société serait prête à faire des choix, mais nos représentants se comportent de manière profondément conservatrice, cherchant à préserver des corporatismes. Chaque camp — socialistes, insoumis, droite — joue son rôle sans véritable ambition de projet. On accuse souvent la société d’immobilisme, mais c’est d’abord à ses représentants qu’il faut demander des comptes : leurs décisions révèlent davantage de la frilosité que de l’audace.
Ce qui frappe dans le débat budgétaire, c’est le caractère de marchandage permanent : un exercice de donnant-donnant, sans ligne directrice claire, ni sur le plan politique ni budgétaire. Dans cette « foire à la saucisse » fiscale, on ne sait même pas ce que rapporteront les taxes proposées. L’administration fiscale, pourtant très compétente, reste en retrait, alors qu’elle pourrait alerter sur la non-opérationnalité de certaines mesures, comme l’a rappelé Roland Lescure. Résultat : on s’en remettra au Conseil constitutionnel pour trier les mesures anticonstitutionnelles et à Bercy pour constater que certaines ne rapporteront rien. C’est un exercice de démagogie.
Il y a aussi un double discours. Officiellement, on évite le 49.3 pour laisser les parlementaires débattre librement. Mais dans les faits, beaucoup d’amendements sont préparés par les administrations, puis transmis clefs en main aux députés. Cela entretient l’idée d’un déni démocratique, d’un « État profond », pour reprendre la formule de Trump. Ce décalage entre la mise en scène et la réalité nourrit la défiance. Enfin, sur les prestations sociales, il faudrait sans doute les limiter, mais en les rendant plus ciblées, conditionnées aux ressources. Dans une société de plus en plus inégalitaire, la redistribution doit être repensée pour devenir plus efficace. Or, le corporatisme domine : chaque parti ménage les retraités, considérés comme clientèle électorale prioritaire. Le Rassemblement National compte sur eux, les socialistes aussi, la droite de même. Mais qui parie sur la jeunesse ? Qui s’appuie sur son émancipation politique ? C’est une question essentielle. Cet exercice budgétaire est donc révélateur : il n’est pas seulement financier, il est démocratique. Et il dit beaucoup de la difficulté de nos représentants à penser l’avenir du pays.
Akram Belkaïd :
L’écrivain Claude Roy, interrogé au début des années 1990 sur la chute du mur de Berlin, avait répondu : « c’est une très bonne chose, il faut s’en réjouir, mais désormais, qui va faire peur aux riches et aux ultra-riches ? » Cette phrase, à sa manière, résume bien le moment que nous vivons. On ne peut pas analyser le budget actuellement débattu à l’Assemblée sans tenir compte du contexte mondial, et plus particulièrement occidental, marqué par une explosion des inégalités. Les écarts de richesse atteignent aujourd’hui des niveaux extrêmes, sans commune mesure avec ceux des décennies passées. Si le discours politique dominant prône la rigueur budgétaire et la réduction de la dette, il faut se demander : qui supporte l’austérité, et comment faire en sorte que les plus fragiles — les pauvres, les jeunes, ceux qui commencent dans la vie — soient les moins touchés ?
Ce débat budgétaire a été parasité par la discussion autour de la taxe Zucman. Tout le monde savait qu’elle ne serait pas adoptée, mais elle a servi de prétexte médiatique pour opposer artificiellement deux camps. Pendant ce temps, la réflexion de fond sur la redistribution et sur la contribution des plus aisés a été écartée. L’Assemblée a balayé la question d’un revers de main. Le Rassemblement National a, ce faisant, confirmé que son prétendu virage social n’était qu’une posture. Quant au Parti socialiste, avec ses propositions timorées, il ressemble désormais davantage à un parti de centre-gauche, voire de centre, qu’à une formation socialiste. J’observe également la disparition d’une droite sociale : Philippe Séguin, par exemple, ne reconnaîtrait plus les siens aujourd’hui. Il faudrait pourtant rouvrir ce débat sur l’effort collectif — sur qui doit contribuer davantage quand la situation du pays se dégrade. Car la situation est réellement préoccupante : l’état des hôpitaux, celui des lignes ferroviaires, ou plus généralement la dégradation des services publics témoignent d’un profond malaise.
Il ne faut pas oublier l’épisode des Gilets jaunes. Sans parler de révolte ou d’insurrection, on retrouve dans la société une colère sourde, palpable, que les débats budgétaires ignorent totalement. Cette colère, si elle continue d’être négligée, pourrait bien peser lourd sur la stabilité des années à venir.
Jean-Louis Bourlanges :
Je partage largement le diagnostic d’Antoine, même si je voudrais l’aborder sous un angle politique. Ce à quoi nous assistons, c’est une tentative institutionnelle inédite de compromis entre des forces qui, depuis la Libération, n’étaient pas fondamentalement opposées mais le sont devenues, notamment depuis que le Parti socialiste a cédé aux sirènes de LFI et adopté une lecture économique et sociale très éloignée de ses fondamentaux.
Le compromis actuel repose sur un accord implicite : le bloc central, autour de Lecornu, renonce au 49.3 pour ne pas imposer le budget par la contrainte, et en échange, les autres partis acceptent une logique de coopération, à l’allemande, fondée sur la négociation et le pragmatisme. En théorie, chacun expose ses priorités et l’on construit un terrain d’entente. En pratique, cela n’a pas fonctionné : le 49.3 a été écarté, mais le gouvernement conserve la possibilité de dissoudre l’Assemblée, un « super 49.3 » en quelque sorte, tandis que la gauche a refusé toute logique de compromis, préférant le débat amendement par amendement. Résultat : une situation chaotique, incompréhensible pour les citoyens, où règne une surenchère permanente. Sur le fond, le compromis devrait d’abord porter sur la dette et les dépenses. Comme l’a rappelé Antoine, la dette est une vieille tendance française, mais elle devient aujourd’hui insoutenable. Nous ne nous contentons pas de toucher le fond, nous creusons encore. Il faudrait donc s’accorder sur une modération forte des dépenses publiques. Ce compromis pourrait reposer sur deux volets : un effort maîtrisé sur les prélèvements et une vraie réduction des dépenses. La droite refuse d’augmenter les impôts, la gauche refuse de réduire les prestations sociales : aucun des deux camps ne bouge.
Deuxième point : la fiscalité. Le bloc central veut protéger l’appareil productif, ce qui est économiquement cohérent. Une taxe comme la taxe Zucman, quelle qu’en soit la forme, reviendrait à prélever sur l’investissement pour transformer du capital productif en consommation immédiate — autrement dit, à détruire la base même de la croissance future. On prend aujourd’hui ce qui ne produira plus demain. La gauche veut taxer davantage les revenus élevés sans se préoccuper de l’assiette productive.
Troisième sujet : la répartition de l’effort. La droite estime que tout le monde doit contribuer, d’où son attachement à la CSG ou à la TVA ; la gauche, elle, veut faire peser l’effort sur les plus riches. Là encore, aucun compromis n’émerge. La gauche, et particulièrement le Parti socialiste, se trouve aujourd’hui face à un choix clair : soit soutenir une politique réaliste, qui préserve les équilibres et le fonctionnement du système, soit céder à la tentation populiste et ouvrir la voie au Rassemblement National. L’arbitrage est là : torpiller le bloc central ou sauver un cadre de gouvernement raisonnable. Quant à la droite, elle est enfermée dans une autre contradiction : obsédée par le rejet du pouvoir en place, elle refuse le loyalisme institutionnel qui devrait pourtant lier toute opposition responsable au président et au gouvernement issus du suffrage universel. Nous avons donc, des deux côtés, des forces politiques qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités.
Lucile Schmid :
Je voudrais revenir sur ce qu’Akram disait à propos de la taxe Zucman, érigée en totem par la gauche. C’était une erreur, car les Français attendent avant tout de l’opérationnalité. Quand les services publics dysfonctionnent — l’école, l’hôpital, les transports, y compris dans les zones rurales — la vraie demande, c’est une dépense publique efficace et un investissement utile. Si le débat budgétaire portait vraiment sur ces questions concrètes, plutôt que d’attendre du Conseil constitutionnel qu’il écarte les mesures irréalistes, il serait plus crédible aux yeux des citoyens.
Cette question d’opérationnalité rejoint aussi ce que disait Jean-Louis sur le jeu d’acteurs politiques. Les socialistes, aujourd’hui, sont dans un embarras constant : ils préfèrent des déjeuners discrets }mais aussitôt révélés dans la presse) avec Sébastien Lecornu, plutôt que de dialoguer ouvertement avec le bloc central. Quant aux députés de ce bloc, ils esquivent les échanges avec les socialistes, craignant de trahir Emmanuel Macron ou de brouiller leur identité politique. Chacun a besoin, en réalité, d’une forme de psychanalyse collective pour clarifier son rapport au compromis et à son propre camp. Sur le plan arithmétique, un véritable compromis ne peut exister sans associer socialistes, bloc central et droite. Cela suppose d’imaginer une coalition à l’allemande, réunissant sociaux-démocrates, libéraux et écologistes — une configuration radicalement nouvelle en France. Mais pour qu’elle voie le jour, il faudra une évolution psychologique profonde des députés, une capacité à dépasser leurs réflexes partisans. Il semble que nous en soyons encore loin.
Antoine Foucher :
Pour prolonger ce qu’a dit Akram sur les inégalités, il faut rappeler que certaines augmentent, mais d’autres non. Les inégalités de rémunération, par exemple, sont stables depuis cinquante ans. D’après les chiffres de l’INSEE 2024, pour passer des 10% les moins bien payés aux 10% les mieux payés, il ne faut pas multiplier son salaire par 100, ni par 50, ni même par 5, mais par 3 : on sort du premier décile à 1 426€, on entre dans le dernier à 4.000€ nets. En revanche, pour le patrimoine, c’est très différent : le rapport est de 1 à 157. Nous sommes donc un pays très égalitaire sur le plan des revenus du travail, mais extrêmement inégalitaire sur celui du patrimoine. D’où l’injustice de toute taxation supplémentaire sur les salaires, quelle que soit leur hauteur.
Le vrai sujet derrière ce budget, c’est celui qu’évoque Marcel Gauchet : l’avènement de la société des individus. Nous n’arrivons plus à faire primer l’intérêt général sur les intérêts particuliers. Prenons la santé. Nos dépenses d’assurance maladie ont augmenté de trois points de PIB, soit 100 milliards d’euros de plus qu’il y a cinquante ans, et pourtant, nous avons moins d’hôpitaux. Pourquoi ? Parce que l’argent va prioritairement aux remboursements de médicaments, donc au pouvoir d’achat individuel. Ce que chacun voit, paie, touche. À l’inverse, financer un hôpital dans un territoire où l’on n’ira jamais soi-même semble abstrait, lointain, inutile. Et dès qu’il est question d’éducation ou de santé, on évoque aussitôt le gaspillage, les 35 heures, les lourdeurs administratives ... Ce n’est pas totalement faux, mais cela traduit un réflexe : on préfère « mieux organiser » plutôt que d’investir dans le collectif. Résultat, notre rapport à l’État est devenu celui d’un client à un prestataire : chacun évalue ce qu’il reçoit ou ce qu’on lui prend, non ce qu’il partage.
Nous privilégions systématiquement l’individuel au détriment du collectif. Tant que nous ne parviendrons pas à renouer ce lien, à refonder la nation à partir de l’individu mais au service du commun, nous continuerons de nous appauvrir collectivement. Pour le dire en termes gaulliens : cela fait cinquante ans que nous faisons passer les Français avant la France, mais à force d’affaiblir la France, nous appauvrissons les Français.
Akram Belkaïd :
Antoine a raison quand il parle des écarts entre les 10 % les mieux et les moins bien rémunérés, mais ce qui m’interpelle, ce sont plutôt les 1%. L’ombre de ce 1% plane sur tout ce budget, et il faut bien le dire. On connaît la concentration des avoirs médiatiques en France, la manière dont certains débats sont façonnés, et cela influence la façon dont les choix budgétaires sont posés. Depuis plus d’une décennie, les prélèvements pesant sur cette catégorie la plus aisée suivent une tendance à la baisse. Dans un contexte où la dette s’accumule et où les profits atteignent des niveaux records, il est légitime de s’interroger : est-il normal que les plus riches contribuent proportionnellement moins ? Ce n’est pas un slogan, mais une question de justice fiscale et de cohésion sociale.
Je voudrais aussi revenir sur la notion de « moyens de production ». Qu’on ne touche pas au capital productif, aux usines, c’est évident. Mais peut-on vraiment parler de « moyens de production » lorsqu’il s’agit de holdings créées uniquement pour optimiser la fiscalité et soustraire des sommes considérables à l’impôt ? Ces structures d’actifs improductifs devraient être au cœur du débat, car elles incarnent une dérive éthique. Or, avoir ce débat devient impossible : on agite des totems, comme la taxe Zucman, qui devient pour les uns la panacée et pour les autres un repoussoir absolu. Ce n’est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c’est de savoir comment réagir face à ces inégalités structurelles et à ces masses d’argent improductif, accumulées sans contribution réelle à l’intérêt général, qui alimentent année après année des classements de fortunes de plus en plus indécents.
Antoine Foucher :
Ce que dit Akram n’est pas incompatible avec les chiffres que j’ai donnés. On entre dans les 1% les mieux payés à partir de 9.000 euros nets par mois : l’écart avec les 10 % les moins bien rémunérés est donc d’environ 1 à 7, et cet écart n’a pas bougé. Ce qui a explosé, ce sont les revenus des 0,1 % — les tout premiers millièmes —, à partir de 22.000 euros nets par mois. Là, les rémunérations ont doublé ou triplé en trente ans. Mais à ce niveau, on ne vit plus de son travail mais de son patrimoine. La concentration de la richesse ne vient donc pas des salaires, mais du capital.
À partir de là, il faut poser la question du sursaut. Lecornu a parlé d’un « budget du déclin », et c’est vrai : ce n’est pas un budget de redressement. Mais un sursaut, d’où pourrait-il venir ? Pas de l’extérieur. L’Europe, et surtout l’euro, nous protègent, mais cette protection a un effet pervers : si nous n’avions plus l’euro, les marchés cesseraient de nous prêter ou exigeraient des taux prohibitifs. Grâce à la zone euro et à la solidité allemande, nous pouvons continuer à nous endetter à moindre coût. Le FMI n’interviendra pas, la Commission européenne imposera tout au plus des règles comptables, et les marchés, eux, n’ont qu’un objectif : être remboursés. Leur intérêt n’est pas la grandeur ou la liberté de la France, mais la sécurité de leurs créances.
Le sursaut ne pourra venir que de l’intérieur, d’une prise de conscience nationale. Et là, je crois que seule une consultation populaire pourrait lui donner la force et la légitimité nécessaires. De Gaulle disait : « les Français ne se rendent pas compte qu’ils n’auront pas toujours un sauveur pour les sauver. » Nous n’en aurons pas, en effet. Dans une société d’individus, il n’y a plus de sauveur collectif. La seule issue, c’est que les Français se sauvent eux-mêmes, en décidant souverainement de réorienter les choix politiques faits depuis cinquante ans. Je crois que ce choix devrait passer par un référendum : non pour déléguer, mais pour affirmer ensemble ce que nous voulons. Si la nation dit oui, elle se redresse. Si elle dit non, elle assumera son déclin, mais au moins elle l’aura choisi en toute conscience.
Lucile Schmid :
Ce que je regrette dans cette discussion budgétaire, c’est la disparition de la figure de l’entreprise. On ne sait plus très bien de quoi parlent ceux qui prétendent défendre la liberté d’entreprendre : défendent-ils une production tournée vers l’avenir, plus verte, plus responsable, ou bien la perpétuation d’un modèle centré sur le luxe, la fast fashion …? Cette confusion est préoccupante, car à mesure que l’État s’enlise, il devient essentiel de repenser le rôle de chacun — entreprises, société, puissance publique — dans une logique d’interdépendance. Or, le débat parlementaire ne s’élève pas à ce niveau. Il est dominé par des professionnels de la politique qui manient les slogans plus qu’ils ne cherchent à comprendre la complexité des choses. D’où un décalage croissant entre ce que vivent les citoyens — ceux qui travaillent, produisent, gèrent des contraintes réelles — et ce qui se discute à l’Assemblée. Ce fossé est particulièrement visible sur les questions économiques et d’exécution budgétaire. Prenons l’exemple de la suspension de la réforme des retraites : le directeur général de la CNAV a averti que cette décision nécessiterait des mois de réexamen des dossiers et risquait de bloquer le versement de pensions à ceux qui y ont droit. Ce genre d’alerte montre bien le caractère parfois fictionnel du débat politique, qui ressemble plus à une série sur Netflix qu’à la gestion concrète d’un pays. Ce décalage se retrouve dans la manière dont on pense le rapport entre secteur public et secteur privé. Il faudrait que réapparaissent dans le débat les entreprises qui innovent, qui regardent l’avenir, qui intègrent les impératifs écologiques. Au lieu de cela, on assiste à une opposition stérile entre une droite figée et une gauche décevante — et je le dis en tant que citoyenne de gauche.
Jean-Louis Bourlanges :
Je voudrais apporter une donnée statistique qui me paraît éclairante. On a souvent l’impression que les 2.000 foyers fiscaux les plus riches forment un bloc homogène, stable, presque immuable. Or, les chiffres montrent au contraire une très forte mobilité. Aux États-Unis, par exemple, une étude révèle que seulement 24% des ménages appartenant au décile supérieur en 1987 s’y trouvent encore vingt ans plus tard : 75% en sont donc sortis. Cette catégorie perd 36% de ses nouveaux entrants dès la première année et encore 16% la suivante. Quant à la mobilité intergénérationnelle, elle est encore plus marquée : à peine 14% des enfants nés de parents appartenant à ce décile supérieur en 1987 y figurent encore en 2007.
Cela signifie que ces très hauts revenus ne forment pas une caste figée mais un groupe mouvant, composé d’entrepreneurs qui montent, redescendent, rebondissent. Rien à voir avec les mythiques « deux cents familles » dont on brandissait la liste dans les rues de Paris en 1936.