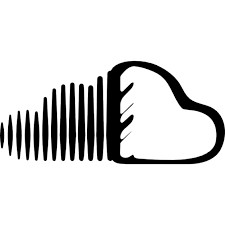Y A-T-IL EN FRANCE UNE GAUCHE DE GOUVERNEMENT ?
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Le 16 octobre, le choix du Parti socialiste de ne pas censurer Sébastien Lecornu a réinterrogé les alliances au sein du bloc non mélenchoniste. Ce vote a profondément divisé la gauche. Une partie de ce camp, incarnée par les socialistes, a décidé de jouer le jeu du compromis avec l'exécutif, obtenant la promesse d'une suspension de la réforme des retraites et un abandon du 49.3. Une victoire sur les retraites accueillie favorablement par la direction de la CFDT perçue comme un jalon dans le rétablissement de liens, aujourd’hui ténus, avec le mouvement social-réformateur. Pour L’historien Mathieu Fulla, ce choix de la non-censure par le Parti socialiste s’inscrit dans « une mémoire partisane qui associe socialisme et défense de la République ». Les socialistes considèrent qu'il vaut mieux faire des concessions, contre quelques victoires. Une autre partie de la gauche, celle emmenée par La France Insoumise mais composée d'une écrasante majorité des députés écologistes et communistes, n'a pas souhaité épargner le gouvernement et entend voter la censure. Les Insoumis, avec leur héritage de la gauche radicale, estiment que tout compromis est un « piège ».
Dimanche dernier, à Pontoise dans le Val-d'Oise, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve organisait un rassemblement, présenté comme « inédit », des « différentes composantes de la gauche réformiste », avec un casting qui ne manquait pas de présidentiables, à dix-huit mois de l'échéance. Outre le président du mouvement la Convention, fondé en 2022 après sa rupture avec le Parti socialiste, on comptait l'ancien président de la République François Hollande, la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, et le député européen et coprésident de Place publique, Raphaël Glucksmann. Une étude publiée par l’IFOP pour L’Opinion et Sud Radio, le 30 septembre, sur le premier tour de l’élection présidentielle de 2027 donne pour la première fois, une longueur d’avance à Raphaël Glucksmann par rapport à Jean-Luc Mélenchon et, dans certains scénarios, place l’eurodéputé au second tour du scrutin face à l’extrême droite. Les participants de ce rassemblement de la gauche réformiste partagent un même refus obstiné de l'alliance avec La France Insoumise. Ici, la culture du compromis continue de tenir lieu de boussole, en opposition à ce qu'ils nomment la « gauche de l'outrance ».
Quoiqu’invité au rassemblement de Pontoise, le premier secrétaire du PS a privilégié, la veille, une autre rencontre. Celle qui réunissait à Trappes dans les Yvelines la gauche dite « unitaire », qui prépare l'organisation d'une primaire afin de désigner un candidat commun en 2027 : PS, Écologistes, Génération.s, L’Après, parti de Clémentine Autain, et Debout, de François Ruffin, autour de l’ex-première ministrable du Nouveau Front populaire, Lucie Castets. Mais, d'une primaire, tous les participants au raout social-démocrate de dimanche n'en veulent pas. À dix-huit mois de la présidentielle, la gauche avance toujours en ordre dispersé.
Kontildondit ?
Antoine Foucher :
Il y a une première manière de répondre à la question « Y a-t-il une gauche de gouvernement ? ». Bien sûr : si l’on regarde les quarante-cinq dernières années, depuis 1981, la gauche a gouverné vingt ans, soit pratiquement la moitié du temps. Elle s’est inscrite dans l’alternance et, lorsqu’elle est au pouvoir, elle assume ses responsabilités. Mais malgré ce constat rapide, la question revient aujourd’hui à cause du débat sur les retraites. La gauche française est la seule en Europe – et peut-être en Occident – à s’accrocher à l’idée qu’on pourrait ne pas travailler un peu plus longtemps malgré l’allongement de l’espérance de vie. Cela révèle un décalage spécifique de la gauche française, et non de la gauche européenne, sur ce sujet.
Pour l’expliquer, il faut revenir à ce qui constitue, en France, la singularité de la gauche. Elle porte une promesse impossible, héritée de la Révolution française : ce que François Furet appelait une absolutisation de la politique. La politique y prend la place de la religion, et le paradis ou la parousie ne sont plus attendus après la mort mais sur Terre, grâce à l’action politique. Il n’y a qu’en France que cette promesse est aussi intense, et c’est la gauche qui la porte encore, même si, comme disait Furet il y a quarante ans, la Révolution est terminée.
Pourquoi cette tension se concentre-t-elle sur la retraite ? Parce que la retraite est la dernière trace de la promesse d’égalité de la Révolution. En France, ce n’est pas seulement une assurance vieillesse, comme le prévoyait la Sécurité sociale de 1945. C’est, pour la majorité des gens, une vingtaine d’années de vie souvent en bonne santé, durant lesquelles on sort de ce que Marivaux appelait la « cascade de mépris ». À la retraite, tous les individus sont égaux, sans maître, puisqu’ils ne travaillent plus. La retraite est une réalisation concrète de la promesse d’égalité de statut issue de la Révolution. La combinaison de cette spécificité de la gauche et de cette spécificité de la retraite explique pourquoi le débat s’enflamme aujourd’hui : la gauche défend la préservation de cet acquis, tandis que partout ailleurs en Europe, la gauche explique à ses électeurs qu’il faudra travailler plus longtemps.
Reste la question de l’avenir. Pour ouvrir la discussion, j’avancerais l’hypothèse que le XXIème siècle pourrait être un siècle de « dextrisme ». Alors que les XIXème et XXème siècles avaient été marqués par un « sinistrisme » où, élection après élection, tout glissait vers la gauche, nous serions peut-être entrés dans une dynamique inverse. Pour la première fois, au Parlement européen, le PPE a rompu son alliance avec la gauche pour s’allier à l’extrême droite. Dans les enquêtes, en Europe comme en France, la fusion entre droite et extrême-droite est déjà actée dans l’électorat ; il ne reste plus qu’aux responsables politiques à la formaliser dans les partis. Aujourd’hui, gauche + extrême gauche représentent 30% de l’électorat ; la droite + extrême-droite 44%. Si ce mouvement de rebascule vers la droite se confirme et s’inscrit dans le temps long, alors il n’est pas certain que la gauche telle qu’on l’a connue – la gauche plurielle, celle de 1981 ou même de 2012 – retrouve un jour le pouvoir dans les décennies qui viennent.
Matthias Fekl :
Personne ne contestera qu’en 2017, la gauche de gouvernement était « explosée façon puzzle ». Il y a des raisons françaises à cela, notamment l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, issu de gouvernements de gauche, et qui a entraîné avec lui une partie de cette famille politique, sans que ces responsables et électeurs se soient vraiment retrouvés ensuite dans la politique menée. Mais c’est aussi un mouvement européen et mondial : en Italie comme en Allemagne, la gauche de gouvernement est affaiblie ; aux États-Unis, les Démocrates ont du mal à se remettre de leurs défaites ; et en Amérique latine, la situation est similaire.
Si l’on prend du recul, la difficulté essentielle vient de l’incapacité de la gauche de gouvernement à montrer qu’elle a tiré les leçons de l’après-1989. Après la chute du mur, beaucoup ont adhéré à l’idée de la fin de l’histoire : l’économie de marché ayant triomphé, elle allait forcément entraîner la démocratie partout, jusqu’en Chine. On voit ce qu’il en est advenu. Le social-libéralisme a dominé la gauche de gouvernement dans nombre de pays. Beaucoup de citoyens ont alors perçu — parfois à raison — que, si la gauche conservait un souci d’humanisation de la mondialisation, elle semblait en même temps trop faible, trop résignée, accompagnant les grandes tendances économiques qui ont mené à la désindustrialisation — en France plus qu’ailleurs —, au décrochage territorial — en France plus qu’ailleurs — et à l’oubli que la social-démocratie est d’abord un rapport de forces. Historiquement, elle repose sur la capacité à établir, dans les entreprises, dans les branches, dans les territoires, dans l’appareil décisionnel, des rapports de forces favorables aux classes populaires et aux classes moyennes.
Un lent mouvement explique donc l’état actuel de la gauche de gouvernement. Un chemin reste possible ; je ne crois pas à un siècle sans gauche, cela serait sinistre. Mais des restructurations sont nécessaires, à condition de regarder la réalité sans fard, de se souvenir que la politique est un rapport de forces, et de se concentrer sur les préoccupations d’aujourd’hui. La France est certainement très à droite sur beaucoup de sujets, mais elle reste profondément avide de justice sociale. Le débat sur les retraites l’a montré, et celui sur la taxe Zucman aussi : quelle que soit l’opinion que l’on en a, il révèle une forte aspiration à davantage de justice. Il faudra, pour y répondre, renouer avec les classes populaires et les classes moyennes, dans un monde toujours marqué par une mondialisation — ou une démondialisation — d’une extrême brutalité.
Béatrice Giblin :
Oui, il existe une gauche de gouvernement. Peut-elle revenir rapidement au pouvoir ? Je n’en suis pas sûre. La gauche de gouvernement est aujourd’hui embarrassée par une extrême gauche qui continue de séduire une partie de l’électorat, notamment un électorat intellectuel : professeurs, enseignants, universitaires, très sensibles à ce discours. Une partie de la gauche française refuse la social-démocratie et, ce faisant, adopte une stratégie d’obstruction permanente, accusant les socio-démocrates d’être des traîtres, des renégats de la pureté révolutionnaire, convaincus que le paradis politique est pour demain. Or l’histoire montre que ce n’est jamais ainsi que les choses se passent. Cette situation est très particulière à la France : il n’y a pour ainsi dire plus d’extrême gauche ailleurs en Europe. Mais nous, nous n’en sortons pas. Le mythe révolutionnaire reste puissant. Il suffit d’écouter Mélenchon : l’immense majorité des Français aspire pourtant à la tranquillité, non à une situation révolutionnaire. Mais comme c’est un bon orateur, un bon tribun, il parvient à faire rêver une partie de ceux qui l’écoutent, leur promettant que demain sera tellement mieux qu’aujourd’hui.
C’est l’un des problèmes majeurs. Et lorsque la gauche plurielle est revenue au pouvoir avec quatre ministres communistes, l’épisode du tournant de la rigueur, en 1983, a été vécu comme un péché originel : après avoir fait campagne sur certains thèmes, elle se serait « reniée » deux ans plus tard. D’où l’idée que ces gens-là ne sont pas fiables, qu’ils mèneront forcément au social-libéralisme — ce que Matthias rappelait. La difficulté actuelle de la gauche de gouvernement tient aussi au spectacle qu’elle offre dans les débats budgétaires : une logique de dépense sans véritable réflexion sur les recettes. Elle ne donne guère de gages de crédibilité. Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer qu’elle puisse convaincre les électeurs de sa capacité à revenir au gouvernement.
Jean-Louis Bourlanges :
Sur le « dextrisme », je trouve l’expression d’Antoine vraiment éclairante. Elle me rappelle une phrase du doyen Barthélémy, grand professeur de droit – de triste mémoire puisqu’il a fini Garde des Sceaux à Vichy, inventant les sections spéciales. Mais dans les années 1930, il se présentait à ses étudiants en disant : « je suis un républicain de gauche, donc un homme du centre, que les malheurs des temps obligent à siéger à droite. » Et, en l’écoutant, j’ai tendance à inverser la formule : je suis un républicain de droite, donc un homme du centre, que les malheurs du temps vont peut-être obliger à siéger à gauche. Cela traduit bien l’évolution en cours …
Sur la social-démocratie, le terme me semble impropre. Je comprends ce que signifie être démocrate et socialiste, mais la social-démocratie, historiquement, est un mouvement du Nord de l’Europe, d’Allemagne, du Royaume-Uni, des pays scandinaves : un mouvement où un parti socialiste s’appuie sur un puissant mouvement social qui lui fournit ses forces, ses moyens, ses dirigeants. En France, nous n’avons jamais connu cela. Le XIXème siècle a été marqué par une rupture profonde entre l’Assemblée nationale et la classe ouvrière, en 1848 comme en 1871. Toute la culture politique française s’est ensuite construite sur la séparation du fait syndical et du fait politique – la Charte d’Amiens en est l’expression la plus nette.
À mes yeux, le Parti socialiste n’a jamais vraiment existé idéologiquement ; c’est un imaginaire. Si l’on regarde son histoire, on voit trois forces principales. La première est l’alluvion blanquiste-bolchevique. Grimbert l’a bien montré dans ses analyses sur Blum : après Tours, Blum est horrifié par le léninisme, mais il n’arrive pas à renoncer à la dictature du prolétariat et hésite longtemps avant de rompre avec la IIIᵉ Internationale. Il ne devient vraiment Blum qu’à partir du procès de Riom, lorsqu’il découvre que son combat est d’abord celui de tous les Républicains. Après la guerre, il en tire les conséquences : pour l’Alliance atlantique, pour l’Europe, et hostile, avec Auriol et Ramadier, au maintien des communistes au pouvoir en 1947.
La deuxième force est un libéralisme de gauche, moins keynésien qu’on ne le dit, qui admet le fonctionnement du secteur capitaliste, même s’il permet d’étendre le secteur public. Et la troisième force est ce qu’on a appelé la deuxième gauche, née des années 30 avec la révolution introduite par le cardinal Liénart dans la CFTC : rupture avec le paternalisme patronal, légitimation de la coalition ouvrière, appui sur la loi Waldeck-Rousseau, valorisation du dialogue et de la négociation. C’est une culture où l’État peut jouer l’arbitre. Trois forces donc, qui n’ont jamais très bien fonctionné ensemble, sauf lorsqu’elles ont été arbitrées par quelqu’un venu de l’extrême droite devenu président de la République … Il y a là une fragilité idéologique structurelle.
Pour répondre plus précisément, trois éléments me paraissent déterminants. D’abord, la culture de gouvernement. Les socialistes ont fini par s’en détourner. Sur les retraites, sur le déficit, sur la dette, ils refusent la réalité. Ils revendiquent des « victoires » obtenues dans des négociations, mais sur des positions structurellement irréalistes. Deuxième élément : l’évolution idéologique. Le mélenchonisme a introduit une rupture profonde au sein de la gauche. La radicalité s’y identifie à un islamisme politique, c’est à dire le refus de tout ce pour quoi les socialistes se sont battus : la laïcité, l’État de droit, le pluralisme. Cela les atteint au plus profond. Le seul qui semble vouloir s’en dégager clairement, c’est Glucksmann, mais il est évidemment placé sous forte suspicion. Troisième élément : les alliances. Si Macron a pu être élu sur sa base idéologique, c’est parce que la droite virait à l’extrême droite et la gauche à l’extrême gauche. La conjonction du centre droit et du centre gauche – ce libéral-social européen qui était le langage de l’UDF, de Giscard ou de Barre – rendait possible un espace central majoritaire. Macron a échoué pour des raisons diverses, mais il est frappant de voir à quel point Glucksmann reprend aujourd’hui les cartes du macronisme de 2017 : il est de gauche, mais ne peut réussir qu’en reconstituant un accord avec le centre et en rompant avec LFI. Sur ces trois plans – culture de gouvernement, virage idéologique, recomposition des alliances – nous sommes encore loin du compte.
Philippe Meyer :
Reste la question des hommes, et l’on commence à voir les limites des uns et des autres. Le dernier à être apparu, Raphaël Glucksmann, me semble avoir l’épaisseur politique d’un ectoplasme …
Antoine Foucher :
Je voudrais prendre au sérieux la provocation de Jean-Louis lorsqu’il dit « le Parti socialiste n’existe pas ». Cela rejoint, me semble-t-il, à la fois l’aspiration à une restructuration évoquée par Matthias et ce que décrivait Béatrice sur la gauche continuellement empêchée par l’accusation de trahison portée par l’extrême gauche. Ces trois questions n’en forment en réalité qu’une seule : si l’on adoptait une approche psychanalytique, on pourrait dire que c’est la question du surmoi de l’extrême gauche sur l’ensemble de la gauche française. Et cela, pour le coup, est une spécificité nationale.
Je crois que cela s’explique par l’intensité de la promesse née de la Révolution française, dont la gauche — PS compris — n’arrive pas à se défaire, parce qu’elle porte aussi une part de l’identité française. Depuis deux siècles, ce qui nous définit le plus par rapport au reste du monde, c’est la Révolution française. La gauche en a assumé l’héritage, et l’extrême gauche en représente la version la plus religieuse, la plus intense, totalement détachée du réel. La gauche modérée — sociale-démocrate, ou gauche de gouvernement, peu importe le terme — tente depuis toujours de concilier cette promesse impossible avec la réalité des aspirations sociales. Or, la restructuration que Matthias appelle de ses vœux ne verra jamais le jour si cette gauche modérée ne rompt pas clairement avec cette promesse quasi religieuse de la Révolution française. Il faut dire aux Français que la politique ne changera pas la vie dans ce qu’elle a de plus essentiel : elle ne changera rien au fait que nous mourrons, que le plus important reste l’amour, que la vie est absurde et que ces paramètres fondamentaux ne relèvent pas de l’action publique. La politique peut améliorer des choses, mais elle ne peut pas accomplir la promesse d’un salut terrestre.
Jean-Louis Bourlanges :
C’est très mobilisateur, reconnaissons-le.
Antoine Foucher :
Oui, mais c’est précisément pour cela qu’elle n’y arrive pas. La gauche ne rompt pas avec cette promesse religieuse parce qu’elle sait qu’elle n’est pas politiquement porteuse, et c’est aussi pour cela que la Révolution française continue de résonner deux cent cinquante ans après. Il est extrêmement difficile de renoncer à un discours politique qui prétend répondre, collectivement, à la question du sens de la vie et à la question du mal.
Derrière la Révolution française, il y a une anthropologie très forte : le mal n’est pas dans l’homme, il est dans la société. Changeons la société et nous serons débarrassés du mal. Toute la promesse s’enracine là. Tant que la gauche ne rompt pas avec cette vision – ce qui est très difficile, parce que ce n’est pas mobilisateur –, et tant qu’elle ne rompt pas avec l’extrême gauche qui la lui renvoie sans cesse comme exigence, elle aura, me semble-t-il, énormément de mal à revenir au pouvoir.
Matthias Fekl :
Il faut toujours, pour mobiliser, un élan et un message porteur d’espoir. La vraie question est de savoir où cet élan s’arrête, où commence le mensonge ou le cynisme. C’est un autre problème, mais il existe. Grunberg et Bergounioux ont écrit un très bon livre, Les socialistes français et le pouvoir : l'ambition et le remords, qui montre bien le rapport ambivalent de la gauche au pouvoir : exercer le pouvoir implique toujours une part de renoncement à l’idéal, et la gauche a sans doute plus de mal que la droite à assumer ce renoncement.
Sur plusieurs points, je rejoins tout à fait ce qu’a dit Jean-Louis, notamment sur le lien entre politique et mouvement social, qui est la grande différence entre la France et l’Allemagne. Nous avons certes la CFDT, syndicat puissant, issu du catholicisme comme Jean-Louis l’a rappelé, mais profondément marqué par le réalisme et capable d’obtenir, combat après combat, des avancées considérables. Dans un paysage syndical aussi pluraliste que le nôtre, cela expose toujours au risque de surenchère de la part de ceux qui n’assument pas ces responsabilités.
Je voudrais ajouter deux choses. D’abord, dans un contexte de perte de radicalité, la gauche raisonnable – quel que soit le nom qu’on lui donne – a beaucoup de difficultés. Comment être une gauche de gouvernement à l’heure de l’information en continu, des réseaux sociaux, du complotisme ? C’est une question majeure. Ensuite, il y a la question de l’incarnation sous la Vème République. C’est absolument central. J’ai trouvé Philippe un peu dur envers Raphaël Glucksmann : aujourd’hui, il y a sans doute trop d’incarnations possibles pour la gauche de gouvernement, et c’est un problème, mais dans des institutions aussi personnalisées et hyper-présidentialisées – dont je pense le plus grand mal –, on ne peut pas faire l’économie de cette dimension.
Jean-Louis Bourlanges :
Par rapport à ce que dit Antoine, je crois qu’il faut élargir le propos. L’eschatologie (étude des fins dernières) politique n’est pas le monopole de la gauche. Cette projection religieuse et politique vers une fin rédemptrice a structuré toute notre histoire, et elle s’est effondrée depuis une vingtaine d’années. Elle a pris trois formes. D’abord, la forme libérale-scientiste, à l’époque de Ferry. J’ai beaucoup relu Ferry récemment : il perçoit très bien qu’il a un problème avec la mort, et que son système peine à y répondre. Ensuite, l’eschatologie bolchevique, qui sort directement du jacobinisme, ce que Furet analyse avec une grande clarté. Enfin, l’eschatologie chrétienne. Les deux premières se situent dans l’horizon temporel et politique ; la troisième reste dans l’horizon spirituel. Mais les trois ont été frappées. Le scientisme a été le premier à décliner au cours du XXème siècle. Le bolchevisme s’est effondré dans les conditions que l’on sait. Et le catholicisme s’est écroulé avec la chute vertigineuse de la pratique religieuse. Nous sommes désormais une société désertée par l’espérance finale, et la conjonction de ces effondrements est quelque chose de très difficile à vivre.
Béatrice Giblin :
Toute la société n’est pas uniformément désemparée par cette disparition de l’espérance. Il existe encore des convictions religieuses, et c’est précisément sur cela que jouent aussi ceux qui restent dans l’eschatologie révolutionnaire. L’islam (et l’islamisme) reposent eux aussi sur une logique eschatologique. Et il y a, de ce point de vue, un point commun entre les deux.
Jean-Louis Bourlanges :
Pour répondre à Matthias, oui, le catholicisme social, et notamment la CFDT, a joué un rôle très important. Et je crois que la grande erreur, la grande faute historique de Macron, c’est de ne pas avoir réussi à accrocher les wagons avec cette tradition-là. Du coup, cela repose la question que pose Glucksmann, objectivement ou subjectivement : pour que sa démarche réussisse, il faudrait renouer avec cette veine, ce qui impliquerait en réalité la reconstitution d’un macronisme de gauche.
Antoine Foucher :
La discussion conduit, me semble-t-il, à une question centrale : dans une société laïcisée, où la grande majorité des individus ne croient plus en Dieu et ne s’appuient plus sur l’eschatologie chrétienne pour donner un sens à la vie et à la mort, les mouvements politiques ne sont-ils pas condamnés, d’une manière ou d’une autre, à combler ce vide ? Dans les sociétés les plus sécularisées, n’est-ce pas précisément là que la politique rapatrie le plus la religion sur terre en se mettant à promettre davantage ?
La question reste ouverte. Mais si l’on regarde les choses historiquement, ce mécanisme est très clair chez nous, en France. Et il y a un autre peuple qui se trouve dans une situation comparable, même si je le connais beaucoup moins : la Tchéquie. D’après les enquêtes que j’ai consultées, c’est, avec les Français, le peuple le plus laïcisé, celui où l’on croit le moins en Dieu. Et là aussi, on observe un investissement dans la politique qui, sans atteindre le niveau français, est très fort.
L’ALGÉRIE ET LA FRANCE : ENTENTE IMPOSSIBLE, RUPTURE IMPROBABLE
Introduction
Philippe Meyer :
Entre embellies et tensions, la relation entre la France et l’Algérie oscille sans cesse. Après une série de différends entre les deux pays, le 31 juillet 2024 allait marquer un tournant majeur : à la surprise générale, le président français est sorti de sa traditionnelle neutralité sur le dossier ultrasensible du Sahara occidental en reconnaissant la souveraineté marocaine sur ce territoire disputé par Rabat et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par Alger. Ce revirement spectaculaire provoqua la colère de l’Algérie, qui rappela son ambassadeur et suspendit la coopération entre les deux pays, notamment en matière de politique migratoire, de sécurité et d’accords économiques. Ce fut le début d’une des crises diplomatiques les plus graves depuis l’indépendance en 1962.
Après plus d'un an de cette crise émaillée par l’arrestation à Alger en novembre 2024 de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié le 12 novembre dernier et de retour en France, le nouveau ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, multiplie les déclarations exprimant sa volonté de renouer « le dialogue » avec l'Algérie. Il se démarque ainsi de son prédécesseur, Bruno Retailleau et assume d’engager une politique de détente avec l’Algérie pour reprendre la coopération sécuritaire sur les questions de terrorisme et de narcotrafic. Il compte aussi sur Alger pour faciliter les expulsions d’Algériens en situation irrégulière.
Le Premier ministre français a regretté le vote par l’Assemblée nationale, le 30 octobre, pour la première fois de la Vème République, d’un texte du Rassemblement national, en faveur de la dénonciation de l’accord franco-algérien de 1968 – qui régit les règles du séjour des Algériens en France. Sébastien Lecornu s’est toutefois dit favorable à une renégociation de l’accord, que deux rapports parlementaires de 2025 ont jugé trop favorable aux Algériens et ne se justifiant plus, soixante-trois ans après l’indépendance. Les immigrés algériens en France représentent la plus importante communauté immigrée dans le pays, avec près de 900.000 personnes.
Si l’heure semble à la décrispation, cependant, l’historien Benjamin Stora estime que « la crise entre l'Algérie et la France a été très dure et très profonde. D'un côté comme de l'autre, elle va laisser des traces. » Il pointe les écueils qui demeurent : à commencer par l'incarcération du journaliste français Christophe Gleizes, arrêté en mai 2024 alors qu'il réalisait des reportages sur le football en Kabylie, mais aussi la position de Paris sur le Sahara-Occidental, la question des obligations de quitter le territoire français (OQTF), les questions sécuritaires dans le Sahel et les questions migratoires.
Kontildondit ?
Jean-Louis Bourlanges :
Je partirai de l’accueil réservé à la libération de Boualem Sansal, du traitement qu’en a fait l’Algérie et de la manière dont cela a été perçu en France. Certains, comme Jean-Noël Barrot, ont parlé d’un grand succès de la diplomatie française, quand la plupart des observateurs ont estimé que les Algériens nous avaient humiliés en passant par l’Allemagne. À mon sens, ni l’un ni l’autre n’a raison : cet épisode est surtout très révélateur.
Il montre la nécessité pour l’Algérie de sortir de ce mauvais pas, donc de céder à la demande française, mais en le faisant de telle sorte que le président Macron ne puisse pas s’en prévaloir. On libère l’écrivain, mais en infligeant un pied de nez. C’est typique de l’embarras algérien à notre égard. Ce n’est pas un succès français, mais c’est un geste de rapprochement partiel, équilibré par le maintien en détention du journaliste Christophe Gleizes. Un geste pensé pour que Paris ne puisse pas chanter victoire.
Deuxième observation : ce qui frappe depuis un an, depuis l’arrestation de Boualem Sansal, c’est l’attitude très mesurée de la France. Malgré Bruno Retailleau, isolé au sein du gouvernement, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, puis Laurent Nuñez ont choisi la décélération, et refusé l’escalade. Pourtant, nous avions un dossier solide : les Algériens se moquent de nous depuis des années, notamment en ne respectant pas leurs engagements sur les OQTF, et l’accord franco-algérien de 1968 est profondément déséquilibré. Rien de tout cela n’est satisfaisant. Mais, de même que les Algériens, qui ne nous portent pas dans leur cœur, ont maintenu une relation prudente, nous avons tenu la ligne d’une attitude apaisée. Seuls les emballements récents de l’Assemblée nationale sont venus troubler ce cap. Notre volonté de garder une relation pacifiée est très significative, parce que c’est l’intérêt de chacun.
L’Algérie traverse des difficultés considérables. Elle a été lâchée par les Russes et les Chinois sur le dossier sahraoui et s’est retrouvée isolée. Dans le monde arabe, elle l’est aussi : le pacte d’Abraham, notamment la signature du Maroc, le positionnement prudent de l’Arabie saoudite, le rôle du Qatar, tout cela la met dans une position inconfortable. Elle est en difficulté sur ses frontières sud, avec le Mali notamment : taper sur la France était commode, mais c’était nous qui faisions le travail, et désormais ce travail n’est plus assuré.
Nous, de notre côté, avons près de 900.000 Algériens en France, des liens d’une densité exceptionnelle, et un besoin vital de coopération sécuritaire. Si Alger fait un effort, même modeste, sur les OQTF ou sur d’autres dossiers, nous avons intérêt à maintenir une relation particulière. En réalité, ce couple franco-algérien a cessé d’être central. Il fut longtemps le partenariat essentiel de chacun, mais nous ne sommes plus, pour reprendre Pascal, « au centre des choses ». Cette relation est désormais au milieu des choses, et non plus au centre. Elle me fait penser à un couple de petits commerçants qui s’entendent très mal, se disputent chaque jour, mais restent ensemble parce qu’ils tiennent la boutique, alors même que des grandes surfaces s’installent autour d’eux. C’est, à mes yeux, exactement l’état des relations franco-algériennes.
Béatrice Giblin :
Oui, dans les relations franco-algériennes, nous sommes face à une situation post-coloniale d’une complexité extrême. Certes, la France a eu d’autres colonies, mais il n’y a qu’en Algérie qu’il y a eu une colonisation de peuplement. C’est un cas unique : une conquête longue, difficile, souvent atroce, et une décolonisation tout aussi difficile et atroce, parfois des deux côtés. Le passif est immense.
Mais le plus préoccupant, et ce qui rend cette relation si singulière, c’est qu’après l’indépendance, l’arrivée d’Algériens en France a été massive. Logiquement, ceux qui vivaient en France auraient dû repartir au moment de l’indépendance ; c’est l’inverse qui s’est produit. Une partie de l’élite qui avait mené le combat de l’indépendance — en raison des rivalités féroces entre l’armée de l’intérieur et l’armée de l’extérieur — a dû se réfugier en France pour éviter d’être liquidée par le FLN. Ils ont trouvé refuge dans le pays qu’ils venaient de battre. C’est un paradoxe considérable.
Au moment de la guerre civile des années 1990, une nouvelle élite francophone a, elle aussi, trouvé refuge en France. Ces liens si particuliers n’ont pas d’équivalent dans l’histoire de la décolonisation. Il y a certes des Indiens ou des Bengalis au Royaume-Uni, mais dans des proportions infiniment moindres, pour des raisons géographiques et historiques évidentes. La présence algérienne en France, elle, remonte à la guerre de 1914, parfois même avant. Aujourd’hui, environ 10 à 12 millions de Français ont un lien avec l’Algérie. C’est colossal. Et cela suffit à expliquer pourquoi la rupture est impossible. Je rejoins totalement l’analyse de Jean-Louis : la séparation n’est pas envisageable. D’autant que 90% des Algériens qui émigrent souhaitent venir en France. Le pouvoir algérien voit partir une grande partie de sa population la mieux formée — regardez le nombre de médecins algériens dans les hôpitaux français. Nous sommes donc face à une situation post-coloniale absolument particulière, sans équivalent ailleurs.
Matthias Fekl :
Sur l’Algérie, il me semble que nous avons affaire à des mémoires extrêmement imbriquées. Emmanuel Macron a eu raison, avec Benjamin Stora, d’engager un travail de mémoire important ; mais je pense qu’il y a une erreur majeure à croire que ce travail pourrait constituer un levier efficace dans la relation franco-algérienne. C’est en réalité un travail d’abord français : un travail à mener avec les enfants d’immigrés algériens, avec les descendants de pieds-noirs et avec les pieds-noirs eux-mêmes — dont beaucoup sont encore vivants. Les déchirements sont présents à tous les étages : les horreurs de la colonisation, que l’on n’ose parfois plus évoquer mais qui sont pourtant une réalité ; les déchirements immenses du départ d’Algérie pour de nombreux pieds-noirs, souvent très modestes et qui n’étaient pas de grands colons ; la mémoire des harkis. Tout cela se superpose, nourrit un inconscient français puissant, et joue encore aujourd’hui dans les comportements politiques, y compris dans le vote. C’est mon premier point : ce travail mémoriel est indispensable, mais il ne faut pas croire qu’il influencerait réellement le régime algérien. La suite des événements l’a d’ailleurs clairement démontré.
Deuxième point : si l’on s’extrait de cette histoire tragique et du passionnel, il y a toute une série de dossiers brûlants, d’ordre strictement interétatique, qui avaient été fortement malmenés ces dernières années. La coopération antiterroriste, la coopération sécuritaire — essentielles —, ont été très affectées. La reprise des OQTF est un échec manifeste. Mais tout cela s’inscrit, avec l’Algérie plus qu’avec aucun autre pays, dans un arrière-plan passionnel tel que la moindre question technique devient immédiatement un sujet politique profond.
Antoine Foucher :
N’étant pas un spécialiste de ces sujets, ce qui m’a frappé en préparant l’émission, c’est le consensus de nombreux observateurs : nous vivons la crise la plus grave avec l’Algérie depuis 1962. La question est donc de comprendre pourquoi cela arrive maintenant. Une hypothèse à mettre sur la table, c’est que cette crise, commencée il y a un an ou un an et demi, coïncide avec l’attitude de Bruno Retailleau à l’Intérieur. Il est difficile de ne pas se demander dans quelle mesure sa fixation sur l’Algérie et l’immigration n’a pas déclenché quelque chose.
Depuis la décolonisation, il existe du côté algérien une forme de rente mémorielle consistant à attribuer leurs difficultés à la France. Mais, avec Bruno Retailleau, j’ai l’impression que, pour la première fois, la France a répondu en miroir : si nous allons mal, c’est à cause de l’Algérie et de l’immigration algérienne. À l’extrême droite, et de plus en plus à droite, s’installe l’idée que nos difficultés – financières, identitaires, géopolitiques – ne viendraient pas de nous-mêmes, mais des vagues migratoires, et notamment algériennes. C’est comme si, pour la première fois depuis 1962, la France avait placé son discours au même niveau que celui de l’Algérie : « si nous sommes dans cette situation, c’est à cause de vous ».
Quelques chiffres donnent des arguments à cette lecture : 40% des personnes en centre de rétention administrative sont algériennes, et l’on compte entre 700.000 et un million d’immigrés algériens en France. L’image du couple de petits commerçants me paraît juste, mais à condition de rappeler qu’avant, ce n’était pas cela : il n’y avait aucune forme d’équivalence dans la relation. Le basculement vient du fait que nous nous sommes, nous aussi, jetés dans la passion. Ce lien était déjà passionnel, mais plutôt du côté algérien. Or en adoptant un discours symétrique – en disant, nous aussi, « si nous sommes dans cette situation, c’est à cause de vous » – nous avons réactivé cette passion et déclenché la crise.
Et pour conclure, cela me semble être un symptôme de notre déclin : nous en arrivons, nous aussi, à considérer que si nous n’allons pas bien – pour toutes les raisons déjà évoquées dans cette émission –, c’est la faute des autres. Ce n’est plus de notre faute, c’est la faute des autres. Et qui mieux que notre ancienne colonie pour endosser ce rôle de « l’Autre » ?
Jean-Louis Bourlanges :
Je suis assez d’accord avec ce qu’Antoine vient de dire, mais je bémoliserais simplement l’importance qu’il accorde à Retailleau. La difficulté est antérieure. Retailleau a fait deux choses : il a exprimé ce que beaucoup de Français pensaient, et il a montré, par là même, que ce que les Français pensaient ne débouchait sur rien.
Je crois que les vraies raisons sont beaucoup plus profondes. Il y a eu une montée en puissance très forte des sentiments anti-algériens. Je me souviens de Xavier Driencourt, camarade de promotion et ancien ambassadeur à Alger : lorsqu’il est venu me voir quand j’étais en fonction, il agitait déjà fortement le landerneau et tout le monde était sur cette ligne. Retailleau a tenté de franchir la limite, parce que les Algériens avaient une attitude franchement provocatrice.
Ce qui me paraît surtout important, c’est l’ancienneté de ce malaise. J’ai accompagné un président de la République à Alger. L’organisation avait prévu un programme pour les parlementaires : devinez ce qu’on nous a proposé ? Nous recueillir sur la tombe de Roger Hanin. Inattendu … Le soir, lors du grand banquet offert par le président algérien, nous étions cinq ou six cents. Je me retrouvais à côté du ministre de la Guerre ; Lecornu, alors ministre de la Défense, me glisse : « fais gaffe à celui-là, c’est à la fois moi et Burkhard : il est ministre et chef d’état-major. » Puis les deux présidents, Tebboune et Macron, sont arrivés, se sont assis, nous avons dîné — eau minérale et limonade. Et puis chacun est reparti. Pas un discours, pas un toast. Je n’avais jamais vu un dîner officiel sans toast. Cela montre bien que tout cela est ancien.
En revanche, ce qui a été décisif, c’est d’abord l’affaire marocaine. Nous étions dans une situation équivoque, et nous avons fini par sortir de cette équivoque parce que tout le monde — l’Espagne notamment — avait pris parti, et que nous étions en crise avec Rabat. Il a fallu arbitrer, alors que nous avions jusque-là dédaigné de le faire. Les Algériens l’ont très mal pris.
Et puis — là, je rejoins Antoine — il y a l’affaiblissement de la France. On peut taper sur nous : nous sommes faibles. Faibles économiquement, faibles budgétairement, peu performants sur la scène internationale, hormis une diplomatie de témoignage, très respectable mais limitée. Le coup de pied de l’âne s’explique aussi par cela.
Béatrice Giblin :
Oui, je veux dire que Bruno Retailleau a dit tout haut ce que beaucoup de Français disaient tout bas, et il l’a dit très fort. Je pense que cela a aussi pesé dans l’évolution de la situation. Parler haut et fort aux Algériens n’a pas été, de mon point de vue, totalement négatif. Même si je sais que tout le monde ne partage pas cette analyse.
Antoine Foucher :
Je n’ai pas dit que c’était négatif, mais qu’en disant cela, on en vient à considérer que si nous allons mal, c’est la faute des autres. Jusqu’ici, seuls les Algériens disaient cela de la France ; désormais, nous le disons aussi, en miroir, des Algériens.