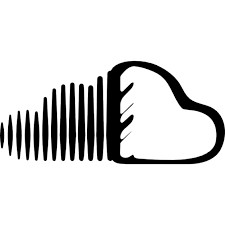REDRESSEMENT ITALIEN, DÉCLIN FRANÇAIS : UN PARALLÈLE EN TROMPE-L’ŒIL
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Alors que la France s’enfonce dans la dette, l’Italie redresse ses dépenses publiques. Le 2 octobre, le gouvernement d’« union des droites » de Giorgia Meloni a approuvé les dernières prévisions financières pour fin 2025 : le déficit serait ramené autour de 3% du PIB, ouvrant la porte à une sortie de la procédure pour déficit excessif engagée par la Commission européenne. L’Italie est devenue la quatrième puissance exportatrice mondiale se classant derrière l’Allemagne, elle devance désormais la Corée du Sud. En 2004, elle était classée au septième rang.
Ces résultats ne doivent pas occulter une dette italienne restée à des niveaux très préoccupants (140% du PIB). De plus, le redressement financier de l’Italie est facilité par les effets du plan de relance européen décidé durant la crise sanitaire de 2020-2022, particulièrement généreux pour Rome (avec 194 milliards d’euros perçus, le pays est le premier bénéficiaire du dispositif). Une dette souveraine qui n’a pas empêché le 19 septembre l’agence de notation Fitch d’en relever la note à BBB+, quelques jours après avoir abaissé celle de la France à A+, donnant l’impression que les courbes, entre les deux pays, étaient destinées à se croiser, le redressement italien ne faisant que mettre en lumière, par contraste, l’affaiblissement des positions de la France.
L’économie italienne conserve de grandes fragilités structurelles, notamment une productivité atone, une croissance en berne et une crise démographique qui ne cesse de s’aggraver, notamment par le départ à l’étranger des Italiens diplômés. Le pays connait une productivité du travail faible, estimée par l’OCDE à 65,60 € par heure en 2024, soit beaucoup moins que la France (90,86€). Deuxième puissance manufacturière d’Europe, l’Italie arrive seulement quatorzième dans le classement des pays membres les plus innovants en 2025, selon la Commission, tandis que le climat social se détériore. Le recul du chômage de 7,8% en 2022 à 6% en 2024 cache une augmentation du nombre de travailleurs pauvres et un temps partiel contraint qui frappe d’abord les femmes. Dans ces circonstances, le nombre de familles en situation de pauvreté absolue se maintient au-dessus de 8 millions, quand le taux de population à risque de pauvreté est de 23,1% en 2024. De plus, une étude d’octobre 2024 menée par plusieurs universités analysant les données de la Banque centrale européenne a mis en évidence le caractère profondément inégalitaire du système fiscal italien. Les principaux avantages fiscaux y seraient ainsi concentrés entre les mains des 7% des plus riches, dont le taux moyen d’imposition se révèle inférieur à celui des classes moyennes moins favorisées.
En dépit de ces faiblesses, 39% des Italiens, selon le baromètre publié en février 2025 par le Centre de recherches politiques de Sciences Po, déclarent faire confiance à la politique, contre 26% des Français. L’Italie, il est vrai, connait depuis trois ans, contrairement à la France, une stabilité gouvernementale inédite.
Kontildondit ?
Nicolas Baverez :
Aujourd’hui, après des décennies où la France regardait l’Italie de haut – pays réputé sinistré, politiquement instable, gangrené par la mafia et frappé par la stagnation –, la situation semble s’être inversée. Côté français, le tableau est assez tragique : effondrement démographique, avec cette année plus de décès que de naissances, stagnation économique, crise financière qui ressemble à une lente agonie sous la pression des marchés, système politique autrefois stable mais devenu facteur de risque, et perte d’influence en Europe et dans le monde du fait du relâchement des finances publiques et de l’ordre public.
Côté italien, trois éléments marquent cette inversion. D’abord, alors que la France est régulièrement dégradée, la note de l’Italie a été réévaluée, y compris par Moody’s. Ensuite, le PIB par habitant y dépasse désormais celui de la France, au-delà de 40.000€. Enfin, la stabilité politique est frappante : depuis l’arrivée au pouvoir de Mme Meloni il y a trois ans, sa coalition reste solide, elle a gagné les élections, Silvio Berlusconi est mort, M. Salvini est neutralisé, et la stratégie d’exporter l’« union des droites » au niveau européen commence à porter ses fruits, comme on l’a vu lors du vote récent sur les directives CRDS et CS3D.
Les résultats économiques italiens sont d’ailleurs bons : depuis la Covid, environ 4% de croissance contre 1,5% pour la France et 0,8% pour l’Allemagne. Le chômage est tombé à 6% et, hors énergie, l’excédent commercial atteint 104 milliards d’euros, chiffre qui fait rêver chez nous. Le capitalisme italien est en pleine forme : les dirigeants italiens sont recherchés, Stellantis est désormais dirigé entièrement par des Italiens, Luca De Meo dirige Kering, la consolidation bancaire européenne démarre par l’Italie, et de plus en plus de gens fortunés s’installent à Milan, attirés par un environnement d’affaires favorable et une stabilité politique confirmée. Tout cela s’accompagne d’une politique internationale active : Mme Meloni n’adopte pas une posture anti-européenne, mais se place comme un pont entre l’Union et l’administration Trump, entre Europe libérale et illibérale, et même entre Europe et Afrique, l’Italie reprenant des positions traditionnellement françaises, notamment en Algérie.
Il faut toutefois rappeler trois limites majeures. Premièrement, les problèmes structurels restent considérables, surtout la démographie : 700.000 habitants perdus, deux millions de jeunes partis faute d’emplois correspondant à leurs qualifications, productivité stagnante, fracture persistante entre Nord et Sud, inégalités fortes. Deuxièmement, ce renouveau s’explique largement par les 194 milliards d’euros de subventions et de prêts européens. Troisièmement, l’amélioration spectaculaire doit bien plus à trois gouvernements techniques qu’à Mme Meloni, qui fait en réalité peu de réformes : Romano Prodi en 2006-2007, Mario Monti en 2012 au cœur de la grande crise – auteur de l’essentiel des réformes – et enfin Mario Draghi en 2021-2022, qui a mis en œuvre le plan européen et continue d’inspirer la ligne actuelle. Les enseignements sont clairs : d’une part, un pays qui nous ressemble beaucoup peut se redresser ; d’autre part, ce redressement prend du temps et repose sur des réformes structurelles que nous sommes non seulement incapables de mener, mais que nous sommes en train d’annuler, comme on le voit avec la réforme des retraites.
Marc-Olivier Padis :
Je retiens d’abord la stabilité politique : Giorgia Meloni, élue en octobre 2022, n’a pas d’élection avant 2027. Elle peut donc rester cinq ans au pouvoir, ce qui est essentiel dans le contexte italien. Nous aurons aussi des élections en 2027, mais rien ne garantit que la Vème République retrouve alors un fonctionnement stable. Parmi les atouts évoqués, je suis très frappé par la puissance exportatrice de l’Italie : quatrième pays exportateur, avec un excédent commercial impressionnant. Cette force repose sur une grande variété de secteurs, bien plus que l’Allemagne : la mode, le bois et l’ameublement, l’alimentaire, mais aussi l’électromécanique et la sous-traitance, notamment pour l’industrie allemande. Cela s’appuie sur un tissu de PME familiales, décentralisé et en réseau, souvent présenté comme un modèle de résilience.
Sur les faiblesses italiennes, deux points sont importants et concernent aussi la France. D’abord, le niveau de la dette : avec 136% du PIB en 2025, il est très difficile de redescendre, et l’Italie peine depuis des années malgré l’apport des gouvernements techniques. Les Français doivent en tirer la leçon. Deuxième point : l’hiver démographique. La population italienne baisse, passant de 60 millions en 2010 à 59 millions en 2025. C’est un phénomène contre-intuitif : la diminution ne résout aucun problème. Par exemple pour le logement, on pourrait croire qu’un million d’habitants en moins libère des logements. En réalité, ceux qui se libèrent ne sont pas adaptés : appartements trop grands, mal situés. Ainsi, les jeunes qui veulent travailler à Milan ou Turin ne trouvent pas à se loger. Même logique pour les opportunités économiques : la démographie étouffe l’ensemble de l’économie.
En France, la démographie baisse aussi. Or une diminution de la population active ne peut être compensée que par trois leviers : l’immigration (mais ce n’est pas le cas de l’Italie, qui a eu 200.000 sorties en 2024), l’augmentation de la participation au travail (mais le vieillissement la freine), ou les gains de productivité (faibles, car le tissu industriel familial est peu innovant). Sur la longue durée, la croissance italienne reste donc faible : 0,2% par an en dix ans, contre un peu plus d’un pour cent en France, ce qui n’est déjà pas brillant.
Pourquoi discuter de tout cela ? Parce que le milieu des affaires français s’interroge sur l’existence d’un scénario Meloni pour la France, c’est-à-dire sur la fusion des droites. Meloni incarne une extrême droite banalisée, issue d’un parti post-fasciste, mais elle répond aux besoins économiques du pays, au prix d’un reniement total de ses promesses : elle avait dit qu’« plus un étranger ne mettrait les pieds » en Italie, et elle a signé le decreto Flussi, qui fait venir 500.000 travailleurs immigrés pour l’agriculture et l’industrie. Ce revirement ne lui nuit pas. Autre élément : sa modération européenne. Elle devait récupérer les 194 milliards du plan de relance post-Covid, ce qui aide évidemment. Elle s’entend bien avec Ursula von der Leyen, à qui les Européens confient le soin d’amadouer Trump. Cela dessine un scénario très différent du programme de l’extrême-droite française, qui reste radical.
Je souligne enfin deux revers électoraux cette semaine pour la majorité de Meloni : en Ombrie et en Émilie-Romagne, où le centre-gauche a remporté deux régions importantes.
François Bujon de l’Estang :
L’essentiel a été dit. Je vais donc, comme dans les bulletins météo, parler du ressenti. Et le ressenti italien est celui d’un redressement très spectaculaire, au moment où, en France, plus personne ne parle d’autre chose que du déclin, qui saute aux yeux. C’est frappant : apprendre que l’Italie est devenue le quatrième exportateur mondial, derrière la Chine, les États-Unis et l’Allemagne, alors que nos performances de commerce extérieur se dégradent chaque année, cela impressionne. Voir les agences de notation relever la note italienne pendant qu’elles abaissent la nôtre interpelle également. D’autres éléments nourrissent cette impression. Mme Meloni fête ses trois ans à la présidence du Conseil, et cette stabilité est à l’opposé de ce que l’on associait aux institutions italiennes. Et cela survient au moment où, en France, s’installe une instabilité qui évoque davantage la IVème République que la pratique de la Vème. Tout cela est saisissant.
Quand on regarde de plus près, on constate que ce redressement spectaculaire repose sur une base politique posée après le point bas de 2011, quand l’Italie frôlait la situation grecque et que certains la comparaient à l’Argentine. Les gouvernements techniques ont ensuite joué un rôle décisif en établissant les fondations du redressement. Vous avez mentionné Mario Monti et Mario Draghi, à juste titre. J’y ajoute Matteo Renzi, souvent oublié, mais c’est lui qui a conduit la réforme du marché du travail. Ses effets se sont fait sentir avec retard, mais ils ont fortement amélioré la situation en matière de chômage et d’emploi. Les fruits que récolte aujourd’hui Mme Meloni viennent donc largement des efforts de ses prédécesseurs. Et alors qu’on anticipait avec inquiétude l’arrivée du néo-fascisme au pouvoir, on découvre en réalité une forme de continuité entre l’époque Berlusconi – pour simplifier, une union des droites – et celle de Mme Meloni, malgré les cahots sur la route, surmontés avec constance.
Face à cela, nous nous rassurons en répétant qu’ils ont d’immenses problèmes structurels : une démographie catastrophique, l’absence de vraies réformes, des faiblesses profondes. C’est une manière de nous remonter le moral, alors même que nous découvrons l’effondrement de notre propre natalité. Mais la véritable explication du redressement italien est politique. Elle tient à la stabilité, à la continuité et au fait que la population italienne a accepté, à l’époque des gouvernements Monti et Draghi, de consentir à des sacrifices et à une discipline dont les électeurs français, eux, semblent se détourner.
Philippe Meyer :
En matière de stabilité, il y a quelqu’un dont nous n’avons pas encore parlé et qui est en poste depuis dix ans : le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Il est devenu un élément du paysage politique. Il a été ministre toute sa vie, son père Bernardo avait été avant lui député puis ministre, et il occupe cette position étrange qui consiste à ne pas avoir vraiment de pouvoir, mais à disposer d’infinies possibilités d’action.
Richard Werly :
Je voudrais résumer, en quatre « merci », la parenthèse enchantée que vit l’Italie avec Meloni, parenthèse qui tient essentiellement à son pragmatisme. C’est sans doute ce qu’il faut retenir d’elle : on l’attendait sur le terrain idéologique, elle s’est révélée redoutablement pragmatique. Je me souviens avoir couvert la campagne des législatives italiennes : tout le débat tournait autour de cette leader post-fasciste, qui dans sa jeunesse admirait Mussolini. Les télévisions françaises diffusaient en boucle ces images où on la voyait chemise brune, louant le Duce et son quartier d’origine à Rome …
Premier « merci » : son pragmatisme vis-à-vis de l’Europe. Elle a compris qu’elle avait besoin de l’Union. Les réussites économiques italiennes doivent beaucoup à l’argent européen, et il ne suffit pas de recevoir des fonds, encore faut-il bien les utiliser : l’Italie l’a fait. Cela lui a permis de se réconcilier avec Ursula von der Leyen, alors même que cette dernière avait mis en garde contre elle pendant la campagne. Les deux femmes ont fini par s’entendre, dans un contexte où le Parlement européen est sous pression de la droite national-populiste.
Deuxième « merci » : son pragmatisme sur les migrants. Elle a très vite engagé une régularisation d’environ 400.000 personnes, dont elle a compris qu’elles étaient indispensables au bon fonctionnement de l’économie italienne. Elle a désamorcé le débat en régularisant ceux qui travaillent et en ciblant ceux qui ne travaillent pas, si bien que la campagne anti-migrants n’a rien à voir, par exemple, avec celle des États-Unis. Avec la Ligue de Salvini au gouvernement, on aurait pu s’attendre à des pratiques brutales ; elle ne s’y est pas engagée, ce qui a évité des tensions dangereuses dans les grandes villes italiennes.
Troisième « merci » : sa relation avec les États-Unis. Elle s’est imposée très vite comme l’interlocutrice privilégiée non seulement de Donald Trump mais aussi d’Elon Musk et de ceux qui gravitent autour. Cela a fortement apaisé les débats. L’Italie n’est jamais ciblée par l’administration américaine, pourtant prompte à s’ingérer dans les affaires européennes. Il y a une connivence idéologique, certes, mais surtout l’assurance que l’Italie, pays traditionnellement atlantiste, restera ce que Washington souhaite : un vassal. Et de ce point de vue, Meloni joue ce rôle avec une efficacité exceptionnelle.
Enfin, dernier « merci » : son pragmatisme vis-à-vis de la France. Elle a su montrer les dents au bon moment. Elle a compris la faiblesse française et a profité du contexte pour démontrer, en Europe et au-delà, que derrière les envolées verbales d’Emmanuel Macron, les résultats ne suivaient pas. Elle y a gagné une stature politique européenne qu’elle n’avait pas au départ.
Tout cela montre que ce qui compte en politique aujourd’hui, c’est le pragmatisme et le souci des résultats. Sur les raisons de la réussite italienne, tout a été dit. J’en vois une essentielle : cette réussite demeure liée à la vitalité du marché européen. Être un grand exportateur ne suffit pas pour un pays qui ne pourra jamais être compétitif sur le plan tarifaire face à la Chine. L’essentiel, pour l’Italie, sera de jouer pleinement le jeu européen. Et il reste à savoir si Meloni, nationaliste forcenée, acceptera d’aller jusque-là.
LE PLAN DE PAIX DE TRUMP POUR L’UKRAINE
Introduction
Philippe Meyer :
Le 18 novembre, un plan de paix en Ukraine, détaillé en 28 points a sidéré les Ukrainiens et les Européens, tant cette esquisse inacceptable à leurs yeux était alignée sur les positions russes. Il stipule notamment que la Crimée (annexée par la Russie en 2014) ainsi que Louhansk et Donetsk seront « reconnues comme russes de facto, y compris par les Etats-Unis ». Il évoque aussi la création d’une « zone tampon démilitarisée » et neutre dans la partie de l’oblast de Donetsk contrôlée par l’Ukraine, qui serait « internationalement reconnue comme territoire appartenant à la Fédération de Russie », mais où les forces russes n’entreraient pas. Il y est énoncé encore que l’Ukraine devrait renoncer à son projet d’adhérer à l’OTAN et réduire à 600.000 soldats ses forces armées. Il ouvre la voie à une amnistie générale, y compris pour les crimes de guerre dont est accusé le dirigeant russe, Vladimir Poutine, ainsi qu’à une levée progressive des sanctions occidentales, voire à un retour de la Russie dans le G8.
Les négociations entreprises dimanche à Genève, entre les conseillers à la sécurité nationale américains, ukrainiens et européens, ont permis de remodeler le plan Trump et de le nettoyer de ses aspects les plus problématiques. Sur les 28 points initiaux, il n’en restait plus que 19 lundi. Certains paragraphes ont été tout simplement rayés, comme la suggestion de réintégrer la Russie dans le G8, ou d’offrir la possibilité pour les Etats-Unis d’utiliser les actifs russes gelés, majoritairement détenus dans des pays européens, afin de financer l’effort de reconstruction. Les mentions concernant directement les intérêts européens, comme les sanctions, la perspective que l’Ukraine adhère à l’Union européenne ou qu’elle n’intègre jamais l’OTAN ont été remises à plus tard. Ce nouveau plan en 19 points n’est pas définitif. Divers ajustements et précisions doivent encore être négociées dans les coulisses, avant d’être soumis à la Russie. Mais la copie paraît désormais acceptable à la fois aux Ukrainiens, aux Américains et aux Européens. Il n’est plus question pour Kyiv de renoncer aux territoires conquis par la Russie, ni d’établir une zone tampon sur son sol mais de proposer un armistice sur la ligne de front actuelle qui serait gelée. Il n’est plus envisagé de réduire par deux la taille de l’armée ukrainienne. « Beaucoup de choses justes ont été prises en compte » à Genève, a observé Volodymyr Zelensky, lundi, indiquant qu’il négociera lui-même avec Donald Trump les points les plus sensibles laissés de côté, lors d’une rencontre dont la date est incertaine. En écho, Vladimir Poutine a déclaré jeudi que « les combats cesseront » quand l'armée ukrainienne « quittera les territoires qu'elle occupe » (= les régions revendiquées par Moscou) et qu'il ne peut pas y avoir d'accord de paix car le gouvernement ukrainien n'est pas légitime.
Kontildondit ?
François Bujon de l’Estang :
Nous sortons d’une séquence tout à fait catastrophique et assez cauchemardesque, interrompue seulement par la pause de Thanksgiving, (où, traditionnellement, tout le pays est à l’arrêt). Le plan de paix en 28 points présenté par Steve Witkoff voulait calquer le plan en 21 points qui avait permis à Trump d’obtenir un succès très temporaire à Gaza. Il a repris cette approche, en la discutant avec son interlocuteur habituel, M. Dmitriev, l’envoyé traditionnel de M. Poutine, et ils ont produit un plan pratiquement dicté par Moscou. Toutes les exigences russes y figuraient, assorties d’un ultimatum pressant les Ukrainiens de donner leur accord avant Thanksgiving. Autant dire que les Ukrainiens n’avaient pas de quoi se réjouir.
Il a fallu l’intervention conjointe du département d’État dirigé par Marco Rubio – qui avait découvert presque par la presse le plan Witkoff –, des diplomates américains et européens, tous précipités à Genève pour rencontrer leurs homologues américains et ukrainiens. Les choses ont été rattrapées : comme Philippe l’a expliqué, le nouveau projet, ramené à 19 points, répond davantage à certaines préoccupations ukrainiennes, même si les points essentiels restent en suspens. Ce que nous venons de voir illustre exactement ce que la diplomatie de Trump peut produire de pire : une improvisation totale, non réfléchie, sans travail préalable, sans implication du corps diplomatique, et qui engendre une cacophonie manifeste à Washington.
Un deuxième élément s’ajoute : le pire a été évité grâce à une fuite orchestrée, dont on ignore l’origine, relayée par Bloomberg, qui a révélé la conversation téléphonique entre M. Witkoff et Yuri Ushakov, ancien ambassadeur russe à Washington, aujourd’hui conseiller diplomatique de M. Poutine. La lecture du script est atterrante : on y voit M. Witkoff donner à Ushakov des conseils pour « vendre » le projet à Trump. C’est extraordinaire.
Il faut retenir deux choses de cette navrante séquence. D’abord, le biais outrageusement prorusse de Trump et de son envoyé spécial, M. Witkoff. Paraphrasant une formule célèbre, on pourrait dire que « la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée à des promoteurs immobiliers », et cette fois la phrase n’a rien d’exagéré. À chaque épisode, le balancier revient du côté de Moscou grâce à Trump et Witkoff. Souvenez-vous de l’accueil réservé à Zelensky en mars dans le Bureau ovale.
Ensuite, l’indifférence totale de Trump, de son entourage et même du vice-président aux préoccupations de sécurité des Européens et des Français. Il n’y a aucune réflexion stratégique dans sa position sur l’Ukraine. Il ne s’interroge pas sur l’architecture de sécurité européenne après un éventuel cessez-le-feu. Il veut uniquement des résultats immédiats : un cessez-le-feu, que les Russes refusent avant toute négociation, et des avancées rapides qu’il pourrait convertir en bon points dans sa quête du prix Nobel de la paix.
Ce que Trump ne comprend pas – ou refuse de comprendre –, c’est qu’il n’y a aujourd’hui aucune possibilité d’accord. Poutine et les Russes ne veulent pas la paix. Ils veulent poursuivre leur avantage, conquérir les territoires qui leur manquent encore, provoquer l’effondrement du gouvernement de Kyiv et mettre fin à l’indépendance de l’Ukraine, ainsi qu’à son tropisme européen et atlantique.
Marc-Olivier Padis :
Oui, je me suis posé trois questions cette semaine en observant ces événements. D’abord : quelle est la position de la Russie dans la négociation ? Ensuite : qui a intérêt à la poursuite de la guerre ? Et enfin : que peuvent les Européens ?
Sur la position russe, François l’a rappelé, il y a quelque chose de curieux. Habituellement, on négocie d’abord un cessez-le-feu, puis, une fois les armes tues, un accord de paix. Les Russes proposent l’inverse : discuter d’un accord de paix avant le cessez-le-feu. C’est une position manifestement dilatoire pour continuer à avancer sur le terrain, même s’ils n’avancent que très peu. Ils répètent aussi qu’il faut négocier sur ce qu’ils appellent les « causes profondes » du conflit. Par là, ils n’entendent plus seulement l’avancée de l’OTAN ou le soi-disant régime nazi de Kyiv, mais l’ordre du monde né de la fin de l’Union soviétique, que Poutine a qualifié de plus grande catastrophe géopolitique du XXème siècle. En réalité, ce qu’ils contestent, c’est la souveraineté ukrainienne elle-même.C’est très révélateur lorsqu’il déclare que l’Ukraine doit se retirer des territoires que l’Ukraine occupe. C’est leur propre pays, ils sont agressés, et on leur reproche d’occuper leur territoire. On est face à une remise en cause révisionniste de l’ordre international issu de la fin de la guerre froide. La négociation s’annonce donc particulièrement complexe.
Ensuite : qui a intérêt à poursuivre la guerre ? Les Ukrainiens, certainement pas ; c’est trop douloureux et trop coûteux. Mais une capitulation totale leur est évidemment inacceptable. Quant aux Russes, l’intérêt est plus ambigu. La guerre est très coûteuse pour la Russie, en vies humaines d’abord. Poutine réussit à maintenir le sujet tabou en politique intérieure, mais pour combien de temps ? Le coût économique est également considérable, entre sanctions et chute des ventes de pétrole. Mais l’économie russe est passée en économie de guerre : cela stimule l’activité industrielle et militaire, augmente certains salaires et maintient un relatif calme social. Sortir de cette économie serait très difficile : cela impliquerait un ralentissement, le retour d’hommes traumatisés à réintégrer, et il faudrait assumer un échec militaire majeur, vis-à-vis de l’armée comme de la population.
Troisième point : que peuvent les Européens ? On dit trop vite qu’ils ne font rien. Même si le plan russo-américain les a mis de côté, ils ont réagi. La vraie question pour l’Europe, c’est ce que veulent les Américains pour l’OTAN. Dans le langage diplomatico-militaire, on distingue le burden sharing (partage de l’effort) du burden shifting (transfert de l’effort). Dans le premier cas, les Européens doivent investir davantage, augmenter leurs budgets ; mais les carnets de commandes sont pleins, les matériels arriveront tard, et seuls Français et Britanniques sont réellement opérationnels. Le burden shifting, lui, signifierait que les États-Unis se retirent, se tournent vers l’Asie et la Chine, et ne veulent plus entendre parler des affaires européennes. Et il est probable qu’un conflit oppose ces deux visions au sein de l’administration Trump : ceux qui voient les avantages que l’OTAN apporte aux États-Unis – notamment en termes d’exportations d’armements – et ceux qui pensent qu’il faut passer à autre chose. D’où la grande incertitude sur le rapport de force interne entre ces deux courants.
Richard Werly :
On connaissait le brouillard de la guerre ; on est désormais dans le brouillard de la diplomatie. À Genève, les Européens semblent avoir réussi à recoller les morceaux et à repousser le plan en 28 points lancé par Witkoff, avec l’aide du département d’État et de Marco Rubio. Mais j’ai entendu des choses assez révélatrices : les Européens auraient été cantonnés dans un hôtel et dans une pièce séparée de celle où se trouvaient Américains et Ukrainiens. Cela ressemble fortement à un strapontin. Ils frappent à la porte, parviennent à glisser un pied, mais ils ne sont toujours pas à la table, et les Américains ne les y invitent pas davantage que les Russes. C’est un vrai problème si l’on veut être partie prenante de l’accord final.
Trois remarques. D’abord, aucune illusion à se faire : les coups de boutoir de Donald Trump contre les Européens et l’Ukraine vont continuer. Il n’a qu’un objectif, obtenir un deal avec la Russie. Witkoff, aussi caricatural soit-il dans ses méthodes, exprime exactement la volonté de son patron. Trump le voulait déjà à Anchorage, cela n’avait pas abouti, mais il persiste. Ce qui s’est passé ces derniers jours ne marque aucun tournant américain : chaque fois que la machine cale, Trump repart à l’assaut.
Deuxième point : la détermination de Vladimir Poutine à obtenir ses objectifs reste totale. Les provinces ukrainiennes ont été annexées par le Parlement russe ; pour lui, ce sont des territoires russes occupés par l’Ukraine. Il l’a encore répété. Il ne cédera pas, et même si le coût humain est exorbitant, la dynamique militaire actuelle reste à son avantage et fragilise l’Ukraine.
Enfin, ce qui m’inquiète pour les Européens, au-delà du fait que nous ne sommes toujours pas à la table, c’est que nous allons devoir payer, payer, payer. Dans les 28 points, une partie des actifs russes gelés devait carrément revenir à Trump : une véritable OPA. Nous allons devoir payer Trump, payer l’Ukraine, et accepter un coût économique de plus en plus lourd. Je finis par me demander si la vraie stratégie de Trump n’est pas de nous épuiser budgétairement, pour que, le moment venu, les Européens ne puissent plus soutenir l’Ukraine — et qu’il obtienne ainsi ce qu’il veut.
Nicolas Baverez :
Ce plan n’est peut-être pas un tournant, mais le moment où il est sorti est révélateur, car il correspond à un affaiblissement marqué de Volodymyr Zelensky. Il n’y a pas d’effondrement militaire, mais une pression russe avec des avancées limitées, coûteuses, mais réelles. Et le président ukrainien a été fragilisé par un scandale de corruption touchant son entourage immédiat. Ce plan, c’est d’abord un plan russe repris intégralement par l’équipe Trump. Il marque le retour à une logique impériale façon souveraineté limitée de Brejnev. Il ne s’agit pas seulement de prises de gages territoriaux : l’objectif est de transformer l’Ukraine en une autre Biélorussie. Et, par ailleurs, ce qui est proposé est extravagant : des conditions plus dures que celles imposées par Hitler à la France en 1940, alors même que l’Ukraine, elle, n’a pas perdu la guerre.
On est vraiment dans une forme de Munich : le déshonneur et la guerre. Si un tel plan devait être appliqué, l’Ukraine deviendrait une nouvelle Biélorussie et de futures agressions russes contre l’OTAN deviendraient inévitables. Ce serait un drame pour l’Europe : affaiblissement massif de l’architecture de sécurité et, surtout, disparition de fait de l’alliance atlantique. Le plan contenait aussi des éléments proprement ahurissants : Trump mettait la main sur 300 milliards d’avoirs russes gelés – 100 milliards pour un fonds russo-ukrainien dont il voulait récupérer la moitié, 200 milliards pour des investissements américano-russes – et l’Europe devait payer 100 milliards supplémentaires. C’est du grand banditisme, pour le dire clairement.
La version corrigée est un peu moins caricaturale, mais il faut relever un point intéressant : parmi ceux qui ont permis de passer de 28 à 19 points et qui ont révélé l’entretien proprement sidérant entre les conseillers de Trump et de Poutine, il y a des sénateurs républicains. Il se passe quelque chose au Congrès : un début de prise de conscience que Trump sape la puissance et les intérêts des États-Unis. Il faut le dire : l’administration Trump est la plus grande trahison envers l’esprit et la puissance américaine depuis la fondation du pays.
Sur les scénarios possibles : d’abord, un scénario favorable serait que les républicains raisonnables reprennent du poids et que l’on revienne à la seule manière de faire la paix en Ukraine, c’est-à-dire une fermeté extrême envers Poutine. Stratégiquement, sa guerre est un désastre : les coûts sont immenses par rapport aux gains, et son économie commence à être réellement secouée. Deuxième scénario, plus probable : la continuité. Même avec 19 points, Poutine garde l’avantage, soutenu par l’administration Trump, et l’Ukraine comme l’Europe, prises en étau, connaissent l’issue que l’on devine. De même que le pseudo-plan de paix pour Gaza revient à donner les clefs du Moyen-Orient à Netanyahou, les pseudo-plans de paix de Trump pour l’Ukraine reviennent à donner les clés de l’Ukraine – et de la sécurité européenne – à Vladimir Poutine. Troisième élément très inquiétant : le désengagement américain. Le point 4 du plan est extravagant : il prévoit que les discussions se dérouleront entre l’OTAN et la Russie, sous médiation américaine. Autrement dit, les États-Unis se pensent désormais comme extérieurs à l’OTAN, comme une tierce partie, comme si l’Alliance était purement européenne.
La leçon pour les Européens est claire : les États-Unis ne sont plus un allié, ni un protecteur ; ils sont devenus un risque majeur. Il faut réarmer très vite, et massivement, pour européaniser l’OTAN et en faire une véritable force de dissuasion face à la Russie, qui représente aujourd’hui une menace existentielle pour l’Europe et pour nos démocraties.