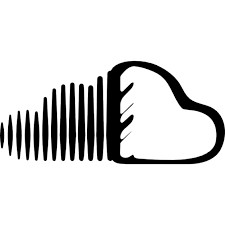LA SÉCURITÉ SOCIALE A 80 ANS
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Né en 1945 dans l’élan du Conseil national de la Résistance, l’État-providence français avait une ambition fondatrice : protéger chacun contre les grands risques de la vie. Il commence par la création de la Sécurité sociale et du régime de retraite par répartition, à une époque où 5 actifs soutenaient un retraité (contre 1,7 aujourd’hui). Les décennies suivantes ont vu un élargissement progressif du socle, au-delà de la seule logique assurantielle. Quatre-vingts ans plus tard, la Sécurité sociale n’a pas perdu l’amour des Français, ni, à leurs yeux, son attribut le plus précieux : l’universalité. Près de 80 % la considèrent comme la meilleure au monde et 85 % jugent impératif de maintenir une couverture universelle, sans distinction de revenus, selon un sondage Ifop de mars 2025. Mais elle traverse aujourd’hui une nouvelle crise grave. Le déficit record de l’assurance-maladie prévu cette année - 23 milliards en 2025 (contre 17,2 milliards en 2024) - interroge sur la capacité du système à perdurer. Et la pression démographique menace de le faire dériver encore plus, tandis que le vieillissement démographique déséquilibre autant le système de santé que celui des retraites en déficit elles de 6,6 milliards d’euros pour cette année. Un vieillissement à prendre d’autant plus en compte que les dépenses de santé augmentent exponentiellement avec l’âge. D’après la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, en 2021, la dépense annuelle moyenne a été de 1.114 euros pour les moins de 20 ans, 1.632 euros pour les 21-40 ans, 2.717 euros pour les 41-60 ans, 4.498 euros pour les 61-70 ans, 6.291 euros pour les 71-80 ans et 8.529 euros pour les plus de 80 ans. De fait, les plus de 60 ans concentrent plus de 50 % de la dépense totale, alors qu’ils représentent 28 % de la population.
Dans un rapport publié le 3 novembre, la Cour des comptes a mis en garde contre les effets budgétaires du vieillissement de la population et de la baisse de la natalité. « Premier poste de dépenses de la protection sociale, les pensions de vieillesse et de survie représentaient en effet 353 milliards d’euros en 2023, soit 13,4 % du PIB », signale le rapport. La Cour souligne que le poids de la démographie sur les finances publiques va aller croissant, et invite à repenser « la vision collective » du vieillissement et de l’âge du départ à la retraite. Pour mémoire, au début des années 1980, la dette ne finançait qu’1 % de la dépense sociale ; elle en finance désormais 10 %.
Mardi, à une courte majorité - 247 voix contre 234 (et 93 abstentions) - les députés ont validé le Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il prévoit notamment la suspension de la réforme des retraites, la hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine et la hausse de 3 % des dépenses de santé. Résultat : malgré les concessions accordées aux oppositions, le déficit de la Sécurité sociale devrait rester sous les 20Mds€ en 2026. Après un passage par le Sénat, le texte devrait revenir au Palais-Bourbon mardi prochain pour un ultime vote.
Kontildondit ?
Antoine Foucher :
De façon peut-être un peu provocatrice pour lancer le débat, les chiffres que vous venez de donner montrent que les règles actuelles du contrat social français sont devenues intenables, et que plus le temps passera, moins elles le seront. Pour trois raisons.
La première, c’est que le sens de la Sécurité sociale de 1945 a profondément changé sous l’effet du vieillissement de la population. De 1945 à la fin du XXème siècle, la Sécurité sociale était un système de solidarité et de protection contre les risques de la vie. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Elle est devenue un système de transfert intergénérationnel. En 2023, on compte 888 milliards d’euros de dépenses sociales : 100 % des 400 milliards de retraites et environ 50 % des 326 milliards d’assurance-maladie. Au total, 65 % des dépenses sociales relèvent désormais de transferts intergénérationnels, ce qui n’a plus grand-chose à voir avec la protection contre les risques. Au début de la Sécurité sociale, on vivait quelques années à la retraite et l’ensemble des actifs était exposé aux risques de maladie. Aujourd’hui, on vit entre 20 et 25 ans à la retraite, et la majeure partie de cette période se déroule en bonne santé. Le vieillissement collectif, moins d’enfants et une espérance de vie qui s’allonge, tout cela change donc le sens même de la Sécurité sociale.
La deuxième raison tient à un autre effet du vieillissement : on hérite de plus en plus tard. L’âge moyen de l’héritage est aujourd’hui de 60 ans. Il en résulte une concentration croissante du patrimoine entre les mains des plus âgés. Déjà, 60 % du patrimoine financier et immobilier est détenu par les plus de 60 ans, et les actifs d’aujourd’hui connaîtront une concentration encore plus forte que celle de leurs parents.
La troisième raison, c’est que cette situation aboutit à un phénomène inédit depuis 1945 pour les personnes qui travaillent : pour la première fois, une majorité d’entre elles n’améliore plus son niveau de vie en travaillant. Ce n’est pas uniquement dû au poids de la Sécurité sociale, mais celle-ci y contribue. Des promesses de niveau de pension ont été faites dans les décennies passées sur la base d’hypothèses de natalité et de productivité qui ne se sont pas vérifiées, mais les promesses ont pourtant été maintenues. Résultat : en quarante ans, les cotisations ont doublé. Les jeunes actifs cotisent aujourd’hui deux fois plus pour les retraites que les retraités actuels lorsqu’ils ont commencé à travailler. C’est l’une des raisons pour lesquelles le travail ne permet plus d’améliorer le niveau de vie.
Et ce n’est que le début. Ces trois phénomènes – transfert intergénérationnel massif, concentration du patrimoine chez les plus âgés, travail qui ne paye plus – vont s’aggraver. Ce n’est pas une opposition entre les boomers et leurs enfants. Pour les enfants des boomers par rapport à leurs propres enfants, la situation sera encore plus difficile. Il s’agit d’un phénomène de vieillissement qui doit nous conduire à réfléchir à de nouvelles règles du contrat social. Aujourd’hui, nous transférons de plus en plus d’argent collectif vers une population toujours plus âgée, qui détient toujours plus de patrimoine. Ce système ne permet pas de faire vivre la promesse du travail, ni celle de la Sécurité sociale de 1945, ni plus largement celle du Conseil national de la Résistance : que chaque génération vive mieux que la précédente grâce à son travail.
Si l’on veut restaurer cette promesse au XXIème siècle, il faut une grande explication collective sur la manière de financer tout cela. Cela pourrait passer par l’idée que l’ensemble des générations ait à peu près la même durée de vie à la retraite, et que le niveau de vie à la retraite corresponde à un pourcentage du niveau de vie des actifs, plutôt autour de 80 à 85 % comme en Allemagne, que des 100 % actuels. Si ces deux conditions sont respectées, alors, mathématiquement, les enfants pourront à nouveau vivre mieux que leurs parents, à rebours de la trajectoire actuelle. Restaurer la promesse de la Sécurité sociale de 1945 suppose donc de regarder les choses en face et de redéfinir un contrat intergénérationnel et un contrat social qui redonnent corps à cette idée.
Lucile Schmid :
Dans la lignée de ce que vient de dire Antoine, il est important de rappeler la dramatisation qui a accompagné le vote du PLFSS. Le gouvernement a brandi une note affirmant que, sans adoption, le déficit atteindrait 30 milliards d’euros. Les 13 voix qui ont permis l’adoption, avec plus de 90 députés abstentionnistes, ont fait bouger les lignes. Que ce soit du côté de l’ancienne majorité présidentielle ou de la gauche, notamment avec l’abstention des écologistes, il y a eu un réflexe commun : ne pas vouloir être tenu pour responsable d’un défaut de financement de la Sécurité sociale, à laquelle les Français sont très attachés, en particulier à son principe d’universalité. On voit là une interaction forte entre la société et les députés, mais aussi une difficulté à imaginer l’avenir de cette Sécurité sociale de 80 ans, dont la physionomie future reste floue. Le déficit, autour de 20 à 23 milliards d’euros, reflète précisément cette difficulté à concevoir une architecture adaptée à la société actuelle.
La question du financement, que l’on place sans cesse au centre du débat, est avant tout un symptôme. Elle révèle le décalage entre ce qui serait nécessaire pour maintenir l’universalité de la protection sociale et la réalité de la société telle qu’Antoine l’a décrite. J’ajouterai deux éléments. Il y a bien sûr la question du vieillissement, mais aussi celle des inégalités sociales. Santé publique France vient de publier son bilan, qui montre que les inégalités sociales de santé persistent, notamment en matière d’addictions, d’alcoolisme, de tabagisme ou de cancer. Les conditions sociales et les trajectoires professionnelles restent très discriminantes quand il s’agit d’être en bonne santé à 50 ou 60 ans.
Il faut aussi rappeler les inégalités territoriales. La question des déserts médicaux est aujourd’hui centrale. Le système de Sécurité sociale ne garantit pas une universalité réelle de l’accès aux droits. Les Français sont extrêmement mobilisés sur ce point : trouver un spécialiste devient très difficile en dehors de la région parisienne et des grandes métropoles, et il n’existe pas de régulation effective de ce système.
À cela s’ajoute un quatrième enjeu : la perte d’attractivité des métiers médicaux. Les étudiants et les jeunes médecins s’interrogent sur le fonctionnement actuel du système. La médecine générale, qui constitue le premier accès aux soins, n’est plus attractive. La relation médecin-patient s’est dégradée, la question de la rémunération des actes est centrale, et cela crée aussi des inégalités entre médecins eux-mêmes. Les spécialistes pouvant exercer en secteur 2 avec des dépassements importants, et de plus en plus choisissant le secteur 3, hors remboursement par la Sécurité sociale, pour retrouver du temps et une relation plus approfondie avec leurs patients. L’un des points qui a fait scandale dans le débat sur le PLFSS était précisément l’idée que consulter en secteur 3 puisse faire sortir le patient lui-même du champ de la Sécurité sociale. On voit donc des tensions très fortes autour de l’universalité et des inégalités. Face à cela, il faudrait sans doute que les médecins puissent se projeter autrement, non pas seulement comme une profession libérale, mais comme une profession libérale d’intérêt général.
Enfin, du côté des députés et du gouvernement, l’enjeu est de ne pas regarder uniquement la question du financement, mais de réfléchir à une architecture de la Sécurité sociale qui corresponde réellement à la société française telle qu’elle est aujourd’hui.
Nicolas Baverez :
Dans la mythologie grecque, Chronos dévorait ses enfants jusqu’à ce que Zeus parvienne à s’échapper. La Sécurité sociale fait mieux : elle dévore les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Elle est devenue une machine à investir dans le passé et à interdire d’investir dans l’avenir. C’est le dévoiement d’une idée qui a pourtant été remarquable à l’origine. Elle est née au croisement du solidarisme, des assurances sociales et du Conseil national de la Résistance. Pierre Laroque, dans l’exposé des motifs, avait clairement défini sa vocation : garantir à chacun qu’en toutes circonstances il disposerait des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. À l’époque, la vieillesse était synonyme de pauvreté, et le système a très bien fonctionné : aujourd’hui, le taux de pauvreté des personnes âgées est très faible.
Ce que l’on oublie souvent, c’est qu’il y avait alors autant d’argent consacré aux pensions qu’à la politique familiale. Ce système a été fondamental pendant les Trente Glorieuses : il a solvabilisé la demande, sorti une partie de la population de la pauvreté et accompagné l’industrialisation et l’urbanisation. Mais ensuite, il s’est profondément perverti. Il n’est plus un système d’assurance, mais une machine à redistribuer aujourd’hui près d’un tiers du PIB, dans une grande opacité. La Sécurité sociale s’est retournée contre ses propres objectifs. Elle casse la croissance, entretient un chômage structurel et pèse lourdement sur le pouvoir d’achat. On oublie trop souvent que sur 100 euros versés à un salarié français, 28 euros partent uniquement pour les retraites. C’est exorbitant. La population a été smicardisée et paupérisée.
Sur les retraites, le niveau de vie des retraités français est sans équivalent : c’est le seul pays où le revenu mensuel moyen d’un retraité est supérieur de 10 % à celui d’un actif. Sur la santé, en revanche, c’est une double catastrophe : un énorme problème d’accès et une dégradation très nette de la qualité des soins, avec des inégalités qui se sont multipliées. Le système est désormais clairement insoutenable du point de vue démographique. Cette année, pour la première fois depuis 1945, il y aura plus de décès que de naissances en France. Or tout le système reposait sur une démographie favorable, avec plus de jeunes que de vieux. Cette logique va s’inverser avec une baisse rapide de la population active à partir de 2030-2035. À cela s’ajoute l’effondrement de la productivité, en recul de 6 % depuis 2019, ce qui rend mécaniquement le système encore plus fragile. Sur le plan financier, le déficit réel pour l’an prochain n’est pas de 20 milliards mais de 24 milliards, si l’on inclut les 4,5 milliards de subventions de l’État. Cette année, les dépenses atteignent 667 milliards pour 644 milliards de recettes. Sur les 3.500 milliards de dette publique française, plus de 2.000 milliards relèvent de la dette sociale, devenue elle-même insoutenable. Nous sommes pourtant à un moment de l’histoire où il faudrait investir massivement dans la réindustrialisation, la transition écologique, l’intelligence artificielle et le réarmement face à la Russie. Or on n’y consacre pas un euro, parce que la Sécurité sociale, et en particulier les retraites, mange tout, parce que c’est là que se trouvent les électeurs.
Il faut évidemment préserver un système de solidarité. Mais ce qui est frappant, c’est que les solutions sont connues. Les retraites représentent 14,5 % du PIB, la santé 12,4 %, tandis que la politique familiale n’en représente plus que 2 %. Il y a donc un désinvestissement massif de la jeunesse et de l’enfance au profit du sommet de la pyramide des âges. Un nouveau pacte entre les générations est indispensable. Les solutions existent. Pour les retraites, le modèle le plus équilibré combine une retraite de base par répartition, des retraites d’entreprise et une part de capitalisation individuelle. Pour la santé, les pays d’Europe du Nord montrent la voie : le cœur du problème n’est pas dans des dérives marginales comme les transports sanitaires, mais dans l’organisation du système, avec une vraie médecine de proximité sur tout le territoire, des hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés. Tout cela est parfaitement identifié, et pourtant il ne se passe strictement rien. La situation finira donc comme en Grèce : par un choc financier brutal, rendant impossible le financement des retraites et des soins, et provoquant un ajustement extrêmement violent, à la fois politique et social.
Lionel Zinsou :
Je crains qu’à écouter nos trois camarades, on ne creuse encore le déficit par la prescription d’antidépresseurs, tant le tableau dressé est terrifiant. Revenons un instant aux chiffres. Les 30 milliards évoqués, il faudrait presque, comme en 1959, enlever trois zéros : quand on parle de milliards, on affole la population. Or 30 milliards, c’est 1 % du PIB. C’est un ordre de grandeur qu’une grande organisation sait gérer. Il n’y a qu’en France qu’on considère cela comme une catastrophe absolue, qu’on convoque Chronos dévorant ses enfants, ou qu’on affirme que le travail ne paye plus et que la Sécurité sociale ne soigne plus. Il faut arrêter avec ce pathos. Nous parlons d’un risque de déficit de 1 % du PIB. Dans n’importe quelle entreprise, c’est quelque chose que l’on sait gérer. D’autant que, notamment en matière de santé, les technologies actuelles, l’intelligence artificielle, la numérisation, offrent des gains de productivité considérables pour produire le même bien-être de façon mieux organisée.
Deuxième point : quand Antoine rappelle que l’on vit aujourd’hui 20 à 25 ans à la retraite, majoritairement en bonne santé, c’est précisément un effet majeur de la Sécurité sociale. Il est donc parfaitement rationnel que les Français soient très attachés à sa pérennité. Ce qu’ils attendent, ce sont des capacités de réforme et de bonne gestion, pas des ruptures brutales : ni un basculement soudain vers la capitalisation pour les retraites, ni un changement radical de modèle de santé. L’Europe du Nord est diverse, et si le Danemark peut être un exemple, la Grande-Bretagne montre aussi ce qu’il ne faut pas faire, avec un NHS dans une situation plus dégradée encore.
Les Français demandent avant tout que l’on gère correctement un système qui représente 1 % de déficit potentiel, de manière raisonnable, au regard de leurs besoins. Nous ne sommes pas face à une crise létale, mais à un changement démographique parfaitement prévisible depuis des décennies. Le problème, c’est que la sphère politique n’a pas réagi assez tôt. Comme Nicolas l’a dit, les solutions existent, mais elles sont absentes du débat public, remplacées par le pathos.
Il y a pourtant eu des progrès considérables de l’hôpital public en trente ans, des professions médicales de plus en plus compétentes. On ne parle que des déserts médicaux et des dysfonctionnements, jamais de la solidité globale de la couverture sociale, que les Français reconnaissent comme l’une des plus fortes.
Ce qui me choque le plus, c’est cette obsession du vieillissement présenté comme un drame. Le vieillissement est pourtant l’objectif même poursuivi par les générations précédentes. Vieillir longtemps et en bonne santé, c’est ce que l’on appelle l’espérance de vie. Dans d’autres cultures, notamment africaines, on ne parle pas du drame du vieillissement, on aspire au contraire à l’atteindre. Le vieillissement est un succès de la Sécurité sociale. Le défi n’est pas de le déplorer, mais de gérer ce succès. Notre problème n’est pas le vieillissement. Notre aspiration, c’est l’espérance de vie. Il faut changer le discours.
Lucile Schmid :
Je partage certains éléments de ce que vient de dire Lionel, notamment sur la qualité de la médecine française. J’ai d’ailleurs du mal à parler de « dette sociale » : les dépenses sociales sont utiles pour lutter contre les inégalités et pour assurer l’espérance de vie en bonne santé.
En revanche, je ne peux pas souscrire à l’idée que l’organisation du système fonctionne bien. Il existe des professionnels de grande qualité, reconnus au niveau international, mais on observe de graves dysfonctionnements entre la médecine de proximité et l’hôpital, vers lequel tout converge alors même qu’il faudrait, au contraire, renforcer l’organisation des soins de premier recours. Les jeunes générations ne veulent plus être médecins de proximité, car elles ont le sentiment qu’une bureaucratie de la Sécurité sociale les empêche d’exercer pleinement la relation avec le patient. Il y a là un problème organisationnel majeur.
Il existe aussi un enjeu financier. Il faut relativiser cette question, car elle est en partie un symptôme, mais il arrive un moment où se pose, comme l’a dit Nicolas, un problème d’investissement et de choix collectifs, y compris de choix implicites entre les priorités. Enfin, il me semble indispensable de dissocier la question des retraites et celle de la maladie. L’universalité de l’accès aux soins, notamment pour les maladies chroniques, doit être pleinement garantie. Rappelons que près de 20 % des patients en France souffrent d’une maladie chronique, ce qui est aussi un effet du vieillissement. En revanche, la situation actuelle des retraites, qui s’apparente à une forme de privilège ou de rente, me paraît profondément contraire à l’objectif de redonner une place à la jeunesse. Les contextes démographiques ne sont pas comparables, et être jeune en Afrique, au regard des phénomènes migratoires, n’est pas simple non plus. La question centrale est donc de savoir comment éviter que la hiérarchie entre les générations ne devienne déprimante pour la société actuelle.
Antoine Foucher :
Je voulais rebondir exactement sur ce que vient de dire Lucile. Ce qui est déprimant, ce n’est pas ce que nous disons, c’est l’absence totale d’action face à un constat lucide que chacun peut faire en passant un peu de temps à lire les rapports de la Cour des comptes ou des articles de presse bien documentés. Ce qui est déprimant, ce n’est pas le pathos, c’est le déni : nous n’avons pas tiré les conséquences de notre vieillissement pour préparer l’avenir de nos enfants dans un pays libre et prospère. Le vieillissement est évidemment une bonne nouvelle, une conquête, et il est largement le fruit de la Sécurité sociale. Mais jamais, ni en 1945, ni en 1975, ni en 1995, nous ne nous sommes dit qu’il faudrait un jour doubler nos dépenses de retraite au point qu’elles atteignent 14 % du PIB, alors même que les dépenses d’éducation sont reléguées beaucoup plus bas. Nous n’avons jamais décidé collectivement d’une chose pareille. Résultat, nous avons aujourd’hui les meilleures retraites du monde et une éducation classée autour de la 25ème place à l’échelle internationale. Ce sont des choix.
Il ne s’agit pas de tout jeter ni de basculer brutalement vers un autre système. Il s’agit d’une question de curseur, d’ajustement de nos priorités, donc du contrat social. Et ce n’est pas un débat entre les actifs et les retraités d’aujourd’hui. C’est une question pour le XXIème siècle. Les actifs d’aujourd’hui seront les retraités de demain, et pour leurs enfants, la situation sera encore pire si l’on reste sur ce schéma, car le vieillissement se poursuit, nous avons de moins en moins d’enfants et nous vivons de plus en plus longtemps. Il faut donc une grande explication collective pour décider, sur les 57 % de dépenses publiques, ce que nous consacrons à l’accompagnement d’une retraite en bonne santé, combien de temps nous choisissons collectivement de vivre à la retraite, et quels investissements nous faisons par ailleurs. Nicolas Baverez l’a dit : la défense, la transition énergétique, l’industrie, l’innovation. Il s’agit de savoir si la France veut rester un pays prospère.
Cela fera peut-être sourire Lionel, mais le chemin que nous prenons est très clair. Il y a cinquante ans, nous étions le cinquième pays du monde en PIB par habitant. Nous sommes aujourd’hui autour de la 26ème place. À ce rythme, dans cinquante ans, nous serons autour de la 50ème. Je ne sais pas à partir de quel rang on parle de pays tiers-mondisé, mais une chose est certaine : nous ne sommes déjà plus parmi les pays les plus riches du monde, et nous deviendrons un pays moyen à la génération suivante si nous continuons ainsi. Et je ne pense même pas que nous atteindrons cette génération avec ce système-là, car il explosera avant.
Philippe Meyer :
J’ai reçu de Jean-Louis Bourlanges un texte que je vais vous lire. D’abord parce que, pour une fois, je peux contrôler la longueur de son intervention, et ensuite parce que je le trouve, sur le plan littéraire, très réussi. Sur le fond, chacun d’entre vous en jugera. Lionel pensera sans doute que cela va encore faire augmenter la consommation de tranquillisants. Voilà ce que dit Jean-Louis :
« En faisant adopter par l’Assemblée nationale le projet de budget social de la Nation, Sébastien Lecornu a remporté une vraie victoire, mais il y a des victoires qui sont plus amères que les défaites. Le Premier ministre a réussi à construire autour du projet de financement de la Sécurité sociale le seul consensus dans lequel les Français étaient prêts à se reconnaître. Mais ce consensus est hélas celui de l’immobilisme et du renoncement. À travers son vote, le bloc central a rendu les armes et s’est aligné sur la pensée dominante du pays : zéro effort, zéro changement. Les élus ont tragiquement rejoint les électeurs sur ce qu’il y a de pire en nous. L’Assemblée nationale a voulu ignorer que les choses, telles qu’elles vont, ne peuvent pas durer. Ce sont nos libertés, notre souveraineté, notre prospérité, notre cohésion morale et sociale qui sont aujourd’hui directement menacées. Le Premier ministre a tissé avec obstination et talent le seul drap dans lequel les Français sont aujourd’hui prêts à s’envelopper. Mais ce drap est un linceul. »
L’AFRIQUE : DE JUNTE EN JUNTE
Introduction
Philippe Meyer :
En cinq ans, le Sahel a complètement changé. Les coups d’État militaires d’abord présentés comme des réponses temporaires à la crise sécuritaire, semblent installer durablement des régimes autoritaires. Au-delà du rejet commun de la présence française, ces nouveaux pouvoirs militaires peinent à formuler un véritable projet et surtout à endiguer une vague djihadiste de plus en plus meurtrière. La région est désormais secouée par des crises répétées qui ignorent les frontières nationales. Cette vague de coups d'État et de prises de pouvoir militaires a créé un paysage politique instable dans plusieurs régions. En novembre 2025, sept pays étaient dirigés par des juntes militaires, chacune avec sa propre trajectoire, sa justification et ses tensions politiques propres.
Au Mali, le retour à un régime militaire a commencé par deux coups d'État en moins d'un an, le premier en août 2020, suivi d'un autre en mai 2021. Le Burkina Faso a connu deux coups d'État militaires en 2022. L'ordre politique du Niger s'est effondré en juillet 2023. En mars 2025, la junte a adopté une charte de transition fixant un délai de cinq ans pour le retour à un régime constitutionnel. La Guinée a basculé dans un régime militaire en septembre 2021. La junte s'était initialement engagée à une transition structurée, mais le calendrier a été sans cesse repoussé. Au Soudan l’armée a pris le contrôle en octobre 2021, faisant dérailler un fragile accord de partage du pouvoir entre civils et militaires. En avril 2023, le pays a sombré dans une guerre civile brutale entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide. En octobre 2025, Madagascar a rejoint la liste des pays africains sous régime militaire. En Guinée-Bissau, le coup d'État qui a renversé le 26 novembre le président sortant Umaro Sissoco Embalo et suspendu les élections en cours est le dixième putsch en Afrique depuis 2020. Ce pays lusophone côtier d'Afrique de l'Ouest situé entre le Sénégal et la Guinée avait déjà connu quatre coups d'État et une kyrielle de tentatives de putsch depuis son indépendance du Portugal en 1974. La junte promet une transition d'un an. Les Bissau-Guinéens n'y croient plus vraiment. Dans un pays où chaque cycle électoral finit dans les casernes, la démocratie semble condamnée à ne jamais dépasser le stade de l'intention. Le Bénin, longtemps considéré comme une exception démocratique et qui n'avait plus connu de tels soubresauts depuis 1972, vient de rejoindre le club des pays touché par l’épidémie de putschs. Dimanche dernier, il s’en est fallu de peu que le pays ne rejoigne la longue liste des pays africains ayant connu un coup d’État militaire ces cinq dernières années. Le coup d’État a été mis en échec.
Kontildondit ?
Lionel Zinsou :
On pourrait avoir l’impression d’une pandémie de coups d’État, mais il existe en réalité des situations très différentes. Certains régimes se présentaient comme démocratiques alors qu’il s’agissait de démocratures, avec des résultats socio-économiques catastrophiques, renversées pour mauvaise gestion ou manipulation électorale. Ce qui vient de se passer en Guinée-Bissau en est un bon exemple. C’est typiquement un vrai faux coup d’État. Le président venait de perdre les élections, les résultats devaient être publiés quelques heures plus tard, et l’on a préféré proclamer un coup d’État, tout en emprisonnant les vainqueurs du scrutin. La démocratie avait fonctionné, mais cela ne convenait pas à celui qui perdait le pouvoir. On a donc simulé un putsch. C’est aujourd’hui largement établi pour la Guinée-Bissau. On est là face à des imperfections démocratiques, ou au refus de certaines forces d’accepter une aspiration démocratique pourtant largement partagée.
Il existe aussi des situations de prédation pure, où la logique n’est plus politique mais mafieuse, avec une captation brutale de ressources. Je n’entrerai pas dans le détail des pays concernés. Mais ce qui devient de plus en plus central, c’est l’ingérence. L’Afrique redevient un terrain d’affrontements impériaux. La Russie est très présente dans certains coups d’État ou dans leur récupération rapide. Les militaires ont besoin d’un récit, d’une idéologie clefs en main : discours anti-occidental, anti-impérialiste, usines de désinformation. La Russie est en confrontation avec l’Occident en Afrique comme elle l’est en Europe de l’Est et ailleurs.
L’ingérence prend ainsi une place croissante, sur fond d’États fragiles et de prédations. S’agissant du Bénin, la situation est différente. La stabilité du pays n’a pas été remise en cause. Dimanche dernier, pendant six heures, il y a eu une tentative de prise de la télévision et des affrontements impliquant des mutins et des forces spéciales, avec des tentatives visant certaines personnalités, dont le président. Cela ressemblait à un coup d’État, et le discours diffusé dénonçait un régime inégalitaire et choquant sur le plan social et économique. Mais nous étions à trente jours d’élections législatives inclusives, avec toutes les oppositions présentes, et à cent cinquante jours de la fin du mandat présidentiel. Faire un coup d’État pour renverser quelqu’un qui s’apprête à partir, c’est surtout chercher à suspendre les élections ... Dans le cas du Bénin, on est face à une variante nouvelle : un acte relevant de la guerre, impliquant des pays étrangers. Il n’y a pas eu un seul citoyen dans la rue pour soutenir ce prétendu mouvement de libération, malgré les réseaux sociaux. L’armée a repris la situation en main de façon républicaine et extrêmement rapide. Mais l’essentiel est ailleurs. La menace était connue. Les pays sahéliens, Mali, Burkina Faso, Niger, encerclés par les djihadistes, ont un besoin vital de corridors pour s’approvisionner, notamment en matériel militaire. Ils sont en grande difficulté avec leurs voisins, et les groupes djihadistes contrôlent désormais largement les frontières. Le Bénin constituait l’un de ces rares accès. Il y avait donc là un acte de guerre. Nous sommes dans une forme de guerre froide en Afrique de l’Ouest. Ce n’est pas un coup d’État domestique contre des institutions qui ont d’ailleurs bien résisté. Les pays côtiers menacés ont décidé qu’en cas de tentative de ce type, la réponse serait immédiate. En deux heures, elle est venue du Nigeria, de la Côte d’Ivoire et du Ghana. C’est ce qui manquait jusque-là face à des actes de cette nature. Il s’agit donc d’un coup d’État très particulier, qui n’est pas d’abord interne.
Lucile Schmid :
Alors que, dans les années 2010, on pensait assister à un mouvement de démocratisation dans de nombreux pays africains, on observe aujourd’hui plutôt une dynamique de démocratures, voire de dictatures militaires s’agissant des pays sahéliens. Lors des putschs, le pouvoir est toujours pris au nom de la démocratie et du bien-être du peuple. Or, quelques années après les prises de pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina Faso, le constat est clair : la vie des populations s’est dégradée, des milliers de personnes sont mortes du fait du terrorisme islamiste, et l’on assiste, comme Lionel l’a souligné, à l’entrisme de puissances étrangères venues occuper l’espace laissé par la France.
Il faut en parler, car cette situation représente une menace majeure pour la France, y compris en termes de risques d’attentats sur son propre territoire, du fait de l’implantation durable des groupes djihadistes au Sahel. Lionel a évoqué la Russie, mais il faut aussi mentionner la Chine et la Turquie. La Turquie, en particulier, profite de l’éviction de la France pour renforcer sa présence. C’est un grand pays musulman, avec des intérêts économiques affirmés, et contrairement à la Chine, elle ne sépare pas coopération civile et coopération militaire. Elle équipe aujourd’hui certains États du Sahel, notamment en drones.
Nous sommes donc face à une situation où l’instabilité de cette région constitue aussi une menace directe pour le territoire français. Cela a été dit très clairement par le directeur de la DGSE ces dernières semaines. Un deuxième élément important est l’interruption du cycle électoral, à l’exception de quelques pays. Le Bénin, en particulier, a longtemps fait figure d’exception démocratique en Afrique de l’Ouest, souvent présenté comme un laboratoire démocratique. Face à l’arrivée au pouvoir de militaires qui n’ont aucune intention d’organiser des élections à court terme, il faut rappeler que les partis politiques ont été dissous au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qu’ils sont largement réduits au silence, et que les anciens dirigeants sont emprisonnés et maintenus en détention. Il existe aussi une tentation autoritaire dans des pays encore formellement démocratiques : au Sénégal, en Côte d’Ivoire, et l’on ne sait pas ce qu’il adviendra au Bénin dans les prochaines semaines. Face à l’instabilité djihadiste, aux menaces sur les populations et à l’éviction de la France, ce qui subsiste de démocratie risque à son tour de glisser vers davantage d’autoritarisme. C’est un motif de préoccupation majeur.
Nicolas Baverez :
L’Afrique a été l’un des grands succès de l’après-guerre froide et de la mondialisation. Pour la première fois, au début du XXIème siècle, elle connaissait une croissance de 5 % par an, supérieure à la croissance démographique. C’était inédit depuis les indépendances. Tout s’est ensuite retourné, d’abord sur le plan économique. Les grands moteurs, comme le Nigeria ou l’Afrique du Sud, sont en difficulté. La croissance est désormais inférieure à la croissance démographique. À cela s’ajoute une épidémie de coups d’État, du Mali jusqu’à Madagascar, et une généralisation des conflits. Le continent est redevenu celui des guerres, souvent épouvantables, comme au Soudan ou au Congo, et cette violence s’installe dans la durée. L’Afrique semble, d’une certaine manière, replonger au cœur des ténèbres.
Porte-t-elle une part de responsabilité ? Assurément. Mais elle est loin d’être la seule. Ce qui frappe surtout, c’est que tous les acteurs extérieurs ne réagissent pas de la même façon, et que l’Occident est en train de perdre l’Afrique. Le document produit par l’administration Trump sur la nouvelle stratégie de sécurité est à cet égard saisissant : l’Afrique y figure au dernier rang des priorités, avec à peine trois paragraphes consacrés à un continent qui comptera pourtant 2,5 milliards d’habitants en 2050.
L’un des aspects les plus tristes des présidences Macron est l’expulsion progressive de la France du continent africain. L’Europe, de son côté, ne pense plus l’Afrique qu’à travers la question migratoire. Ailleurs, la stratégie est tout autre. La Chine investit massivement dans la prédation des ressources naturelles, les infrastructures, et la mise sous dépendance de certains pays, qui servent de têtes de pont, comme l’Éthiopie. La Russie s’est spécialisée dans la captation des mines, la protection des dirigeants et la prédation militaire. L’Inde et le Brésil privilégient plutôt des coopérations économiques positives. La Turquie combine, elle, islamisme politique et puissance militaire, notamment à travers l’usage des drones.
Pour sortir de cette catastrophe, dans un monde qui se restructure en blocs, Européens et Africains devraient se rappeler qu’il serait rationnel de coopérer ensemble. L’Europe a besoin de l’Afrique, à la fois pour ses matières premières et parce qu’elle va devenir le principal réservoir de main-d’œuvre du monde. L’Afrique, enfermée dans le ressentiment colonial, pourrait pourtant trouver en Europe un partenaire capable de l’aider à éviter de tomber entièrement sous la domination des prédateurs qui structurent le XXIème siècle.
Antoine Foucher :
Je voudrais insister sur un point : ces coups d’État peuvent sembler lointains, de l’autre côté de la Méditerranée, mais nous sommes directement concernés, nous Français et Européens, pour deux raisons. La première est potentielle, la seconde est certaine.
La première concerne notre sécurité. Cela a été dit : il y a aujourd’hui de nombreux djihadistes dans ces régions, avec des tentatives de constitution de territoires contrôlés. Les attentats de 2015, il y a dix ans, n’auraient pas été possibles, selon des analyses comme celles d’Hugo Micheron, sans l’existence de bases djihadistes hors du territoire européen, en Syrie et en Irak. Il existe donc un lien direct entre l’augmentation de la menace djihadiste en France et en Europe et la reconstitution d’entités djihadistes en Afrique. Il n’y a évidemment aucune certitude quant à la survenue d’attentats, et heureusement, mais l’écosystème qui a rendu possibles ceux de 2015 est en train, ou pourrait être en train, de se reconstituer avec ces coups d’État dans lesquels les djihadistes sont impliqués. C’est le premier point.
Le second, en revanche, est beaucoup plus certain : c’est la démographie. Il y a cinquante ans, l’Europe et l’Afrique comptaient à peu près le même nombre d’habitants, autour de 500 millions chacune. Aujourd’hui, il y a environ 500 millions d’Européens et 1,5 milliard d’Africains. Selon l’ONU, en 2050 ou 2060, il y aura environ 400 millions d’Européens pour 2 à 2,5 milliards d’Africains, dont les deux tiers ont aujourd’hui moins de 25 ans.
Moins l’Afrique sera un continent prospère, ou au moins stable, capable d’assurer un minimum de sécurité à ses citoyens et de permettre aux familles de se projeter pour elles-mêmes et leurs enfants en restant sur place, plus la pression migratoire sera forte. De ce point de vue, nous ne sommes qu’au début de la crise migratoire, ou plutôt de la pression migratoire de l’Afrique vers l’Europe. C’est un phénomène qui ne fait que commencer, pour des raisons strictement démographiques. Plus le continent africain sera instable, plus cette pression augmentera. Nous avons donc un intérêt direct à agir. Comment le faire, c’est une autre question. Peut-être que la meilleure manière de participer est parfois de ne pas s’en mêler. Mais une chose est sûre : nous sommes directement concernés par l’accélération de l’instabilité dans cette partie du monde.
Lionel Zinsou :
Je suis assez proche de l’ensemble de vos analyses, qui nourrissent utilement la réflexion, mais je voudrais apporter trois précisions. D’abord, le djihadisme est bien présent, mais il reste très minoritaire dans ce qui se passe aujourd’hui, notamment au Sahel. Le phénomène central, ce n’est pas d’abord une matrice d’attentats en Europe, même si, géographiquement, le nord du Mali est à une heure d’avion d’Algésiras ou de Séville. La réalité dominante est celle du crime organisé. Le Sahel, une partie du Soudan et des zones bien plus larges encore sont devenus des espaces de trafics : drogue, cigarettes, faux médicaments, armes, traite des êtres humains. Il s’agit d’une logique mafieuse bien davantage que d’un projet spirituel ou idéologique.
Deuxième précision : si l’Afrique comptera demain deux milliards d’habitants, ce n’est pas parce que la fécondité augmente, mais parce que l’espérance de vie progresse. Dans les années 1960, au moment des indépendances, l’espérance de vie à la naissance était d’environ 30 ans dans les anciennes colonies françaises. Aujourd’hui, dans ces États indépendants, elle atteint 62 ans. Chaque année, l’espérance de vie à la naissance progresse d’environ un demi-an. Si nous étions au Congo ou au Mali, dans le temps de notre conversation, nous aurions déjà gagné une demi-heure d’espérance de vie.
Enfin, sur la croissance, Il existe en Afrique des pays dont la croissance économique est supérieure à la croissance démographique. C’est le cas, par exemple, du Bénin, de la Côte d’Ivoire ou du Rwanda. En 2025, sur les dix pays affichant les taux de croissance les plus élevés au monde, sept sont africains. Il y a donc de fortes différences entre les pays. Certains sont en faillite ou en régression, d’autres avancent très vite vers la modernité. Le problème, c’est que ceux qui progressent rapidement, y compris sur le plan démocratique, deviennent parfois gênants pour ceux qui régressent, et cela peut aller jusqu’à des actes de guerre.