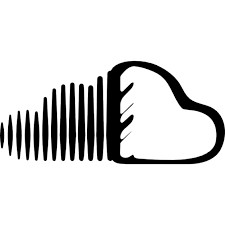L’AMÉRIQUE DE TRUMP VS. L’EUROPE DIVISÉE
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Cette émission prend une forme un peu spéciale : un dialogue, ou plutôt un trilogue si je m’en mêle, entre deux voix que vous connaissez bien, Nicole Gnesotto, qui vient de publier chez Odile Jacob, en octobre, « Fractures dans l’Occident » et Richard Werly, dont le livre « Cette Amérique qui nous déteste, la comprendre pour mieux lui répondre », est paru en septembre aux éditions Nevicata.
Vos deux ouvrages se croisent sur de nombreux points — sans concertation préalable — notamment sur les États-Unis, sur l’Europe et sur l’attitude réciproque de ces deux ensembles. Si je relève quelques éléments saillants : Nicole Gnesotto, vous mettez un coup de projecteur sur nos erreurs. Nous n’avons pas vu assez tôt que la société américaine glissait vers le protectionnisme et le conservatisme ; nous n’avons pas vu la fin de l’ouverture modernisatrice de la Russie ; et nous avons cru que le commerce garantissait la paix. Pour vous, la tentation américaine de se protéger, de s’isoler — voire davantage — remonte au Tea Party, au début des années 2000. Face à cette attitude américaine, vos questions concernent l’Europe. Deux voies radicalement opposées : la voie dite « mollusque », qui consisterait à se soumettre mollement aux États-Unis, et la voie « Mohican », c’est-à-dire la résistance, même si l’Europe devait se réduire. L’idée d’une diminution du nombre de pays composant l’Union ne vous scandalise pas, vous qui êtes une vieille Européenne. Car la fracture ne se limite pas au couple Europe–États-Unis : elle traverse l’Europe elle-même.
Richard Werly, dans Cette Amérique qui nous déteste, dédié à ceux qui osent encore croire au rêve américain, vous livrez un carnet d’observations tenu lors d’un voyage aux États-Unis, quand Trump venait de revenir au pouvoir. Vous avancez par étapes, par impressions successives — je pense par exemple au musée John Deere à Waterloo (Iowa), que peu de gens connaissent, et que vous prenez comme symbole de l’agriculture américaine. Vous êtes frappé, peut-être choqué, par le mépris profond des élites américaines — surtout les partisans de J.D. Vance — pour l’Europe. Pour vous, le vice-président en rajoute encore par rapport à son président : les Européens seraient des vassaux, tenus d’obéir et de penser comme les États-Unis. Et vous estimez que Washington s’inspire de sa relation avec le Japon pour imaginer celle qu’il pourrait imposer à l’Europe. Puis vous vous tournez vers nous. Suisse, vous vous révélez plus européen que bien des Européens, et vous notez à quel point l’Europe a perdu l’esprit de conquête, le goût du risque et de l’aventure. Cela rejoint ce que dit J.D.Vance à notre propos : les Européens seraient résignés à défendre leurs avantages, et leur frilosité nourrirait le mépris d’une Amérique qui nous déteste. Et cette Amérique-là ne se limite pas aux trumpistes : elle dépasse largement ce camp. Peut-être reviendrez-vous aussi sur votre méditation à propos du projet d’Elon Musk de nous envoyer tous sur Mars.
Kontildondit ?
Nicole Gnesotto :
Au départ, je suis partie d’une interrogation : pourquoi plus de 75 millions d’Américains, qui ne sont ni les plus stupides, ni les plus pauvres, ni les plus arriérés, ont-ils voté pour un homme dont le programme consiste à détruire tout ce qui a fait la puissance de l’Amérique depuis 1945 ? Pourquoi ce qui fonde l’Amérique — le libéralisme économique, la démocratie politique, le primat du droit sur la force — est-il apparu dépassé, inutile, inefficace à la classe moyenne comme aux milliardaires de la tech, ces deux piliers de l’électorat de Trump ? C’était mon point de départ. Dans le livre, j’essaie à la fois d’expliquer comment nous n’avons rien vu venir et de remonter aux racines structurelles des inégalités sociales, qui me semblent être le message essentiel.
En avançant dans le travail et en lisant beaucoup, je me suis rendu compte que, si le livre de Richard est une enquête journalistique passionnante, nourrie de détails qui montrent que la réalité est encore pire que je ne l’imaginais, le mien est plutôt un travail d’enquête par lectures — think tanks, rapports, analyses — pour comprendre comment la société américaine perçoit le monde. Et en réfléchissant, j’ai compris que la vraie contre-révolution trumpienne n’était pas là où on l’attendait. Ce n’est pas d’abord la géopolitique, le refus d’aider l’Ukraine, la connivence avec la Russie, l’indifférence à l’OTAN : tout cela est presque secondaire. La vraie révolution trumpienne est une révolution contre la démocratie.
Je rejoins les conclusions de Richard à ce propos, même si j’y suis parvenu par d’autres voies. Richard dit que Trump nous déteste, nous Européens ; moi, je dis qu’il déteste la démocratie. Et comme nous incarnons ce modèle plus que tout autre continent, il nous déteste logiquement. Je crois que c’est là le message essentiel : il faut se méfier de l’idéologie autoritaire assumée de certains proches de Donald Trump. Elle se résume dans la phrase de Peter Thiel : « la liberté est incompatible aujourd’hui avec la démocratie ».
C’est cela qui m’a le plus mobilisée dans l’écriture : comment faire pour que l’Europe maintienne un système fondé sur la triade qui a fait son succès après-guerre — libéralisme, démocratie, droit — et évite qu’elle ne soit remplacée par la triade apocalyptique que promeuvent les idéologues trumpiens : protectionnisme, autoritarisme, force. Or, historiquement, protectionnisme, autoritarisme et force, c’est la recette de toutes les guerres. Dans une dernière partie, je développe en effet cette opposition entre Europe « mollusque » et Europe « mohican].
Richard Werly :
D’abord, je voudrais dire que j’aurais aimé être un étudiant de Nicole Gnesotto, car elle dresse dans son livre un panorama remarquablement pédagogique de la situation actuelle. C’est rare de parvenir à embrasser un sujet aussi vaste que les fractures de l’Occident avec autant d’acuité et de précision. Il y a des points sur lesquels je suis en désaccord, mais là n’est pas la question : son livre restitue admirablement la réalité géopolitique d’aujourd’hui, et il mérite vraiment d’être lu.
Ensuite, nos démarches sont très différentes. J’ai une démarche journalistique, une forme de géopolitique de terrain. Mon objectif n’était pas de théoriser la chute de l’Amérique ou l’apparition d’une nouvelle Amérique, mais d’écouter les Américains, d’entendre ce qu’ils me disent, et d’en tirer quelques conclusions. D’ailleurs, ce livre n’était pas prévu. Vous vous en souvenez, Philippe : je voulais simplement passer la campagne électorale américaine sur place. J’y suis resté trois mois, et j’ai parcouru une grande partie du pays en camping-car, de Chicago au nord jusqu’à Mar-a-Lago au sud, le golfe de M. Trump. Tout au long de cet itinéraire, j’ai rencontré l’Amérique que je voulais voir, dans les campings où l’on gare son véhicule, ou sur les parkings des Walmart et des Costco, les deux seuls endroits où l’on peut stationner sans être prié par la police du comté d’aller voir ailleurs. Ce qui m’a frappé, particulièrement dans leur rapport aux Européens, n’apparaît pas au premier abord. Les Américains MAGA (Make America Great Again) que Trump a formidablement réussi à fédérer malgré des courants très différents — ne sont pas spontanément anti-européens. Ils restent d’un abord sympathique, faciles à rencontrer, faciles à faire parler. Ce n’est pas l’Europe qu’ils visent d’emblée. Mais très vite, dès qu’ils apprennent que vous êtes européen et que vous parlez de la relation transatlantique, le ton change. Et pourquoi cela s’envenime-t-il ? Je reprends ici une expression entendue récemment en télévision, et que je trouve très pertinente : les États-Unis sont aujourd’hui en proie à un « nationalisme colérique ». C’est, à mes yeux, une clef essentielle pour comprendre l’Amérique de Trump. Cette Amérique-là est profondément nationaliste, traversée par le ressentiment, enfermée dans ce sentiment — théorisé par Bertrand Badie — d’humiliation. Une humiliation paradoxale, car ce sont eux qui ont humilié tant de nations, et non l’inverse. Pourtant, ils se vivent comme les humiliés du monde, et cela nourrit une colère profonde.
La colère est le moteur de l’Amérique : colère pour réussir, pour gagner de l’argent, pour s’imposer. C’est consubstantiel à ce pays. Ce n’est pas un hasard si, pour construire leur nation, ils ont fait ce qu’ils ont fait aux populations natives d’Amérique. Aujourd’hui, ce moteur colérique rencontre un nationalisme exalté par le slogan Make America Great Again. Trump répète sans cesse que l’Amérique est le plus beau pays du monde, et il le dit trois ou quatre fois pour être sûr que vous ayez compris. Cette combinaison mène directement à l’idée que « l’Union européenne nous a entubés ». Et c’est cela qui m’intéressait : montrer qu’en face de nous, de l’autre côté de l’Atlantique, surgit désormais une Amérique pour laquelle nous ne sommes pas préparés. Nous n’avons pas été éduqués à nous méfier de l’Amérique. Certes, nous savions ce qu’elle faisait en Amérique latine, mais nous avons grandi dans l’idée qu’elle serait toujours de notre côté. Ce n’est plus vrai. Une partie de l’Amérique ne nous considère plus comme des alliés. Pourquoi nous déteste-t-elle ? Parce que nous incarnons tout ce que cette Amérique rejette : des puissances jugées faibles — alors que la force est devenue cardinale —, des puissances trop métissées, perçues comme trop islamisées, et enfin des puissances qui ne s’assument pas. Car, dans l’ère Trump, si vous êtes une puissance, vous cognez d’abord et vous discutez ensuite.
Philippe Meyer :
Si l’on examine ce qu’il y a de vrai, d’exagéré ou de fantasmé dans cette attitude des États-Unis à l’égard de l’Europe, il me semble qu’il existe chez nous — en tout cas en France — une ambiguïté profonde. Jacques Julliard avait raison de dire que « l’anti-américanisme, c’est le socialisme des imbéciles » : on pouvait longtemps passer pour socialiste simplement en étant anti-américain. Cela a été vrai pendant des décennies. Il y a d’ailleurs une réplique dans le film de Costa-Gavras, Z : l’un des partisans d’Yves Montand, député de la gauche très à gauche, joué par le merveilleux Charles Denner, dit à un moment : « il faut toujours t’en prendre aux Américains ; si toi tu ne sais pas pourquoi, eux le savent ». Cela fait partie de notre réflexe national.
Et en même temps, il y a un réflexe inverse : se chercher un abri dans le giron des États-Unis, pour quantité de choses, y compris culturelles, mais surtout pour notre défense. Quand Trump, très tôt, a sonné le tocsin en demandant si les États-Unis allaient payer éternellement pour nous, force était de reconnaître qu’il n’était pas sans arguments.
Nicole Gnesotto :
Oui. Sur l’anti-américanisme français, je crois que, contrairement à ce que vous dites, Philippe, nous savons très bien pourquoi nous, Français, avons ce fond culturel anti-américain. Il vient tout simplement de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le général de Gaulle a décidé de construire l’indépendance militaire et nucléaire de la France, c’était avec la conviction que les Américains n’étaient entrés en guerre qu’après avoir été attaqués à Pearl Harbor, donc très tard, et certainement pas pour défendre la France. Ils auraient pu se satisfaire d’une France occupée. C’est cette leçon que de Gaulle a tirée de l’histoire, et c’est cette leçon que la République transmet depuis des générations. C’est pourquoi nous sommes les seuls en Europe à porter cette image : une Amérique venue deux fois à la rescousse, mais avec laquelle il faut toujours prendre des pincettes et dont il ne faut jamais dépendre aveuglément.
Cet anti-américanisme français est donc une exception européenne, mais il repose sur une analyse historique que l’école de la République continue de transmettre. À tel point qu’aujourd’hui, beaucoup nous donnent raison. Même des dirigeants finlandais, parmi les plus atlantiques d’Europe, nous disent désormais que de Gaulle avait raison : on ne peut pas se fier totalement à l’Amérique. Il y a des moments où les erreurs finissent par devenir des vérités, et nous sommes précisément dans un de ces moments. Nos partenaires européens reconnaissent aujourd’hui qu’on ne peut pas dépendre entièrement des États-Unis. D’où l’idée, largement partagée, que l’Europe doit bâtir son autonomie stratégique pour réduire sa dépendance à une Amérique devenue de plus en plus anti-européenne — et, quand je dis anti-européenne, il faut comprendre une Amérique de plus en plus tentée par le fascisme. N’oublions pas que les proches de Trump, Steve Bannon et Elon Musk, financent les mouvements d’extrême droite en Allemagne et au Royaume-Uni. La leçon est claire : les Européens savent désormais qu’ils doivent se libérer progressivement de l’allégeance américaine.
Mais survient alors le tragique européen. À chaque étape de l’histoire du continent, il y a un moment tragique, et aujourd’hui, il est le suivant : faut-il choisir entre la menace russe et la menace américaine ? Entre le risque d’agression russe et le risque d’abandon — voire de trahison — américain ? Et tous les Européens choisissent la priorité russe. Résultat : tout le monde affirme vouloir une défense autonome, comme le demande d’ailleurs le secrétaire d’État américain à la Défense lui-même, mais dans les faits, chacun accroît sa dépendance envers les États-Unis pour les maintenir engagés en Ukraine et face à la Russie. Nous en arrivons à une situation abracadabrantesque : à cause de la menace russe, les Européens avalent toutes les couleuvres américaines, y compris un accord commercial totalement déséquilibré ; y compris cet épisode où, alors que la Commission avait annoncé vouloir investir 800 milliards en Europe — et pouvait en prêter 150 pour la Défense — les Européens ont accepté, dans le cadre de cet accord, d’investir 600 milliards … aux États-Unis, et non pas en Europe. Une Europe qui marche sur la tête.
Pour revenir à la France, oui, nous avons ce fond culturel anti-américain, qu’une partie de la gauche a d’ailleurs exploité de manière superficielle, mais qui, lui, est profondément ancré dans l’identité française. Et nous avons aussi ceci : De Gaulle, tout en quittant la structure militaire intégrée de l’OTAN, n’a jamais quitté l’Alliance. Il l’a dit plusieurs fois : « je sais où est ma famille ». Il a été solidaire de la crise de Cuba, solidaire des Américains quand il le fallait. Mais la France a construit son indépendance nucléaire totale — et une indépendance militaire partielle, puisque nous restons dans l’ombre de l’OTAN — tout en demeurant à l’abri de l’Alliance Atlantique.
Philippe Meyer :
Il me semble tout de même que le rôle du Parti communiste français dans l’anti-américanisme a été très important. Peu de pays démocratiques avaient un Parti communiste aussi puissant. L’Italie, oui, mais la différence dans le rapport aux États-Unis entre la France et l’Italie tient à ceci : énormément d’Italiens ont émigré vers l’Amérique. Il existe un lien profond entre les deux pays, un lien humain, culturel, pas seulement politique. Difficile, dans ces conditions, de faire abstraction de ce « tu vuo’ fa’ l’americano », comme chantait Renato Carosone.
Richard Werly :
Je rebondis d’abord sur ce que vient de dire Nicole à propos de la menace russe. Il faut avoir conscience que les Européens ont fait un choix : ils ont décidé de faire face en priorité à la menace russe. Géopolitiquement, c’est ce choix qui nous place dans les mains des Américains. Et cela nous oblige à poser une question — une question qu’il faut avoir le courage de poser : cette guerre en Ukraine ne sert-elle pas, objectivement, les intérêts des États-Unis ? Nous forcer à nous profiler coûte que coûte contre la Russie, n’est-ce pas précisément ce que souhaitent les Américains depuis le début ? Je m’arrête là ; cela mériterait une autre émission, mais cette interrogation mérite vraiment d’être examinée de près.
Sur l’anti-américanisme maintenant. Philippe, vous m’avez accompagné tout au long de ce voyage, car je connais votre affection pour Jean-François Revel. Je suis parti avec la version anglaise de son livre Anti-Americanism, et aussi avec Le Défi américain de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Ces deux ouvrages ne disent pas la même chose, mais leurs auteurs ont en commun d’aimer l’Amérique — chacun à sa manière et à son époque.
Ce qui a fondamentalement changé aux États-Unis, et que Trump a su catalyser, c’est sa capacité à être à la fois moteur et surfeur. Il met les choses en mouvement et il sait ensuite chevaucher la vague — ce qui est rare. La plupart des responsables politiques sont l’un ou l’autre ; lui réussit à être les deux. Ce qui m’a frappé, c’est que l’Amérique ne comprend plus l’Europe. Elle ne comprend plus les Européens, y compris ceux qui sont de familles européennes. J.D. Vance en est la caricature. Le vice-président, avec ses racines écossaises et allemandes, vient de ce milieu des Appalaches dont il a fait le cœur de son autobiographie Hillbilly Elegy. Ce lieu, Panbowl Lake, dans le Kentucky — où je suis allé — est son creuset. Pourtant, c’est lui qui tient aujourd’hui les propos les plus agressifs vis-à-vis de l’Europe, comme lors de la conférence de Munich en février 2025. Pourquoi ? Je vois deux raisons principales.
La première, c’est qu’ils estiment que nous les avons abandonnés en Irak. L’armée américaine produit énormément de vétérans, parce que c’est une machine qui absorbe puis rejette ses soldats. Et ces vétérans, on ne leur a pas dit qu’ils allaient se battre pour le pétrole. On leur a dit qu’ils étaient les défenseurs de l’Occident contre l’islam, les héritiers du combat mené après le 11 septembre. Ils ont enregistré l’absence de la France et de l’Allemagne, et ils l’ont très mal vécue. Même en Afghanistan, où l’OTAN était engagée, où les Français ont perdu des hommes, ils ont considéré qu’ils étaient les seuls à se battre. Cette impossibilité américaine d’admettre que d’autres puissent être à leurs côtés — ou en désaccord — est constante. Et cela crée du ressentiment.
La deuxième raison est plus profonde : ils estiment qu’ils sont l’Occident. Pour eux, les valeurs de l’Occident sont « religion, famille, patrie ». Le travail s’y ajoute difficilement, car ces populations sont souvent déclassées, vivant dans des régions désindustrialisées. Mais ces trois valeurs cardinales constituent, à leurs yeux, l’ADN occidental — et ils reprochent à l’Europe de les avoir abandonnées. La démocratie, pour eux, ne fait pas partie de ces valeurs.
Cela m’amène à Peter Thiel, ce milliardaire d’origine allemande, passé par l’Afrique du Sud, propriétaire de Palantir et de PayPal, et véritable tuteur politique de J.D. Vance, qu’il a largement financé. Cette Amérique-là est une Amérique blanche. Il faut le dire. Le suprémacisme blanc est à l’œuvre, et j’en vois une preuve très forte dans l’une des mesures récentes des services de l’immigration : alors qu’ils traquent sans ménagement les migrants illégaux — latinos et autres — qu’ils emprisonnent ou expulsent parfois très loin, ils ont ouvert les portes des États-Unis aux Afrikaners d’Afrique du Sud, en leur offrant des visas avec facilités d’établissement. Si ce n’est pas une manifestation claire du suprémacisme blanc, je ne vois pas ce que c’est.
Nicole Gnesotto :
Oui. Le suprémacisme, le racisme, l’antiféminisme, la volonté de recréer une inégalité sociale et raciale dans cette Amérique, tout cela correspond à ce que j’appelle, dans mon vocabulaire courant, le retour d’un certain fascisme occidental. Notre science politique est assez démunie devant ce phénomène : nos concepts décrivaient une réalité désormais dépassée. Ce qui se passe aux États-Unis entre mal dans nos catégories. Quand je parle de fascisme américain, on me regarde comme si j’exagérais, mais c’est simplement parce que nous n’avons pas encore trouvé le bon mot. Certains parlent de démocratie illibérale, d’autres de populisme ; pour ma part, je dirais démocratie autoritaire. C’est quelque chose de cet ordre-là qui se joue aux États-Unis.
Je voudrais revenir sur deux points du livre de Richard Werly, deux dimensions que lui développe beaucoup et que j’ai davantage laissées de côté. D’abord, l’importance de la religion. On le sait depuis longtemps, mais là, c’est documenté, illustré, analysé avec une précision effrayante. Ensuite, la corruption. L’importance de la corruption : un pays où la corruption devient une manière parmi d’autres de s’enrichir, d’enrichir son clan — qu’il s’agisse des milliardaires de la tech, de certains Blancs aisés, ou d’autres groupes. Richard montre très bien cette corruption interne, mais aussi la corruption visant les élites internationales, notamment celles du Moyen-Orient, ce qui contribue encore à noircir l’image des États-Unis.
Quand Richard dit qu’ils ne nous comprennent pas, je ne suis pas tout à fait d’accord. Je pense plutôt qu’ils ne nous aiment pas, parce que deux choses que représente l’Europe leur sont devenues odieuses — des choses qu’ils voulaient autrefois, mais qu’ils ne veulent plus du tout. La première, c’est la liberté démocratique européenne, c’est à dire l’idée que la liberté doit être encadrée par la loi, par des institutions publiques, et qu’elle n’est pas le droit du plus fort. Pour ces Américains-là, et en particulier pour les milliardaires de la tech, cette conception européenne de la liberté, c’est l’interdiction d’inventer, de financer, d’investir comme ils veulent. Ce qu’ils détestent profondément, ce sont les obsessions européennes sur la régulation, en particulier du numérique. Thierry Breton, l’Union européenne et tout l’arsenal normatif mis en place sont devenus leurs ennemis jurés.
La seconde chose qu’ils nous reprochent, et là malheureusement avec raison, c’est d’avoir été des parasites pendant huit décennies sur le plan militaire. Nous avons construit notre puissance économique et notre euro — qui leur fait de l’ombre — à l’abri du parapluie américain, payé par les États-Unis. Et c’est assez vrai. Quand on regarde les dépenses au sein de l’OTAN, 70% sont américaines. Grâce à cela, les Européens ont pu devenir une puissance économique et normative à moindre coût : quand on ne finance pas sa défense, on peut investir ailleurs. Et il faut reconnaître que leur reproche n’est pas entièrement infondé. Les Européens l’ont d’ailleurs compris : ils ont accepté d’augmenter leur effort de défense jusqu’à 5% du PIB pour calmer les Américains. Ce qu’ils veulent détruire, c’est donc cette Europe parasite et normative. Et ils font une distinction très nette entre les pays européens et l’Union européenne. Ce que les États-Unis visent aujourd’hui — peut-être pour la première fois depuis la naissance du projet européen — c’est l’institution elle-même. Alors qu’après la guerre, ils avaient été les premiers à soutenir Schuman et Monnet afin de contrôler le retour d’une puissance allemande, ils étaient globalement favorables à l’intégration européenne. Ils ont tenté de torpiller l’euro dans les années 2000 ; ne pouvant le faire, ils s’en sont accommodés. Aujourd’hui, ils mènent une véritable offensive contre l’Union européenne, perçue comme un empêcheur d’investir (et de tricher) en rond.
Richard Werly :
Je reviens sur la corruption. Je pense que l’une des grandes différences entre l’Amérique de Donald Trump et les Européens, aussi bien les gouvernements que les mentalités, c’est que Trump vénère la corruption. Il ne l’appelle pas ainsi, bien sûr. Mais si l’on regarde son enrichissement : le Wall Street Journal a récemment montré que sa famille élargie avait gagné un milliard de dollars depuis son élection du 5 novembre 2024. Un milliard en moins d’un an, puisqu’il n’a été investi que le 20 janvier. Si l’on suit ce rythme, cela fait quatre milliards sur tout son mandat — puisqu’il doit quitter le pouvoir en 2028, même s’il entretient parfois le doute.
Pourquoi ? Parce qu’aux États-Unis, l’argent occupe une place centrale. Sans argent, on ne fait rien : assurance maladie, université, services de base … Tout dépend de votre capacité à payer. Mais pour Trump et les siens, cela va beaucoup plus loin : l’argent est un signe d’intelligence. Ne pas faire d’argent, c’est être stupide. Être professeur, c’est être stupide. Être travailleur social, c’est être stupide. L’argent n’est pas seulement un critère de bien-être matériel : c’est un critère qui classe les individus et les nations.
D’où une typologie très simple, à ses yeux. D’abord, les pays riches sans effort, grâce à leurs ressources naturelles : Arabie Saoudite, pays du Golfe. Ceux-là sont riches, donc respectables, même s’ils ne « travaillent » pas. Et ils sont, selon lui, redevables à l’Amérique. Le Qatar a ainsi payé un avion qui deviendra le futur Air Force One. Deuxième catégorie : les pays « besogneux » qui acquièrent leur richesse par le travail. C’est pour cela que Trump respecte les pays d’Asie émergente. Il leur a imposé des tarifs douaniers entre 15% et 19%, bien qu’ils soient très exportateurs, mais il considère qu’ils valorisent le travail et la création de richesse — ce qui compte énormément à ses yeux. Et puis, il y a les pays qu’il déteste. Je mets de côté l’Afrique, qui n’existe pratiquement pas sur son radar, sauf le Rwanda pour sa réussite économique, et l’Afrique du Sud pour des raisons que j’ai évoquées. Ce qu’il déteste vraiment, ce sont les Européens. Là, c’est pour lui l’exemple même du renoncement à la richesse : l’égalité, la redistribution, l’État social. Pour Trump — et encore plus pour Elon Musk — c’est un péché mortel. On ne renonce pas à la richesse. Si on y renonce, on ne mérite pas la confiance de l’Amérique. Chez Trump, la richesse est la mesure de la valeur culturelle. Chez Musk, la richesse est l’instrument de la conquête. Les deux se rejoignent pour considérer que les Européens, qui auraient renoncé à la richesse, ne méritent plus d’être les chefs de file de l’Occident.
Nicole Gnesotto :
On est souvent accablés par la réaction de l’Europe — ou son absence de réaction — face à Trump. Je parlais tout à l’heure de cet accord commercial indigne, qui taxe à 15% les biens industriels exportés vers les États-Unis sans aucune réciprocité pour ceux qui arrivent en Europe. On a souvent l’impression que les Européens ne sont pas au niveau, qu’ils méritent presque le Trump qu’ils ont en face d’eux. Je voudrais pourtant plaider un peu l’indulgence, même si j’en viendrai ensuite à l’exigence. Il faut être indulgent envers des Européens qui vivent depuis trois ans deux révolutions phénoménales pour lesquelles ils n’étaient absolument pas préparés : une révolution stratégique, avec la guerre en Ukraine, et une révolution politique, avec l’autoritarisme trumpien.
Revenons au tout début de la construction européenne. Pendant huit décennies, les Européens ont appliqué les trois principes que Schuman, Monnet et les Américains leur avaient donnés entre 1950 et 1955, entre la CECA et les traités de Rome. Premier principe : plus de guerre, plus de géopolitique. « Vous nous avez fait deux guerres mondiales, vous n’y touchez plus. » Deuxième principe : faites du commerce, c’est non dangereux, ça enrichit, ça stabilise. Troisième principe : faites confiance aux États-Unis, l’Amérique vous défendra, puisque vous n’en avez pas le droit. Et nous avons vécu pendant presque un siècle sur ces trois instructions : pas de géopolitique, du commerce, une confiance inébranlable dans l’Amérique.
Or, en trois ans, les Européens doivent faire exactement l’inverse de ce qu’on leur avait prescrit — ou, si l’on préfère, ce qui leur était interdit depuis près d’un siècle. Il faut faire de la géopolitique, penser la défense, penser le monde, s’armer contre les Russes, armer l’Ukraine, et peut-être un jour aller en Ukraine pour protéger un accord de paix. Et il faut le faire très vite, avec énormément d’argent. Par ailleurs, il faut aussi se méfier du commerce, car ce n’est pas évident qu’il enrichisse : la croissance prévue pour l’an prochain dans l’Union est inférieure à 1%. Et on a bien vu que le commerce ne pacifie pas : Poutine a attaqué l’Ukraine alors que ce n’était pas son intérêt économique. Enfin, troisième renversement : il faut se méfier de l’Amérique. L’article 5 n’est pas automatique — Trump l’a dit, et il a raison en droit. Et l’Amérique est devenue le principal soutien des mouvements fascistes en Europe. Les Européens doivent donc penser leur défense contre la Russie et la défense de leur démocratie contre l’autoritarisme russe … avec une alliance dont le chef est hostile à la démocratie européenne. Cela fait beaucoup à la fois. D’où mon indulgence.
Mais il faut aussi être exigeant. On comprend qu’en trois ans, les Européens aient du mal à revoir complètement leur vision du monde. Pourtant, ils doivent le faire. L’un des défauts majeurs de l’Union européenne, c’est de ne pas vouloir voir. Dans mon livre, j’ai un chapitre intitulé « Ces signes que nous n’avons pas voulu voir ». Eh bien, il y en a encore. On ne veut pas voir l’Amérique telle qu’elle est. On se ment à soi-même. Beaucoup d’Européens pensent encore que Trump est une anomalie historique, qu’il perdra des élections dès 2026, et qu’après, on reviendra à une Amérique « normale », plus consciente de ses intérêts en Europe, et qu’il suffit de faire le gros dos un an de plus. Je suis convaincue que c’est une illusion totale. Les racines du vote trumpien sont trop profondes pour disparaître avec Trump, et dureront au-delà de lui — surtout si c’est J.D. Vance qui lui succède.
Les Européens doivent cesser de se mentir sur le caractère européen de l’Amérique. Mais ils n’y arrivent pas, notamment parce qu’ils ont à la tête de la Commission quelqu’un d’imprégné d’atlantisme. Mme von der Leyen, malgré tout ce qu’elle fait pour la défense, est incapable de voir que l’Amérique est devenue un adversaire.
Philippe Meyer :
J’aurais quelques réactions et objections à ce que vous venez de dire. Vous avez raison d’utiliser le mot fascisme tout en soulignant à quel point il pose problème. Le fascisme renvoie trop à un moment historique précis, à son évolution vers le nazisme, puis aux politiques d’anéantissement et de génocide. Il est difficile de l’appliquer tel quel à ce qui se passe aujourd’hui. Il faut donc trouver autre chose. Une idée me vient, sans être certain qu’elle se répande facilement : reprendre l’image du Rhinocéros d’Ionesco. Un « parti rhinocéros ». Mais je ne suis pas sûr que Ionesco soit assez connu ...
Autre point : les Américains disent que nous, Européens, nous nous sommes comportés comme des profiteurs sur le plan militaire. C’est vrai, sauf pour la France. Nous avons conservé une armée, une capacité nucléaire, une industrie de défense et une géopolitique. Nous l’avons eue très fortement sous le général de Gaulle, et encore assez nettement sous plusieurs de ses successeurs, y compris François Mitterrand. Et du temps de Jacques Chirac, lorsque la France a refusé de s’associer à l’intervention en Irak — contrairement au Royaume-Uni — nous avons montré du caractère. Cela ne nous met pas complètement à l’abri, mais tout de même. Nous avons même eu l’audace de fabriquer notre propre avion de combat, plutôt que de faire comme tant d’autres en achetant des appareils américains, ce qui revient à confier une partie de sa défense aux États-Unis. J’aimerais maintenant, avant de vous laisser la parole, Richard, que nous revenions un instant sur l’idée, Nicole, d’une « petite Europe ». L’idée qu’on pourrait réduire les effectifs, se débarrasser des pays « rhinocéros » pour reprendre l’image, et repartir autour d’un noyau plus cohérent. Une Europe recentrée, qui pourrait peut-être même se faire sans Mme von der Leyen et se doter d’une vision plus claire, plus active. C’est une question qui a été évoquée récemment, peut-être pas au Parlement européen dans la forme que vous lui donnez, mais elle est bien là.
Richard Werly :
J’essaie de passer en revue plusieurs points, à la lumière de ce voyage américain et de ce qu’il m’a appris. D’abord, les Européens, au sens des dirigeants et des gouvernements, méritent-ils notre indulgence ? Sans doute, puisque l’Union européenne actuelle est le produit de son histoire et qu’elle a répondu aux injonctions du passé. Mais, à mes yeux, il existe deux domaines où l’indulgence n’est plus possible, et où ce qui se passe aux États-Unis — ou ce que ces Américains-là nous reprochent — devrait nous ouvrir les yeux. Premier point : on ne construit pas la liberté avec une bureaucratie.
Il existe chez ces Américains une volonté de détruire l’État fédéral, certes pour s’emparer de richesses, mais aussi parce qu’ils considèrent que la bureaucratie bride les libertés. Et beaucoup d’Européens ressentent aujourd’hui la même chose : entrepreneurs, citoyens, tous perçoivent l’Union européenne comme un système qui entrave. Là, on ne peut pas être indulgent. On ne peut pas continuer à croire qu’on produira du libéralisme et de la démocratie avec une bureaucratie hypertrophiée. À un moment donné — et je crois que nous y sommes — les deux deviennent incompatibles.
Deuxième point : le renouvellement des élites. Les élites américaines, politiques notamment, se sont renouvelées — de manière inquiétante parfois, mais elles se sont renouvelées. Les élites européennes, en particulier celles des institutions, très peu. Quand j’entends certains responsables européens continuer de défendre un libre-échange intégral, continuer de jurer que Trump va échouer économiquement, alors que les chiffres ne leur donnent pour l’instant pas raison et que Trump attire des centaines de milliards d’investissements, je me dis : ces gens feraient mieux de se taire. J’ai écrit récemment une chronique où je disais que, sur la question européenne, les boomers devraient arrêter de parler : les jeunes générations ne veulent plus de l’Europe des boomers. Il y a clairement un problème générationnel. Ce qui se passe aux États-Unis montre qu’il faut accepter ce passage de relais. Le discours européen doit changer de génération, quitte à être réinventé. Sur ce point, je ne partage donc pas l’indulgence de Nicole.
Pour ce qui est de la France, Philippe, vous avez raison : la France a eu du caractère. Et ce n’est pas vers la France que se dirige le ressentiment de cette Amérique-là. Sans doute parce qu’ils la connaissent mal, mais aussi parce que la France a toujours joué le rapport de force — avec des moyens parfois baroques, insuffisants, mais un rapport de force tout de même. Dans ce monde dominé par cette Amérique-là, il faut du caractère. Sans cela, on ne tient pas. Mais avons-nous encore les moyens financiers de ce caractère ? La dissuasion, la défense, tout cela coûte extrêmement cher. Peut-on encore tenir ce rang ? Autre question — centrale : a-t-on tort quand ces Américains pensent que nous avons renoncé au progrès ? Je crois qu’ils n’ont pas tort. Écoutons-les. Les milliardaires de la tech — et beaucoup n’étaient pas trumpistes au départ — le sont devenus par intérêt. Jeff Bezos, Tim Cook, beaucoup d’autres : ce sont des trumpistes circonstanciels. Comme certains patrons suisses qui viennent à la Maison-Blanche avec une pendule Rolex et un lingot d’or pour négocier les tarifs douaniers … Mais le fait est que les sociétés ont besoin d’un élan : technologique, scientifique, numérique. Avons-nous aujourd’hui cet élan en Europe ? Ces grands projets ? Cette capacité d’imaginer un horizon ? On peut juger les milliardaires de la tech comme on veut, mais eux ont une ambition. Et j’ai rencontré au Texas des Américains ordinaires persuadés que dans vingt ou trente ans, il y aura des hommes sur Mars. Ils y croient, et ils en sont fiers. De quoi pouvons-nous être fiers, nous, Européens, aujourd’hui ?
Nicole Gnesotto :
Mais d’abord, il y a aussi 10 % d’Américains qui pensent que la Terre est plate. Donc relativisons … Sur la France, je crois que les Américains nous respectent et nous détestent à la fois. Ils nous respectent parce que nous leur avons tenu tête quatre fois : De Gaulle en 1945, De Gaulle encore sur le nucléaire avec l’échec de la MLF (le projet de force nucléaire multilatérale), De Gaulle sur le tiers-monde, et enfin la France en 2003 sur l’Irak. Ils nous respectent pour cela. Mais ils nous détestent aussi parce que cette France indépendante est en même temps le pays européen qui cherche à avoir le plus d’influence. Les deux se combinent pour donner une image finalement négative de la France aux États-Unis.
Sur le libéralisme et la bureaucratie : Richard touche un point essentiel, qui va devenir l’un des grands débats de nos démocraties. Quel est le bon degré ? Quelle est l’articulation optimale entre la nécessité du contrôle et la nécessité de la liberté ? C’est une question centrale pour l’avenir de nos économies, de nos démocraties et du système international. On ne peut être ni totalement libertarien — parce qu’alors rien ne fonctionne — ni totalement autoritaire — parce qu’alors tout est contraint. C’est l’un des enjeux majeurs de l’avenir, bien au-delà de la seule géopolitique.
Enfin, sur l’Europe et ses noyaux durs. Je crois en effet qu’il faut introduire de la flexibilité dans la pureté institutionnelle traditionnelle de l’Union. La réalité nous y oblige déjà. Exemple : les Britanniques, à cause de la guerre en Ukraine, réintègrent progressivement nos discussions sur la Défense — ce qui est du simple bon sens. Moi qui étais ravie du Brexit, je ne suis évidemment pas en train de dire qu’il ne faut pas les associer à notre politique de Défense. Il faut un réalisme nouveau. Autre exemple : la Pologne. C’est désormais un pays stratégique majeur, pays du front, grand pays, encore démocratique malgré des élections chaotiques. Il faut donc penser au-delà du couple franco-allemand. C’est pour cela que je crois à une Europe des cinq « grands » (même si c’est un blasphème que de qualifier certains pays de « grands » et d’autres de « petits ») pour le leadership : France, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne. Nous sommes dans une situation où aucun pays ne peut revendiquer seul le leadership — surtout pas la France, qui traverse une période lamentable. Le seul pays qui pourrait prétendre à un rôle de leader, c’est l’Italie de Mme Meloni, qui a une vraie politique européenne, respectable, même si sa politique intérieure ne l’est pas. Le leadership ne peut donc être que collectif. D’où l’intérêt de ces cinq grands.
Mais ces cinq-là ont une responsabilité historique : sauver ce qui peut l’être et réformer ce qui doit l’être. Je me réjouis, par exemple, du débat en France sur la taxe Zucman. Cela n’a peut-être rien à voir directement avec notre sujet, mais c’est le signe qu’on commence enfin à admettre qu’on ne peut pas continuer comme avant — ni en économie, ni en redistribution sociale. Et ce débat doit avoir lieu aussi entre les cinq. Je rêverais que ces cinq chefs d’État se réunissent pour commencer ce travail.
Dans la mesure où l’on va s’élargir — et c’est pratiquement inévitable, à une trentaine de pays dans les années qui viennent, peut-être même dans les deux ou trois ans — je pense que l’élargissement doit être l’occasion d’un rétrécissement.
Richard Werly :
Ma conclusion, c’est que cette Amérique qui nous déteste existe, qu’elle perdurera, et qu’il faut la regarder en face. Mais il faut aussi être capable d’entendre le cri qu’elle lance. Car ce cri, pas mal d’Européens le partagent. On pourrait même dire qu’il existe aussi une Europe qui se déteste. Le pire serait donc une coalition objective entre cette Amérique qui nous déteste et cette Europe qui se déteste. Si les deux venaient à s’allier, alors tout ce que nous avons construit depuis la Seconde Guerre mondiale — et je pense notamment à l’Union européenne — serait réellement en péril.
Philippe Meyer :
Il y a aussi, me semble-t-il, en Amérique, une autre Amérique : celle qui ne se reconnaît pas du tout dans Trump. Elle commence à se manifester, mais nous aurions tort de l’entendre trop fort et de croire qu’elle aura la puissance nécessaire pour renverser Donald Trump lors des prochaines élections, celles de mi-mandat. Il y a d’ailleurs chez certains Européens une attitude curieuse : s’en remettre à l’Amérique… pour nous débarrasser de l’Amérique.
Richard Werly :
Je suis sûr qu’on aura l’occasion, dans Le Nouvel Esprit Public, de refaire des émissions sur les États-Unis. Et vous avez raison, Philippe : il y a aussi une Amérique qui nous aime. Mais cette Amérique-là, aujourd’hui, a peur.
Nicole Gnesotto :
Et puis je ne suis pas si sûre que les élections de mi-mandat 2026 auront lieu. Trump, de même qu’il a laissé entendre qu’un troisième mandat serait possible, peut très bien tenter de trouver un moyen d’éviter les élections de l’an prochain. Je sais que cela paraît aberrant à dire, mais la force l’emporte tellement sur le droit aux États-Unis que ce pourrait aussi être une option pour lui.