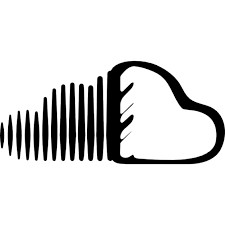LE GRAND VIDE DES PARTIS POLITIQUES
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Le système institutionnel français, organisé pour structurer une alternance entre deux blocs, fonctionne désormais avec trois forces irréconciliables. Résultat : aucune majorité stable, aucun mandat clair et la porte ouverte à la démagogie puisque personne n'est responsable. Tandis que le Parlement s'enlise, l'exécutif temporise, l'opinion se lasse. Cette résignation est liée à une fatigue démocratique, sur fond de décomposition politique, dont l’Assemblée nationale fragmentée est le reflet. Fin décembre, le Cevipof et l’Obsoco (Observatoire société et consommation) ont publié les résultats d’une enquête réalisée par l’Ifop : « Priorités françaises ». Les Français ne placent plus en tête de leurs priorités le pouvoir d’achat ou l’inflation mais le fonctionnement du système politique. L’enquête montre une délégitimation personnelle du chef de l’État, une remise en cause institutionnelle et un rejet de la classe politique. Les Français ont des mots très durs et parlent des responsables politiques comme d’une « caste » dénoncée notamment pour sa « surdité ». La mobilisation agricole fait écho à ce désarroi de l’opinion face à un pouvoir qu’elle juge « autoritaire ». Selon un sondage Ipsos/Cevipof, 34% des Français pensent que « d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie ».
Au très fort degré de défiance dont souffrent aujourd’hui l’exécutif et le Parlement s’ajoute la difficulté qu’éprouvent les partis de gouvernement à apporter une réponse crédible aux bouleversements en cours : déclin démographique, réchauffement climatique, extrême vulnérabilité du continent européen face au retour des tensions militaires et commerciales, révolution de l’intelligence artificielle. La politique se limite de plus en plus à la gestion, la France paraît privée de récits fédérateurs, observe le politologue Brice Soccol qui rappelle que pendant des décennies, la vie politique française s’est structurée autour de visions du monde fortes : le progrès, la révolution, la nation, l’État-providence, la lutte des classes, la justice sociale … Aujourd’hui, ni la gauche de gouvernement ni la droite classique ne racontent plus d’histoire. Elles administrent, ajustent, corrigent. Leur horizon s’est rétréci au calendrier budgétaire et parlementaire amplifié par la dissolution ratée de 2024. Engluées dans leurs divisions internes et leurs obsessions du casting présidentiel, les forces politiques ne parviennent pas à structurer le débat public avec de nouvelles idées, à dessiner des raisons d’espérer. Si mercredi, le président des Républicains, Bruno Retailleau a présenté des mesures économiques pour encourager le travail, elles ont un air de déjà-vu. Dans la perspective des Présidentielles de 2027, alors que les partis protestataires – le Rassemblement national et La France Insoumise sont quasiment en ordre de marche, le grand flou règne du côté des partis de gouvernement, tant sur le candidat, les programmes que sur le mode de désignation. Un grand flou sur un grand vide.
Kontildondit ?
Antoine Foucher :
La question de fond peut se formuler ainsi : comment se fait-il que le pays traverse un très mauvais moment historique, que les gens en aient conscience, et que, malgré cela, nul ne voie de solution pour en sortir ? Une enquête Ipsos de novembre dernier indique que 90 % des Français considèrent que la France est en déclin et que 72 % pensent que leurs enfants vivront moins bien qu’eux. Face à cette conscience collective d’un mauvais moment historique, domine le sentiment que, dans aucune partie du spectre politique, on ne voit apparaître aucune perspective permettant d’apercevoir la fin du tunnel.
Je mettrais trois hypothèses sur la table. La première est sociologique : les partis n’attirent plus les talents. L’impuissance du politique, comparée au monde privé où, pour le même niveau de qualification, d’engagement et d’intensité de travail, on est deux à trois fois mieux rémunéré, détourne beaucoup de gens de la politique. Ils préfèrent faire carrière dans le privé ou contribuer à l’intérêt général par des actions privées, dans les entreprises ou les associations. Les partis fonctionnent désormais comme une anti-sélection : ils n’attirent plus ceux qui ont la volonté de changer les choses, l’aspiration à transformer le réel et les talents nécessaires pour y parvenir. D’où un cercle vicieux : l’impuissance politique détourne les talents, ce qui rend la politique encore plus impuissante.
On arriverait ainsi à une situation où il faudrait renverser la maxime d’Edgar Faure, qui disait que « la politique, ce sont des cons qui élisent des salauds ». Peut-être sommes-nous aujourd’hui dans la situation inverse, où « ce sont des salauds qui élisent des cons ». Si cette hypothèse touche quelque chose de vrai, il faut passer au second point de l’équation : les salauds, c’est nous : les citoyens. D’où une explication plus politique : si les partis sont si impuissants, la responsabilité première est peut-être dans la société. Nous sommes devenus une société d’individus, et dans une société d’individus, tout ce qui est collectif — c’est-à-dire ce qui s’impose à la liberté, aux droits et aux acquis — est rejeté comme illégitime. Dans cette deuxième explication, les responsables politiques ne sont ni bêtes ni déconnectés. Ils savent simplement que les gens ne sont pas prêts à faire des efforts pour l’intérêt général. Le dernier numéro d e la revue Le 1 pose cette question. Les responsables politiques s’adaptent, et en s’adaptant, ils ne proposent pas ce qu’ils savent être électoralement suicidaire. Deux exemples : nous devons faire un effort historique sur la défense, nous avons besoin d’argent, nous avons de l’épargne, on pourrait faire un emprunt forcé — très risqué électoralement. Autre exemple : nous avons la même qualification et la même productivité que nos voisins européens, mais nous travaillons trois ans de moins ; si nous voulons cesser de nous appauvrir par rapport aux autres pays, il faudra travailler trois ans de plus ; là encore, bon courage électoralement. Dans cette perspective, le problème serait plutôt chez nous, dans la société civile : le vide programmatique des partis ne serait que le reflet du vide civique des Français.
J’en viens à ma troisième hypothèse, complémentaire des deux premières, plus historique. Élites, partis politiques et citoyens seraient dans le même sac, issus de la même histoire : la Révolution française. Nous, Français, avons tellement attendu de la politique qu’au bout de deux siècles d’échec de la promesse révolutionnaire, nous ne pouvons qu’être déçus. Nous avons absolutisé la politique ; nous avons cru qu’elle pouvait tout changer. Cette croyance ne s’est éteinte que récemment, et chaque année qui passe continue à éteindre l’idée que la politique peut changer la vie. Non, la politique ne changera jamais la vie ; elle peut l’améliorer un peu, mais pas davantage. Ce sentiment de vide est d’autant plus fort que nous avons beaucoup attendu : pendant deux siècles, nous avons pensé que la politique pouvait tout, et maintenant nous pensons qu’elle ne peut rien. Peut-être sommes-nous dans une phase de rémission ou de transition, propre à la France, liée à la spécificité de la Révolution française, différente des révolutions américaine, anglaise, néerlandaise ou de l’histoire politique des autres pays d’Europe. Nous avons mis deux siècles à nous dégriser de cette croyance dans la toute-puissance politique. Nous en sortons. Nous sommes au creux de la vague parce que tous les tunnels possibles sont gris : ils nous laisseraient dans la même vie, avec le même sentiment de devoir travailler davantage et que la vie est plus difficile au XXIᵉ siècle. Il nous faudra encore quelques mois ou quelques années pour accepter que la politique ne mérite ni l’excès d’honneur qu’elle a reçu pendant deux siècles, ni l’indignité dans laquelle nous l’avons tenue depuis vingt ans.
Lucile Schmid :
Je voulais rappeler comment la Constitution de la Ve République parle des partis politiques. Que dit son article 4 ? Que « les partis concourent à l’expression du suffrage, qu’ils se forment librement, qu’ils doivent respecter la souveraineté nationale et l’exercice démocratique. » Autrement dit, la Constitution leur donne un rôle assez limité : celui d’être une machine à gagner les élections et à organiser la vie électorale. Dans la Vème République, les partis ont toujours été relégués à une place réduite par rapport au président de la République et à la diarchie exécutive. Pour reprendre Max Weber, ils étaient là pour permettre à leur chef d’arriver au pouvoir. Progressivement, leur rôle s’est accru, mais il n’était pas prévu qu’un parti, s’il voulait conquérir le pouvoir, devait porter un projet de société. On en est venu à associer la conquête du pouvoir et l’incarnation du pouvoir à un projet de société.
Ce fut le cas lors de l’alternance. En 1981, la gauche, pour accéder au pouvoir, devait montrer qu’elle pouvait exercer des responsabilités et porter un projet de société. L’alternance a permis d’en mettre un en place. Nicolas Sarkozy, lorsqu’il gagne en 2007, le fait aussi à côté de son parti et confie à Emmanuelle Mignon le soin de porter un projet de disruption, où il va sur les terres de la gauche et pratique la triangulation.
On voit donc que, depuis longtemps, les partis politiques en France ne portent plus eux-mêmes le projet intellectuel. Ce sont les grandes élections présidentielles, et donc les candidats, qui en prennent la charge. Ce fut aussi le cas avec François Hollande. Ayant co-dirigé le laboratoire des idées du Parti Socialiste et fondé la fondation de l’écologie politique des Verts, je peux dire que l’usage du projet comme prétexte n’est pas nouveau et que les partis sous-estiment l’importance des experts. Ils ont un rôle fondamental lorsque l’échéance est lointaine, mais lorsque l’échéance se rapproche, ce qui reprend ses droits, ce sont les personnes, la désignation, et le fait que ce sont finalement les candidats qui élaborent leur programme.
Comme le disait Antoine, cela crée un profond malaise. Aujourd’hui, le monde est instable, la société ne sait plus où elle va, et ce que l’on a à promettre, c’est du sang et des larmes. Le projet présenté par Bruno Retailleau pour Les Républicains repose sur de très vieilles recettes : rompre avec les 35 heures (ce que l’on entend depuis 2002) ; réduire l’assistanat social (ce que l’on dit aussi depuis longtemps), et braconner sur les terres du Rassemblement National. Le paradoxe, c’est que lorsque l’on parle de projets de société, les deux formations qui apparaissent comme porteuses sont les deux partis protestataires. LFI n’est d’ailleurs pas un parti, mais un mouvement qui revendique 370.000 adhérents et sympathisants ; ce n’est que mouvement gazeux.
Nous sommes donc dans une situation où ceux qui veulent arriver au pouvoir ont eux-mêmes privé les partis de la possibilité de porter un projet. Deux paradoxes apparaissent. D’abord, si l’on vous interroge dans la rue sur les idées des partis politiques, vous saurez citer les trois idées du Rassemblement National ( « la France s’en sortira si elle exclut les étrangers »). Vous saurez citer les trois idées de Mélenchon : (« la France s’en sortira si elle sort de l’Europe »). En revanche, vous ne saurez pas citer trois idées du Parti Socialiste, ni des Républicains, ni du parti présidentiel.
Ensuite, il y a un grand vide des partis raisonnables, ceux qui veulent exercer le pouvoir. Et second paradoxe : pourquoi a-t-on tant attendu des partis depuis une dizaine d’années ? Parce que nous avions élu un président intellectuel, porteur d’une vision, qui nous avait promis de changer les choses. Et l’on se retrouve quasiment dix ans après avec le sentiment qu’il faudrait se reposer sur des partis politiques qui ne sont plus que des coquilles vides, alors même que ce président intellectuel, porteur d’un projet, a finalement effectué un cercle autour de lui-même pour nous ramener à un système encore plus ancien que celui qu’il prétendait dépasser en arrivant au pouvoir.
David Djaïz :
Le propos terminal de Lucile est une démonstration éclatante que les intellectuels ne sont pas forcément les mieux placés pour faire de la bonne politique. Cela fait vingt ans que je m’intéresse à la vie politique et vingt ans que j’entends dire que les partis ne sont pas un lieu de production intellectuelle. Si j’avais été plus vieux, j’aurais sans doute entendu ce refrain depuis trente, quarante ou cinquante ans. Ma thèse est que les partis politiques ne sont pas structurellement, en France, un lieu de production intellectuelle. Il n’y a jamais eu de parti de masse au sens de la science politique, à l’exception peut-être du Parti communiste dans les années 1950-1970.
Si l’on compare la France aux pays sociaux-démocrates, notamment en Europe du Nord, on constate l’absence de connexion avec le monde du travail, qui est aussi un lieu d’élaboration d’idées, en particulier sur l’entreprise et la vie économique. Au Danemark, le personnel politique des grands partis sociaux-démocrates se recrute dans les syndicats : d’anciens leaders syndicaux qui connaissent l’entreprise. Ce n’est pas le cas en France, car les syndicats sont historiquement moins réformistes, ce qui renvoie à notre histoire du XXᵉ siècle.
Autre explication : la puissance et la centralité de l’État. On n’a pas attendu la Vème République pour cela. Il existe une classe politique et technocratique relativement autonome des partis. Les programmes des présidents évoqués par Lucile ont souvent été élaborés par des hauts fonctionnaires, présents dans les écuries de campagne, de droite comme de gauche. En général, ce sont de jeunes énarques de 25 ou 30 ans, qui s’ennuient dans leurs administrations et comptent sur l’accélération qu’apporte une campagne présidentielle pour accéder ensuite aux cabinets ministériels.
Je voudrais donc déplacer un peu la question. Le sujet n’est pas tant de réveiller des astres morts que de se demander s’il existe encore un désir de politique. À cette question, je répondrais oui : les Français parlent tout le temps de politique, et les enquêtes montrent combien la politique leur pose problème, au sens de la vie de la cité et de la résolution des problèmes collectifs. La question qui suit est : comment construire une politisation effective et durable ? La politisation, cela n’a pas beaucoup changé depuis Aristote : c’est la capacité à traduire en paroles des émotions confusément éprouvées sur la vie de la cité, puis à utiliser ces paroles, rationnelles et organisées, pour susciter de l’action collective, des transformations et ce que nous appellerions des politiques publiques. La question devient donc : quel est le site d’expression de ce projet politique aujourd’hui ?
Je crois qu’il y a un mouvement mondial : la politique, aujourd’hui, c’est d’abord la capacité de groupes sociaux ou de personnalités à traduire dans le monde digital des sentiments confusément ressentis par une majorité ou par des groupes sociaux, et à générer de l’engagement. La communication digitale a acquis une centralité planétaire, de Madagascar au Népal, de la Roumanie à New York, en démocratie comme en autocratie. La question n’est donc pas de savoir si l’on peut réinsuffler de l’engagement au sein de coquilles vides que sont les partis, mais de savoir comment des personnalités démocrates, qui veulent changer les choses, peuvent mobiliser des ressources narratives et digitales pour créer de l’engagement. Ce qui m’inquiète, c’est que les algorithmes favorisent aujourd’hui les émotions négatives. Une étude récente de Yann Algan le montre : la colère représente 50 % des messages politiques, la peur 25 %, et les émotions positives — espoir, enthousiasme — à peine 10 %.
Le défi est donc de parvenir à mettre en forme des messages positifs. Je pense que, dans les années à venir, les dirigeants politiques seront essentiellement des clowns ou des entrepreneurs, Trump ayant réussi l’exploit d’être les deux, Zelensky étant plutôt un ancien clown devenu homme d’État. Je ne dis pas cela pour condamner cette évolution, mais pour dire qu’il faut la comprendre : c’est ainsi que l’on créera demain des passions politiques et du changement. Sinon, nous serons condamnés à avoir, d’un côté, des partis populistes d’extrême droite ou d’extrême gauche, qui jouent très bien avec la colère et la peur et orchestrent cette mobilisation digitale, et au milieu, une sorte de grand espace central fade, gestionnaire, accompagnant un lent déclin ennuyeux et voué à s’éroder.
Jean-Louis Bourlanges :
Ce que je ressens aujourd’hui, et qui marque une évolution dans ma manière de voir les choses, c’est que notre société politique est partagée entre deux tentations très différentes, dont l’issue sera déterminante : d’un côté, la tendance à l’atomisation et à la fragmentation ; de l’autre, la tendance à la confrontation manichéenne. Et j’ai le sentiment que nous glissons de la première vers la seconde, ce qui n’a rien de rassurant.
L’atomisation a été bien décrite : elle tient à l’effondrement des structures collectives et à l’individualisme. Je suis d’ailleurs moins sévère sur le passé : on dit que les partis politiques n’ont jamais été brillants en France, c’est vrai, mais il y avait des forces idéologiques extrêmement puissantes de rassemblement et de synthèse. Il y en avait trois : la sacristie, la cellule et la loge. L’importance de la franc-maçonnerie dans la construction de la République est indiscutable ; le rôle central de l’Église catholique, qui a fini par accepter le libéralisme, a structuré une partie de la droite française ; et le Parti communiste a été dominant à mesure que la France entrait dans la société industrielle. Ces trois forces sont aujourd’hui en crise profonde. La crise de l’éducation en dit long sur la première ; la marginalisation de la classe ouvrière, divisée entre immigrés et non-immigrés, affecte la seconde ; et les catholiques sont désormais largement déconfessionnalisés.
Nous avons donc une société d’individus. L’individualisme produit ces phénomènes de peur, de panique, d’angoisse et de tentation du bouc émissaire. Cette atomisation conduit aussi au refus de la synthèse. Brice Soccol a raison de dire qu’il existe de la politique à la base : des associations se forment, des valeurs se défendent. Mais au sommet, il n’y a plus de synthèse. Or la politique, les partis, la présidence, c’est précisément la synthèse. Sous la Vème République, elle a été assumée par le président. Ce n’est pas un hasard si la fonction présidentielle est aujourd’hui rejetée comme jupitérienne et abusive, indépendamment des qualités ou des défauts du titulaire. On aurait pu imaginer une synthèse parlementaire à la manière d’un pacte à la Mendès France au sein du Parlement ; Sébastien Lecornu a tenté un moment quelque chose de cet ordre, mais cela a été rejeté, notamment par les socialistes, au profit d’un travail amendement par amendement : refus du contrat global.
Cela nourrit une rage contre la classe politique, qui ne produit pas. Pourquoi ? Parce que la population ne lui demande rien de précis. Elle est travaillée par une négativité profonde et émet des injonctions contradictoires auxquelles la classe politique ne peut répondre. Oscar Wilde, dans Dorian Gray, parle de la rage de Caliban qui, alternativement, reconnaît ou ne reconnaît pas son image dans le miroir. Les Français ne reconnaissent pas leur image dans leur classe politique. D’où une idéologie du veto, de l’opposition et de la négativité.
À l’inverse, la confrontation. Depuis l’émergence de Trump aux États-Unis, s’affirme une contre-politique, une contre-culture puissante, qui nie l’héritage libéral, social et européen issu de la Libération. Ce phénomène n’est pas seulement français : on le voit en Angleterre, en Allemagne, et d’une façon plus subtile en Italie ; c’est évidemment visible aux États-Unis. Il y a un rejet majoritaire des valeurs qui ont été les nôtres si l’on additionne extrême-droite et extrême-gauche. Face à cela, comment réagissent les responsables politiques ? Dans le bloc central, deux réponses. La réponse Bayrou, bien ou mal formulée : défendre notre héritage, convaincre les Français, assumer des choix essentiels. Résultat : échec complet et censure massive par l’Assemblée. La réponse Lecornu : ne rien dire, ne rien faire, vivre caché, puisque l’on est minoritaire. C’est la République des amendements au lieu de la République des projets de loi.
À côté de cela, deux partis — le Parti socialiste et Les Républicains — hésitent profondément. Pour les premiers : tentation populiste via LFI, qui représente une sorte de trumpisme poutinien inversé. Pour les seconds : tentations du côté du RN. Nous sommes dans une situation d’extrême difficulté. Le camp de la confrontation prospère parce qu’il s’appuie sur la contestation et sur l’atomisation du pays.
L’offre de ces formations repose sur la soumission au parti de l’étranger : soumission à Trump et à Poutine. L’ambassadeur des États-Unis a reçu en grande pompe M. Bardella et Mme Le Pen alors même que Trump menace en permanence les choix européens. Même chose pour la Russie. En outre, c’est un parti de la nostalgie : il veut que l’avenir de la France corresponde à son passé. C’est un choix tragique, qui ne peut mener à rien. Oui, je suis profondément inquiet.
OÙ VA LA « DOCTRINE DONROE » ?
Introduction
Philippe Meyer :
Avec l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro, à l’aube du 3 janvier, Donald Trump entend désormais régir l'ensemble du continent américain et avoir la main sur l'« hémisphère occidental », mis au service de la prospérité et de la sécurité des États-Unis. Des élections au Vénézuéla ne semblent à ce stade pas à l'ordre du jour : « nous attachons de l'importance à la démocratie. Mais ce qui nous importe avant tout, c'est la sécurité, le bien-être et la prospérité des États-Unis », a précisé le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les États-Unis réactivent ainsi la doctrine Monroe de 1823 selon laquelle l'hémisphère occidental devait être la chasse gardée exclusive de Washington. La Stratégie nationale de sécurité des États-Unis publiée en novembre dernier se réfère explicitement à ce précédent, tandis que la presse américaine l'a déjà baptisée « doctrine Donroe », condensé de Donald et Monroe. Les autres pays de la région, qu’ils soient amis comme le Mexique ou ennemis comme Cuba, ont été mis en garde : ils devront coopérer avec les Etats-Unis ou en subir les conséquences. Les gouvernements latino-américains de gauche, comme celui du Brésil, se sont déclarés particulièrement alarmés par la violation de la Charte des Nations unies. Ceux de droite, comme celui d’Argentine se sont montrés plus favorables. Ceux d’autres régions du monde, notamment en Europe, ont plaidé en faveur de la stabilité.
Sur la « liste des envies » de Trump figurent également le Canada, le canal de Panama, et le Groenland. Dès le lendemain de l’enlèvement du président vénézuélien, Donald Trump est revenu sur l'idée d'annexer le Groenland, jugeant qu'il « nous le faut absolument, pour des raisons de sécurité nationale ». Cette sortie a déclenché de nombreuses protestations des Européens. La Première ministre danoise en a été réduite à invoquer l'article 5 de l'Otan pour protéger le royaume contre … le leader de l'Otan. Les Européens semblent pris au dépourvu par l'accélération des événements. La doctrine Donroe marque le retour explicite d’un monde où l’appartenance à une sphère d’influence l’emporte sur la souveraineté. Une sphère d’influence américaine extensible bien au-delà du continent américain : en mars 2025 Donald Trump avait ordonné une campagne de frappes contre les rebelles Houthi au Yémen, en juin contre les installations nucléaires iraniennes et en décembre au Nigéria et en Syrie contre des militants du groupe Etat islamique. Le président américain menace de nouveau d'intervenir en Iran si la répression des manifestations se poursuit. Il confiait vendredi au New York Times, « je n’ai pas besoin du droit international » assurant que sa « moralité » constitue son unique limite pour agir dans le monde.
Kontildondit ?
David Djaïz :
Si l’on regarde l’opération au Venezuela, il n’y a pas de rupture majeure avec ce que les États-Unis pratiquent depuis une cinquantaine d’années dans ce qu’on appelait leur arrière-cour. La doctrine Monroe, qui date de 1823, repose sur l’idée que les États-Unis sont les régents de l’hémisphère occidental et qu’ils ont la responsabilité politique, géopolitique, morale et messianique d’y assurer la police. Ce qui n’était pas simple pour Donald Trump, c’était d’unir les différentes composantes de la nébuleuse MAGA qui le soutient. On sait qu’il y en a au moins quatre : une composante historique, nationale-populiste, « le peuple contre les élites », incarnée par des figures comme Steve Bannon, qui a joué un rôle central dans la victoire de 2016 ; une nouvelle composante, autour de J. D. Vance, que j’appellerais volontiers néo-réactionnaire ; une composante post-libérale, souvent sous-estimée par les commentateurs européens, composée essentiellement de religieux et d’évangéliques ; et enfin les débris de l’appareil républicain traditionnel, incarnés notamment par Marco Rubio.
Ce qui unit ces groupes, c’est qu’ils considèrent l’opération au Venezuela comme légitime, car il ne s’agit pas d’une intervention militaire étrangère, mais d’une opération de gendarmerie internationale. Nicolas Maduro a été exfiltré par des officiers du Drug Enforcement Act, sous couvert de l’armée américaine, puis immédiatement judiciarisé à New York. C’est une constante de l’action américaine en Amérique du Sud. Ceux qui s’indignent en parlant de rupture de doctrine sont hypocrites, ou stupides, voire les deux.
La différence avec les opérations téléguidées par Nixon et Kissinger dans les années 1970 — on pense à l’assassinat d’Allende et au coup d’État au Chili —, c’est que Trump agit à visage découvert. Rien n’est secret. Comme l’a rappelé Philippe, tout est décrit dans la stratégie nationale de sécurité. L’administration Trump 2 a ce mérite : elle dit ce qu’elle fait et fait ce qu’elle dit, on sait donc à quoi s’en tenir. Autre différence : il n’y a aucun habillage idéologique. Beaucoup d’interventions américaines ont été justifiées par la défense de la démocratie. Trump, dans sa conférence de presse au lendemain de l’opération de Caracas, a prononcé le mot pétrole une vingtaine de fois, et pas une seule fois celui de démocratie.
Si l’on cherche à comprendre pourquoi cette accélération — et je pense qu’il y en aura d’autres —, c’est très lié à la Chine et à la Russie. En Chine, il y a une accélération militaire sans précédent. Lors d’un défilé pour l’anniversaire de la libération et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Pékin a exhibé des capacités technologiques, y compris en matière de défense, sans aucun précédent. Le sujet de Taïwan ne va pas tarder à se poser. Deuxièmement, la Russie déçoit les Américains dans les négociations sur l’Ukraine. Elle est beaucoup plus liée à la Chine que ne le pensait l’administration Trump. Un accord en 2026 n’est plus assuré, contrairement aux attentes européennes et américaines. Face à cette interpénétration sino-russe, les États-Unis appliquent la doctrine des blocs. Il faut resserrer les rangs, maîtriser l’arrière-cour — Amérique centrale et Amérique latine — et sécuriser le Groenland. Trump l’a dit explicitement encore hier : il est hors de question de laisser le Groenland à la marine chinoise ou à la marine russe. C’est une démonstration de force d’un empire en déclin, mais qui entend encore peser. Et s’ils veulent s’approprier le Groenland au lieu de passer un accord avec le Danemark, qui serait simple, c’est parce qu’ils n’ont aucune confiance dans la capacité de l’Union européenne à résister à la pression chinoise et russe.
Dernier élément, très important, relevé par Gilles Gressani sur France Inter : le changement de régime n’est pas à Caracas, mais à Washington. À Caracas, on a enlevé un président, la vice-présidente gouverne, il n’y a pas de retour des opposants et la prix Nobel de la paix n’a pas pu rentrer au Venezuela ; il n’y a aucune intention d’opérer un changement de régime. En revanche, à Washington, il y a un changement de régime politique au sens où Trump s’est exonéré du Congrès. Celui-ci n’a même pas été informé de l’opération, Trump estimant « qu’il y aurait eu des fuites dans la presse » . Et dans les quatre composantes MAGA — post-libéraux, néo-réactionnaires, populistes classiques et républicains façon Rubio —, tout le monde converge sur l’idée qu’en raison du danger russe et surtout chinois, il faut changer de régime et qu’il faut un empereur ou un dictateur, comme dans la République romaine, pour nous protéger de l’imminence des périls. Le fait le plus intéressant dans tout cela, c’est que le changement de régime est à Washington.
Lucile Schmid :
Je crois que, pour comprendre ce qui vient de se passer au Venezuela, il faut prendre le temps d’observer comment les choses vont réellement évoluer. L’opération a été parfaitement exécutée : enlever un chef d’État et sa femme, avec ce niveau de professionnalisme, suppose des complicités au Venezuela même, ce qui montre à quel point Nicolás Maduro était détesté et combien le désir de changement existait, y compris dans les cercles proches du pouvoir. L’opération avait quelque chose de cinématographique. Notre tentation, face à la politique menée par Donald Trump, est de nous placer dans un mode de lecture « Netflix » — saison 1, saison 2 — avec une accélération permanente, et d’en déduire très vite qu’il y a une doctrine. Je ne suis pas certaine qu’on aurait analysé les événements aussi rapidement au XIXᵉ siècle. J’inviterais donc à la prudence avant de conclure à l’existence d’une doctrine. Il me semble qu’il s’agit davantage d’une logique de coups. Maduro était détesté par la population, il faisait l’objet d’une opposition extérieure très forte ; Marco Rubio en faisait un instrument pour affaiblir Cuba. On est davantage dans le coup que dans la doctrine.
Par ailleurs, si les États-Unis attaquent le Groenland — qui fait partie de l’OTAN —, alors là, il y aurait un véritable changement dans la doctrine américaine vis-à-vis de ses alliés. On peut considérer que renouer avec une politique interventionniste aux Amériques est quelque chose de traditionnel, même si cela ne s’était plus produit depuis le début du XXIᵉ siècle. Mais le faire en s’appropriant ensuite le Groenland serait une rupture profonde. Donc, n’annonçons pas trop vite une doctrine : constatons plutôt une logique de coups de la part de Donald Trump, et constatons aussi que le principe de réalité pourrait revenir rapidement. Trump fait d’abord confiance à la vice-présidente vénézuélienne. Bon, on verra. Un ancien conseiller de Bush rappelait qu’en 2003 on disait, à propos de l’Irak, « ce n’est certainement pas le Vietnam », comme Trump vient de dire « ce n’est certainement pas l’Irak ». Il y a un risque d’enlisement réel. Si l’objectif est de s’approprier les ressources pétrolières, cela suppose d’entraîner les compagnies américaines. Or, les inviter à la Maison-Blanche n’a pas suscité l’enthousiasme. Les infrastructures vénézuéliennes sont dans un état catastrophique, l’exploitation pétrolière réclame des dizaines de milliards de dollars, comme l’a reconnu Trump lui-même, et suppose une présence dans un pays dont on ignore la stabilité à deux ou trois mois …
Il ne faut pas que notre analyse géopolitique se calque sur l’horizon que Donald Trump impose, qui est l’horizon de l’heure et du coup. Il a pris un risque réel. Et je suis d’accord avec David : il n’a réussi à coaliser les différentes forces MAGA que parce qu’il vend l’idée qu’il s’agit d’une opération de prédation — s’emparer des ressources pétrolières — et non d’une opération démocratique. Mais que se passera-t-il ensuite, alors qu’il continue à promouvoir cette opération de manière assez clownesque ? Il y a un vrai sujet.
L’un des points essentiels concerne l’Europe. Que va-t-il se passer sur le Groenland ? J’ai vu des discussions très pointilleuses sur le fait que l’Union européenne ne pouvait pas se prononcer parce que le Groenland a un statut particulier et ne fait pas partie de l’UE. On voit bien que Donald Trump ne s’embarrasse pas de tels détails, et que l’Union européenne, elle, s’y englue. C’est extrêmement préoccupant. Il est temps que l’Union européenne cesse de s’embarrasser de détails vis-à-vis de Donald Trump.
Antoine Foucher :
Ce qui me frappe dans cette histoire, c’est que lorsqu’on essaie de chercher une logique rationnelle à l’intervention, on n’en trouve pas. Il y a pourtant deux grandes logiques rationnelles possibles : d’abord : « exporter la démocratie / lutter contre le communisme », comme pendant la guerre froide. Ce n’est pas du tout le cas ici, et d’ailleurs ils ne le revendiquent même pas. Mais même la logique du pétrole ne tient pas vraiment : certes, Trump a prononcé vingt fois le mot « pétrole », mais dès le lendemain ou le surlendemain, le patron d’Exxon Mobil et la plupart des majors ont expliqué qu’exploiter le pétrole vénézuélien coûterait trop cher et qu’ils n’iraient pas.
Philippe Meyer :
Sur cette histoire de pétrole, je trouve que c’est typique de la méthode Trump. Tout ce que tu viens de dire s’est passé, mais le surlendemain du surlendemain, Trump a déclaré : « oui, d’accord, mais ça fait rien, c’est très bon pour l’asphalte. On s’en servira pour faire de l’asphalte puisque ce n’est pas parfait » et après, quand on verra qu’on n’en fait pas d’asphalte, dira sans doute qu’on en fera des glaces …
Antoine Foucher :
En effet, il y aura peut-être un surlendemain qui nous montrera encore autre chose. Ce que j’entends des experts, c’est qu’ils donnent plutôt raison à Exxon Mobil : exploiter le pétrole vénézuélien est très coûteux et peut-être pas rentable. Peut-être que cela ne se fera jamais. Dès lors, il n’y a pas de logique rationnelle. Et quand il n’y a pas de logique rationnelle, le risque est de sombrer dans le complotisme pour chercher une explication.
Là où je rejoins Lucile et David, c’est qu’il faut, découpler Trump et le fond. Du côté de Trump, on peut très bien avoir une logique de communication, de spectacle, pour reprendre l’image Netflix de Lucile : une démonstration de force où il se réjouit d’aller capturer un dictateur sud-américain, d’exhiber la puissance américaine. Mais cette démonstration de force est, en réalité, un aveu de faiblesse : en l’absence de logique rationnelle, de stratégie ou de doctrine géopolitique, les conséquences ne peuvent que leur échapper et produire des effets qu’ils n’auront ni anticipés ni voulus.
Le contraste est saisissant entre les États-Unis qui capturent Maduro au début de 2026 et les États-Unis de 1948 qui, parce qu’ils en ont les moyens, sauvent Berlin-Ouest par un effort d’une générosité rarement vue au XXᵉ siècle. Aujourd’hui, l’Empire américain n’a plus les moyens d’être généreux. Nous l’avions dit lors d’une précédente émission : la production industrielle américaine représente désormais 25 % de celle de la Chine. Les États-Unis ne gardent une avance significative que dans l’intelligence artificielle. C’est un empire qui se replie sur lui-même et qui pratique des démonstrations de force à court terme, faute de moyens pour être généreux et dominant dans l’ensemble du monde.
Je terminerai sur l’idée que Trump n’est peut-être que le clown, mais qu’il y a derrière lui une visée, un agenda davantage intérieur qu’extérieur. Je suis assez convaincu par ce qu’évoquait David en reprenant Gilles Gressani. Le Grand Continent a publié fin décembre un texte de l’un des théoriciens néo-réactionnaires très influents à la Maison-Blanche. Il y soutient que 2026 commence par une accélération totalement inattendue et que ce n’est qu’un début, car Trump est un révolutionnaire au sens propre. L’agenda, derrière, est de changer de régime aux États-Unis ; et le propre d’une révolution est de devoir toujours accélérer pour ne pas s’effondrer.
Selon cette analyse, Trump en 2025 n’aurait pas été assez loin et risque d’être entravé par des midterms qui s’annoncent mal. D’où une alternative : soit, en 2026, il renverse complètement la table — avec invasion du Groenland et sans midterms en fin d’année —, soit il n’aura fait que s’inscrire dans l’impuissance des régimes dont il prétendait rompre avec les impasses.
Jean-Louis Bourlanges :
Je suis assez sensible à ce que vient de dire Antoine sur le caractère contradictoire de la démarche du président Trump. Je pense qu’il existe une hésitation fondamentale entre deux concepts : le concept MAGA et le concept MASA. MAGA, c’est Make America Great Again ; MASA, ce serait Make America Small Again. Ce qui se passe aujourd’hui est à la charnière de ces deux ambitions, paradoxalement vécues et pratiquées de façon simultanée, contradictoire ou complémentaire – c’est à voir.
Du côté MAGA, la volonté d’élargissement du périmètre américain est évidente. On le voit en Amérique latine, avec le contrôle d’un certain nombre de pays, dont le Venezuela aujourd’hui. Le principe de l’intervention pourrait se résumer ainsi : « vous nous donnez votre dictateur, vous gardez votre dictature ». On retrouve la même logique avec la Colombie, avec le Panama, et des alliés potentiels en Argentine, au Chili ou ailleurs. C’est une pénétration très forte des États-Unis. Sur ce point, je me démarque toutefois de la référence à la doctrine Monroe. La doctrine de 1823 émane d’un pays qui vient de s’émanciper du joug colonial britannique et qui considère que les pays latino-américains doivent participer au même mouvement d’émancipation contre les puissances colonisatrices européennes – l’Espagne et le Portugal. C’est une doctrine d’émancipation. Évidemment, l’émancipation n’élimine jamais la nature et l’horreur du vide, et suppose une volonté d’implication. Mais nous ne sommes plus du tout dans cette situation : nous sommes désormais dans une logique de prise en main.
Au nord, même chose : la revendication sur le Canada est difficile à satisfaire mais fortement exprimée ; celle sur le Groenland est plus aisée à réaliser et brutalement formulée, avec une difficulté particulière : elle implique un conflit direct, évidemment asymétrique, avec les Européens. On voit à quel point un pays comme le Royaume-Uni, malgré ses liens fondamentaux avec les États-Unis, réagit vivement. Toujours dans la logique MAGA, il y a la volonté de prendre en main l’Europe, de lui imposer des droits de douane désavantageux, de détruire l’Union européenne en la divisant, en nourrissant des partis qui sapent sa capacité de résistance. L’ambassadeur des États-Unis reçoit en grande pompe M. Bardella et Mme Le Pen. Enfin, il y a les opérations au Moyen-Orient avec un exécutant parfait – Israël – disposant d’une armée remarquable et de moyens d’investigation et de manipulation très efficaces.
À côté de cela, il existe une tentation MASA. Il s’agit de contrôler des territoires proches, d’élargir ce qu’on appellerait en France le « pré carré ». En revanche, on renonce à ce qui a été la base de l’empire américain – un empire d’inspiration britannique – fondé sur la manipulation hégémonique, le contrôle de points d’appui, l’usage de la mer comme vecteur de puissance. L’Iran fait exception à ce modèle, mais à cause du rôle d’Israël. Pour le reste, c’est fascinant : dans cette logique, l’Europe divisée finira par se rapprocher de Poutine. Il faudrait être aussi obstiné que Poutine pour ne pas voir que, une fois l’affaire ukrainienne en partie réglée, il existe une matière à rapprochement.
Dans la National Security Strategy 2020 de M. Trump, il n’y a que quelques lignes sur la Chine. Son discours à l’ONU était presque exclusivement consacré à l’Europe, donc à ses alliés, tandis qu’on ignore totalement ce qu’il faudrait faire dans le Pacifique face à la Chine – ce qui inquiète énormément les alliés asiatiques. Il y a ici une tentation du repli national, la substitution à un impérialisme hégémonique d’un nationalisme rétracté sur l’hémisphère américain, sans levier idéologique. L’abandon de Voice of America en est le symbole. Le discours de Vance en Europe est clair : plus de solidarité idéologique héritée de Truman et d’Eisenhower ; place au nationalisme, à l’autorité, à l’unilatéralisme.
Et, comme mes camarades, je conclurai que l’enjeu fondamental au bout de tout cela est la subversion de l’ordre intérieur américain et l’installation d’un régime illibéral. Ce processus est manifestement largement engagé.