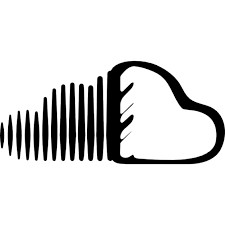"Je voudrais recommander une série qui est en ce moment sur Arte et qui est l’histoire du chalutier Bugaled Breizh, qui a coulé dans la Manche en 2004. L’histoire est bouleversante, et deux dimensions font qu’on ne lâche pas la série. La première, c’est la dimension de polar. Quand on ne connaît pas — et c’était mon cas — l’histoire de ce chalutier et l’histoire de l’enquête judiciaire, on suit les épisodes en se demandant : « Mais alors, pourquoi le chalutier a coulé ? » Et c’est vraiment très bien fait. La deuxième raison, c’est que la série montre en même temps les histoires de vie, la densité, le courage de la vie des marins et de leurs épouses et de leurs conjoints, en Bretagne aujourd’hui. Cela m’a fait penser aux Travailleurs de la mer. 150 ans plus tard, ce sont les mêmes. Le personnage joué par Nina Meurisse, qui emmène les Bretons dans la recherche de la vérité, résonne, me semble-t-il, un peu comme le Gilliatt d’Hugo. C’est la même dignité, le même courage, et la même vie très simple, mais vraiment admirable."